Théâtre
Sauvé

Aucune pièce de la dramaturge suédoise Alfhild Agrell (1849-1923) n’avait encore été traduite en français. Jouée une première fois au Théâtre royal de Stockholm en 1882, Sauvé se veut une réponse directe au drame d’Ibsen, Une Maison de poupée, jugé trop formaliste. Évolue ici Viola, très jeune femme mariée à Oscar, un employé de banque sans scrupules, qui n’a pas de considération pour elle et semble collectionner les aventures. La situation le satisfait : « Tu n’imposes aucune limite à ma liberté, tu ne me soumets pas à la question chaque fois que je sors ou que je rentre, tu ne te mets jamais en colère, tu chéris ton foyer et tu adores ton enfant. » Viola se mure dans le silence, occupée par l’éducation de leur fils, Alf. La mère d’Oscar, toujours désignée comme la « femme du recteur », règne, en réalité, sur le foyer. Viola accepte longtemps le rôle qu’Oscar entend la voir jouer, elle ne rechigne pas à prononcer ce qu’il croit être un mensonge, afin de faire plaisir à la femme du recteur : « Un mensonge glisse sur les lèvres d’une femme aussi doucement que le miel dans la bouche d’un enfant », se félicite-t-il. Mais lorsqu’une belle somme d’argent tombe entre ses mains, voilà Viola en mesure de rompre avec cet homme et de prendre son indépendance. Sauvé : le titre est ironique ; la pièce, elle, est loin d’être dépassée. Après avoir permis la découverte, ici, de Anne-Charlotte Leffler et de Victoria Benedictsson, Corinne François-Denève, remercions-la, nous donne donc à lire Alfhild Agrell, cette autre dramaturge suédoise un temps plus jouée que Strindberg. Du théâtre de qualité sur des thèmes féministes la plupart du temps – parce que la discussion ne saurait, lorsque les femmes n’ont toujours pas des salaires équivalents à ceux des hommes, que la parité en politique n’est pas atteinte, que des droits fondamentaux comme celui à l’avortement sont régulièrement remis en cause, être close.
* Alfhild Agrell, Sauvé (trad. Corinne François-Denève), L’Avant-scène théâtre (Quatre vents classique), 2017
La Casquette du musicien

Pièce radiophonique écrite en 1947, La Casquette du musicien ne fut enregistrée par la radio publique suédoise qu’en 1955. Stig Dagerman (1923-1954), son auteur, s’était suicidé un an plus tôt. « Je disais donc que quelqu’un m’avait dit que vous aviez besoin d’argent » : Monsieur Brohm s’adresse à Lennart, artiste, musicien ambulant, qui vit dans la détresse financière. Il a peur, s’il emprunte de l’argent à Monsieur Brohm, d’avoir ensuite « beaucoup de mal à regarder les gens dans les yeux ». Auteur de romans, de récits journalistiques et de drames, Dagerman parle ici d’expérience, lui qui éprouva des difficultés à joindre les deux bouts, en dépit du succès de ses écrits. L’argent, ou en l’occurrence le manque d’argent, est un souci permanent pour nombre d’artistes, musiciens, acteurs, peintres ou écrivains. Cette courte pièce a le mérite d’aborder le sujet, qui demeure tabou. La casquette – comme le chapeau, à l’issue d’une représentation, quand chacun donne en fonction de l’émotion ressentie et de ses moyens. Stig Dagerman avait plus ou moins prévu de rédiger une suite, ce qu’il ne fit pas, peut-être parce que cette pièce se suffit à elle-même avec sa trentaine de pages. Souhaitons découvrir d’autres perles de ce genre traduites en français – la bibliographie de l’auteur en comporte encore, assurément.
* Stig Dagerman, La Casquette du musicien (En spelmans mössa), version bilingue, trad. Philippe Bouquet ; préface Lo Dagerman ; postface Bengt Söderhäll, Belloni, 2021
Giselle, Mats Ek

Issu d’une famille d’artistes très réputés en Suède, le danseur et chorégraphe Mats Ek (né en 1945 à Malmö) décide, en 1982, de proposer sa propre version de Giselle – à l’origine un ballet romantique en deux actes, composé par Adolphe Adam sur un livret de Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges et Théophile Gautier, représenté à Paris pour la première fois en 1841. C’est donc un classique que s’approprie Mats Ek, aujourd’hui l’un des plus grands chorégraphes du monde. Énorme succès. Et c’est cette aventure artistique que Agnès Izrine, Philippe Verrièle et Bérengère Alfort relatent dans ce petit ouvrage agrémenté d’un cahier photos et prenant place dans une collection consacrée aux « chefs-d’œuvre de la danse ». Philippe Verrièle rappelle que Mats Ek surgit alors qu’un débat fait rage entre « contemporains » et « classiques » à propos du répertoire à proposer au public. « Sans grande déclaration, sans pose ni posture, le chorégraphe suédois vient mettre à bas cette opposition idéologique en affirmant tout simplement que cette vieille histoire mérite le regard contemporain parce que Giselle est une histoire aux résonances actuelles. » Autrement dit, poursuit Philippe Verrièle, « Giselle peut toucher le public d’aujourd’hui et avec de la danse de maintenant ». Car, ajoute quant à elle Agnès Izrine, « Giselle marque l’apogée de la danse ‘romantique’ ». Archétype du ballet romantique selon les critiques, Giselle est à voir sur scène, donc, avec ce petit livre, pourvu d’un glossaire fort utile pour les néophytes, entre les mains.
* Agnès Izrine, Giselle, Mats Ek, Mica danses Paris/Scala, 2023
= (Presque égal à)

Il existe aujourd’hui en Suède une génération d’auteurs nés dans les dernières décennies du XXe siècle et appartenant à ce que l’on nomme les nouveaux arrivants : ils ont eux-mêmes vu le jour à l’étranger ou sont enfants de parents d’origine étrangère. Jonas Hassen Khemiri (né en 1978) est l’un des plus illustres d’entre eux. Il racontait, dans un roman intitulé Montecore, un tigre unique (publié en France en 2008), l’arrivée de son père, un Tunisien, en Suède. Humour et émotion se mêlaient dans un texte à la fois nostalgique et chargé d’une belle révolte – comme il est difficile de se faire une place dans un pays d’accueil ! Si, comme ailleurs, des problèmes existent, la Suède est pourtant plutôt bienveillante avec ses immigrés. Dans tous ses textes, Khemiri ne cesse de poser un regard qui se veut lucide sur le monde et d’interroger le lecteur ou le spectateur. Plusieurs de ses pièces de théâtre ont été jouées en France (J’appelle mes frères, Invasion !, Nous qui sommes cent). Partant de sujet d’actualité (le terrorisme, l’immigration et, plus généralement, la place de chacun dans cette société consumériste), elles cherchent à déjouer les pièges de la pensée simpliste en vogue en France (ah, cette droitisation-lepénisation des esprits !), aux États-Unis (bye, bye, Obama !), ici ou là (pauvre Hongrie !), voire en Suède, ou les Démocrates s’installent fermement. Dans = (Presque égal à), Jonas Hassen Khemiri, qui a un faible pour les titres d’abord incompréhensibles (cf., déjà, Montecore, un tigre unique) parle d’économie. Pas avec l’aplomb de ces nantis qui squattent les écrans et démontrent telle ou telle théorie avant de s’en aller en discuter avec leurs pairs, mais par le biais de personnages « si proches de nous », dont les rêves sont souvent très matérialistes. « La pauvreté n’a pas le droit de vous suivre jusque chez vous après une soirée au théâtre, elle doit s’arrêter à la fin des applaudissements, parce que sinon ça vous rappellerait que la pauvreté n’est pas belle ou drôle ou héroïque, la pauvreté écorche, blesse, rend silencieux, fait honte, la pauvreté c’est des dos qui se courbent, des amis qui trahissent, des liens qui se brisent, des langues qui se taisent, des pères qui disparaissent. » Parmi d’autres, le poète et traducteur Armand Robin, en France et dans les années 1950, parlait de la pauvreté avec un accent similaire : la pauvreté était moche si elle n’était pas brandie. Khemiri pose des questions, sans apporter forcément de réponses. Tant mieux, car ainsi ses questions ne s’éteignent pas. « …Comment on fait taire une voix insupportable qui s’obstine à mesurer le monde en chiffres, en euros et en pourcentages ? »
* Jonas Hassen Khemiri, = (Presque égal à) (=(ungefär lika med), 2014, trad. Maranne Ségol-Samoy, Éditions Théâtrales, 2016
L’Apathie pour débutants

« Dans les années 2000, en Suède, un grand nombre d’enfants sont mystérieusement tombés malades. (…Ils) avaient en commun le fait que leurs parents étaient tous demandeurs d’asile, généralement en attente d’un permis de séjour ou avec déjà en main leur avis d’expulsion. » Ainsi commence L’Apathie pour débutants de Jonas Hassen Khemiri, pièce qui peut faire écho à Nous qui sommes cent, écrite peu avant et dont le sujet n’est pas si éloigné. L’auteur continue de traiter de faits d’actualité et notamment ceux relatifs à l’immigration. Ici, des enfants de parents d’origine étrangère deviennent mystérieusement apathiques. Une manipulation par les parents pour que la famille soit régularisée ? Une maladie causée par les autorités suédoises pour se débarrasser d’un trop-plein de migrants ? Les supputations vont évidemment bon train et révèlent le désarroi de la population et des autorités suédoises face à l’arrivée de ces migrants. La tradition d’accueil de la Suède est mise à mal. « Le monde est composé de six milliards d’êtres humains. On a un système de protection sociale qui couvre à peine neuf millions d’habitants. Un milliard c’est mille millions. Vous ne comprenez pas ce qui arriverait si on ouvrait nos frontières ? Vous ne vous rendez pas compte des conséquences ? » Quelles réponses humanitaires apporter ? Donnant la parole tant à une « fonctionnaire malveillante », qu’à une « fonctionnaire bienveillante » (les deux revers de la même personne), Jonas Hassen Khemiri ne se prononce pas clairement dans cette pièce et c’est ce qui en fait son intérêt. Le problème est complexe et, à l’heure des échanges mondialisés, ce n’est pas à un pays seul, soit-il préalablement animé des meilleures intentions, de le résoudre. Le théâtre comme outil de réflexion. Bravo !
* Jonas Hassen Khemiri, L’Apathie pour débutants (Apatiska för nybörjare, 2010), trad. Marianne Ségol-Samoy, Éditions Théâtrales, 2017
Théâtre complet

Si l’on excepte un article ou un autre dans des revues littéraires il y a plus de cent ans, le nom de Anne Charlotte Leffler n’est apparu en France que très récemment, quand les éditions de L’Avant-scène théâtre ont publié La Comédienne (cf. notre critique sur ce site), une pièce jouée à Stockholm en 1873 et jamais traduite ici. Les Classiques Garnier publient aujourd’hui le Théâtre complet de cette dramaturge suédoise, de sensibilité plutôt féministe, contemporaine de Strindberg, et nous ne pouvons que nous en féliciter (et… les en féliciter). Treize pièces en plus de mille pages : La Comédienne, Par le bout du nez, Le Pasteur adjoint, La Belle d’onze heures, Un Ange descendu du ciel, Les Vraies femmes, Le Moyen de faire le bien, Même pas peur !, La Lutte pour le bonheur, Ah ! l’amour !, Les Joies de la famille, Tante Malvina, Les Chemins de la vérité. Le tout complété par un appareil biographique et critique conséquent et signé (comme la traduction) Corinne François-Denève, fort utile pour découvrir, puisqu’elle reste à découvrir, cette auteure majeure de la littérature suédoise de la fin du XIXe siècle. Son théâtre a-t-il vieilli, comme cela lui fut reproché ? Tout est affaire de considérations. Les propos provocateurs et misogynes comme Strindberg pouvait en tenir sont plutôt bannis aujourd’hui des discours publics mais les droits élémentaires des femmes, ceux relevant de l’égalité entre tous les membres d’une même société, ne sont toujours pas tous acquis (ni, aujourd’hui, ici en France, ni même en Suède, ni bien sûr dans des pays comme ceux du Moyen Orient ou d’ailleurs). Les attaques réitérées contre l’IVG montrent bien que le chemin pour que les femmes puissent disposer comme elles l’entendent de leur corps et, au-delà, de leur vie, est encore long et incertain. Anne Charlotte Leffler n’était pas une féministe « enragée », si tant est que l’image ne relève pas du machisme le plus flagrant, elle était plutôt modérée et ne s’emportait pas plus que de raison contre les hommes. Ses pièces de théâtre ne doivent pas être lues ou jouées comme des charges partisanes, elles peuvent se moquer aussi des femmes (Ah ! l’amour !). Ce sont des drames qui tiennent la route, avec des personnages bien campés, des intrigues crédibles qu’il est souvent loisible de transposer à notre époque. On joue toujours August Strindberg, tant mieux, mais Anne Charlotte Leffler peut lui faire concurrence sans souci. « …Les thèmes qu’elle aborde (indépendance financière des femmes, vocation artistique, contraception, sexualité) sont souvent osés, progressistes, et à ce titre ses ouvrages furent souvent objets de scandales », écrit Corine François-Denève. Excellente idée, donc, que d’éditer enfin en français l’intégral de son théâtre. Un seul reproche, le poids de l’ensemble, un gros livre de 1100 pages pas très pratique à tenir en main. Un grand merci tout de même à Corine François-Denève et aux éditions Garnier de s’être attelées à ce si beau projet littéraire.
* Anne Charlotte Leffler, Théâtre complet (traduction et critique Corinne François-Denève), Classiques Garnier (Littératures du monde, 21), 2016
La Comédienne

Mis en scène par Benoît Lepecq, La Comédienne, de Anne Charlotte Leffler (1849-1892), est une pièce rescapée. Rescapée de la littérature, de l’art, du passé… Car les quelques écrits de cette Suédoise issue d’une « famille bourgeoise éclairée » ont très longtemps été introuvables, tant en Suède qu’à l’étranger – elle est ainsi publiée pour la première fois en France. La Comédienne relate l’arrivée dans une famille bien comme il faut d’une jeune femme, une orpheline, la fiancée du fils, qui exerce donc un métier de mauvaise réputation. Une actrice n’est-elle pas une « femme publique » ? Qui plus est, Ester Larson ne joue pas sa timorée ; au contraire, extravertie, extravagante, même, elle affirme vouloir vivre une vie qui ne serait qu’à elle, mentir, certes, car vivre c’est souvent mentir, mais une sorte de « mentir vrai ». Ester s’affronte à la pudibonderie bourgeoise, elle choque. Ou plaît. Intrigue, perturbe. Helge, son fiancé, la défend contre sa mère mais lui-même ne la comprend qu’à peine. Notons que cette pièce est à l’origine du film de Bo Widerberg, Elvira Madigan (1967). Anne Charlotte Leffler pose ici des problèmes qui tiendront à cœur à plusieurs de ses contemporains, Strindberg et Ibsen au premier rang : la place de la femme dans la société, au sein du couple comme au sein du monde du travail, l’expression de l’art et ses éventuelles limites, la prétendue bienséance, etc. L’Auguste, qui l’approuve d’abord, la rabrouera bientôt, lorsque des féministes reprendront le message sous-jacent de l’écrivaine. Celle-ci ne se revendique d’ailleurs pas féministe. Elle divorce, se convertit au catholicisme, se remarie, devient « duchesse de Caianello » tout en demeurant attachée aux idées du socialisme, donne naissance à un fils, à l’âge de quarante-deux ans, et décède peu après. Et on l’oublie. Jusqu’à ce que, dans les années 1970, luttes féministes obligent, son nom réapparaisse. Jouée en 1873 anonymement au Théâtre royal de Stockholm, La Comédienne est un succès, qui ne sera signé que dix ans plus tard, lors de sa publication en volume. De par sa forme, cette pièce a peut-être un peu vieilli, mais ses réparties pleines d’humour et d’impertinence la préservent de la désuétude, l’attitude d’Ester est un heureux camouflet à tous nos pères-la-pudeur. Au demeurant, le féminisme n’est pas un combat d’arrière-garde, hélas !
Le petit volume se prolonge avec une pièce de Victoria Benedictsson (1850-1888), La Juliette de Romeo. Plus connue sous le pseudonyme de Ernst Ahlgren, Victoria Benedictsson a vécu une histoire d’amour qui s’est très mal terminée avec le critique danois Georg Brandes, dont on n’ignore pas les efforts en faveur d’une littérature émancipatrice. On dit aussi qu’elle a inspiré Strindberg pour Mademoiselle Julie et Ibsen pour Hedda Gabler. La Juliette de Romeo traite de la liberté de la femme, notamment, là encore, lorsque celle-ci est une artiste. Un beau texte, court.
* Anne Charlotte Leffler, La Comédienne (Skådespelerskan, 1873), trad. Corinne François-Denève, L’Avant-scène théâtre n°1382-1383, 2015 ; suivi de Victoria Benedictsson, La Juliette de Roméo (Romeos-Julia, 1890), trad. Corinne François-Denève
Le Mardi où Morty est mort

Le Mardi où Morty est mort, du dramaturge Rasmus Lindberg, nous donne à voir un enterrement. Un enterrement avec tous ses à-côtés. Un moment peu ragoûtant, il faut bien le dire, où les pensées brutes des uns et des autres s’exposent. Edith : « Pendant trente ans la vie a été la même et maintenant elle ne sera plus jamais la même. Johan m’a quittée et il a emporté le passé avec lui, et maintenant ce qui me reste c’est l’avenir. » « Merci. Juste un peu de lait. Pas de sucre », lui répond Amanda.
Autre pièce de Rasmus Lindberg, Plus vite que la lumière joue également dans le registre de l’humour à la fois loufoque et grave et, de nouveau, n’hésite pas à mettre un animal en scène (Morty était un chien). Un chat tombe, tombe d’un immeuble et… s’interroge sur les lois de la relativité. Tout comme les divers habitants de cette ville, d’ailleurs, en proie à d’indicibles questionnements, et, finit par se dire le lecteur ou le spectateur, se questionner ainsi, ce n’est peut-être pas plus mal que de penser à s’entretuer ou à nuire à son voisin : « Mon Dieu, toi, tu crois, tu vis dans la conviction que l’être humain est un rayon de lumière dont la trajectoire dans l’univers en expansion permanente ne se courbe devant rien. Mais ce n’est pas comme ça. »
Né en 1980 à Luleå et aujourd’hui metteur en scène au Norrbottensteater, dans cette même ville, Rasmus Lindberg écrit tant pour les adultes que pour la jeunesse. Le style de son théâtre est direct, peut-on dire, et ses personnages semblent se mouvoir dans un quotidien qui ne nous est pas étranger. Humour bouffon et néanmoins, quant au fond, sérieux : difficile de résister même quand, avouons-le, on ne voit pas bien où Rasmus Lindberg cherche à nous emmener.
* Rasmus Lindberg, Le Mardi où Morty est mort (Dan då Dan dog, 2008), trad. Marianne Ségol-Samoy et Karin Serres, Espaces 34 (Théâtre contemporain en traduction), 2011 ; Plus vite que la lumière (Ljusets hastighet, 2005), trad. Marianne Ségol-Samoy, même éditeur, 2012
Habiter le temps
Intéressante, la conception de cette pièce de théâtre, Habiter le temps, de Rasmus Lindberg (né en 1980 et déjà publié et joué en France) : elle oblige à suivre trois actions simultanément et donc à jongler avec les réparties – lesquelles ne s’opposent pas mais se complètent. Dans une même maison, trois dialogues s’entrecroisent, avec leurs différences de ton, de vocabulaire et de conception de l’existence : Kristin et Erik en 1913 ; Stefan et Caroline en 1968 ; et Myriam et Hannelle aujourd’hui. Chaque couple, dont l’un des membres est l’enfant du précédent, représente son époque, avec ses tocades et ses soucis. « Leur vie et notre vie s’effleurent. Leur vie et notre vie s’influencent en permanence. » Les rôles masculins et féminins sont interrogés, par le biais d’un drame ancien dont les répercussions toucheront les enfants et leurs enfants et... « ...C’est comme ça qu’on se voit durant toute notre vie. Avec des mains qui ne tremblent pas et la vie devant nous. Jeune et pur, en quelque sorte. Sur le point de passer notre première nuit dans une maison dont on n’imagine pas un instant qu’on y vivra jusqu’à la fin de nos jours. » Le temps stagne, se condense, éclate, on ne sait plus. Ce qui est sûr, c’est qu’on ne le voit absolument pas passer.
* Rasmus Lindberg, Habiter le temps (Barn och deras barn, 2014), trad. Marianne Ségol-Samoy, Espace 34, 2020
Quand les trains passent
Réédition de Quand les trains passent... de Malin Lindroth (née en 1965), texte qui avait été mis en scène par la compagnie la Métonymie de Tiina Kaartama. Un volume avec en quatrième la mention « des passages de cet ouvrage peuvent heurter la sensibilité de jeunes lecteurs », ça laisse songeur. Autant indiquer un âge de lecture recommandé, non ? Certes, ce court texte est dur. Une jeune fille est harcelée dans un établissement scolaire. Les responsables ? Ses prétendus camarades de classe. Qui tous, à commencer par la narratrice, se prêtent au sordide jeu. « On était comme ça à cette époque. Lâches, et on l’est encore aujourd’hui. » Johnny, le petit ami de la narratrice, fait semblant d’en pincer pour Suzy Peterson, dite, pour la dévaloriser, Suzy P. « Il faisait joujou avec elle comme un sale gosse joue avec un jouet qu’il finit par détester. » Suzy est une gamine à l’écart des autres, si crédule. « Silencieuse et pâle, avec ses grands yeux sous sa frange, elle flippait. (…) Et puis ces fringues bizarres qu’elle avait. (…) Elle était quelqu’un qui était toujours en dehors de tout. » Ce qui justifie, n’est-ce pas, d’être stigmatisée, d’être maltraitée ? De se retrouver victime d’une tournante ? La narratrice n’exprime pas de regret. Un texte fort, sur la responsabilité de ses actes – ou de ses non-actes. Sur le temps qui passe et qui n’efface pas toujours tout.
* Malin Lindroth, Quand les trains passent... (När tågen går förbi, 2006), trad. Jacques Robnard, Actes sud (Junior/D’une seule voix), 2020
Des jours et des nuits à Chartres
Pour écrire cette pièce, Des jours et des nuits à Chartres, Henning Mankell est parti d’une photographie de Robert Capa (1913-1954), prise en août 1944 dans la préfecture de l’Eure-et-Loir. Une femme a été tondue pour avoir eu une relation amoureuse avec un soldat allemand. Un enfant est né, l’homme est mort au cours des combats de la Libération. « Ce sont des gens comme nous qui meurent à la guerre. Ce sont des gens comme nous qui essaient de survivre. Mais ce qui arrive se décide bien au-dessus de nos têtes. » Arrêtée, accusée de « collaboration horizontale », la femme va être jugée. Sur la photo, elle figure parmi des habitants de la ville, qui se réjouissent visiblement de son sort. Il y a plusieurs interrogations dans ce drame. Publié en français une première fois en 2011, il est aujourd’hui réédité avec un appareil critique et des pistes de lecture à destination des adolescents. De quoi est-elle (est-on) coupable ? La vengeance est-elle juste ? Quelles en sont les limites ? Et d’autres interrogations, sous-jacentes selon nous bien qu’absentes du corpus : pourquoi Mankell a-t-il tenu à ce que les personnages de Robert Capa et celui d’Helmut, le soldat allemand, soient jouées par un même comédien ? L’action du photographe et celle de l’occupant nazi concorderaient-elles à ce point ? Et puis : toutes les haines se valent-elles ? Conduisent-elles, toutes, à rendre équivalentes leurs causes ? Emporté par un besoin de justice qu’il veut placer au-dessus des individus, Mankell n’en vient-il pas à mettre en équivalence des comportements apparemment seulement équivalents. Le comportement du corps social ne saurait être celui de l’individu. Mais les sentiments de l’individu qui subit des violences ne sauraient se comparer aux sentiments de l’individu qui cause des violences, même si l’un et l’autre peuvent éprouver à un moment des sentiments similaires – ou adopter des attitudes aussi viles. Il y a parfois des compassions qui jonglent avec le sens moral (on peut discuter longuement de ce dont il s’agit, mais le sens moral est a minima ce qui permet à l’être humain de vivre en paix), au point de vider ce sens moral de toute signification. Les interrogations ne perdent-elles pas alors de leur pertinence ?
* Henning Mankell, Des jours et des nuits à Chartres (Dagar och nätter i Chartres, 2008), trad. Terje Sinding, Flammarion (Étonnants classiques), 2019
Solitaire/Poussière

Solitaire : Ils sont dix personnages, numérotés de un à dix, à enchaîner les répliques comme autant de coups de poignards : « Personne n’a une belle vie... seulement ceux qui ont disparu. » Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, s’excusent d’être là avec une maladresse sidérante : « Je n’ai rien fait de criminel ni de mal. (…) Je ne suis ni juive, ni noire, ni musulmane. On ne peut m’accuser de rien. (…) Je pourrais continuer cette liste à l’infini... mais à quoi bon. » Ils sont en colère, aigris, non sans raison puisque enfermés dans un rectangle invisible au milieu de la scène. « Nous devons sortir d’ici. Nous devons sortir d’une manière ou d’une autre. Il doit y avoir une façon de sortir d’ici. » Au fur et à mesure que le temps passe (pourtant, « nous ne savons pas depuis combien de temps nous sommes là »), ils se confient leurs soucis, leurs problèmes personnels. L’angoisse les étreint. La mort pourrait-elle les libérer ? Ou les vers, « ceux que l’on a dans le corps », pourraient-ils prendre le pouvoir ? Voilà un exemple des pensées qui les harcèlent. La situation s’envenime et la fin de cette pièce (aujourd'hui rééditée) est assez terrifiante. Poussière, elle, met en scène onze personnage, des vacanciers qui séjournent depuis « peut-être la trentième année... ou plus » dans le même hôtel sans avoir songé à faire connaissance les uns avec les autres. La solitude les retient-elle ? « Je me sens seul qu’en compagnie des autres », lâche un personnage. Là aussi, le ton va monter imperceptiblement. L’absurdité de la vie – et les contraintes qu’elle suscite –, est, on le voit, une fois de plus au centre des pièces de Lars Norén. « Je veux que les gens se souviennent de moi parce que j’ai eu la force de rester vivant », dit l’un des personnages en guise de conclusion.
* Lars Norén, Solitaire/Poussière (217, 2018), trad. du suédois Johan Härnsten & Amélie Wendling (Solitaire) et Aino Höglund & Amélie Wedling (Poussière), L’Arche (Scène ouverte), 2023
Le Courage de tuer/Kliniken (Crises)/Sang/Froid

« Comment jouer la folie ? » s’interroge Judith Henry, évoquant ses premières rencontre avec l’œuvre théâtrale de Lars Norén (1944-2021). « Aujourd’hui j’aurais envie de répondre : en ne la jouant pas. Le texte se suffit à lui-même. » Effectivement, les écrits du dramaturge suédois se suffisent à eux-même, inutile de les surjouer ou de chercher à les interpréter d’une façon trop univoque. La première pièce présentée dans ce volume, Le Courage de tuer, met en scène un père et son fils. Le premier, dans les soixante ans, la moitié pour le second. Les répliques tombent en rafales. La haine est là, sous-jacente d’un bout à l’autre sans que l’on sache bien pourquoi – jusqu’au parricide. Dans Kliniken (Crises), c’est à un échange de considérations décousues que le spectateur assiste. Les patients du lieu, une clinique indéterminée, n’en ont pas terminé avec leurs obsessions souvent morbides. La pièce intitulée Sang glace littéralement le sang : quand adultère et inceste se conjuguent ! « Ce pays n’est que la somme de ses obsessions. » Quant à la dernière, Froid, elle met en scène de jeunes « nationalistes » qui tuent l’un de leurs camarades de classe pour la raison qu’il n’est pas suédois d’origine. Leurs pensées, ou ce qui en tient lieu, ne volent vraiment pas bien haut. Lire du théâtre n’est pas toujours aisé mais les pièces de Norén, celles réunies ici comme celles publiées précédemment, sont fluides. L’action les porte, il n’y a pas de temps mort. Les thèmes sont puisés dans le monde contemporain, là où se révèlent les tourments de l’âme humaine. Le pire est toujours à venir, l’optimisme réservé pour les jours meilleurs. C’est noir, de fait, très noir.
* Lars Norén, Le Courage de tuer/Kliniken (Crises)/Sang/Froid, (Modet att döda, 1978 ; Kliniken, 1994 ; Blod, 1994 ; Kyla, 2003), trad. Katrin Ahlgren, Camilla Bouchet, Johan Härnsten, Aino Höglund, Jean-Louis Martinelli, Arnau Roig-Mora, Amélie Wendling ; prologue Judith Henry, L’Arche (Scène ouverte), 2022
La Nuit est mère du jour

Un hôtel à demi en faillite au bord de la Baltique. Le gérant alcoolique qui boit en cachette, la mère malade de la poitrine, et leurs deux fils, qui passent leur temps à se quereller. Voici, résumée, La Nuit est mère du jour, pièce de Lars Norén que proposent aujourd’hui les éditions de L’Arche. Les échanges entre les personnages sont vifs, violents, incessants. Que font-ils ensemble ? en vient-on vite à se demander. Ils ne se supportent plus, leur quotidien n’a plus de sens et pourtant… ! Le ressentiment les envahit : « Ce n’est tout de même pas ma faute si ce gouvernement socialiste a rayé toute ma vie et toute mes ambitions d’un coup de plume et s’efforce de ruiner tout ce que nous entreprenons – ce n’est tout de même pas de ma faute », se lamente, par exemple, Martin, le père. Il s’enivre en cachette et ses enfants ne le supportent plus, ils ne supportent plus leur mère non plus et leurs répliques, aux uns et aux autres, sont extrêmement dures et définitives : « …Tuez-le, tuez-le ! » Tout est glauque. Et pourtant, en quelques minutes, tout repart comme avant. Du Lars Norén dans le texte, pourrait-on dire, égal à lui-même, dérangeant au point qu’on ne parvient parfois que difficilement à le suivre.
* Lars Norén, La Nuit est mère du jour (Natten är dagens mor, 1982 ; texte français établi par Christophe Perton d’après la traduction de C. G. Bjurström et L. Albertini), L’Arche, 2016
Poussière

On peut trouver dommage que tant de traducteurs, en français, se soient penchés sur les ouvrages de Lars Norén. Ainsi, sur la vingtaine de titres publiés par les éditions de L'Arche, il y a quasiment autant de traducteurs. Cela, heureusement, ne gâche pas la qualité d'écriture de l'auteur suédois. Né en 1944, Lars Norén entraîne ici le lecteur – et le spectateur – sur un rivage bien encombré puisque une dizaine de vacanciers sont réunis sur une plage et ressassent leur ennui. Leurs propos décousus égrènent le temps sans, bien sûr, jamais l’arrêter et bientôt, la vacuité de leur existence les frappe en plein visage. « Il faut rester là jusqu’à ce qu’on devienne poussière. Tout simplement. » À moins que le drame survienne, comme ce cadavre de petite fille (une réfugiée ?) retrouvé sur la plage, par exemple, et qu’il fasse éclater la tranquillité factice de ces rendez-vous. Un texte très prenant du plus grand dramaturge suédois contemporain. « ...L’espoir est la pire chose qui existe. (...) Il faut essayer de vivre sans. Tout devient plus facile. »
* Lars Norén, Poussière (Poussière, 2017), trad. Aino Höglund & Amélie Wendling, L'Arche (Scène ouverte), 2018
Le chemin de Damas I
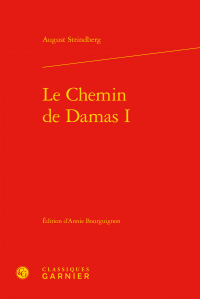
Publiée en 1898, Le Chemin de Damas I est une pièce importante dans l’œuvre de Strindberg. Écrite juste avant Le Songe, elle rompt avec le naturalisme alors en vigueur. L’important appareil critique qui accompagne aujourd’hui son édition bilingue est signé Annie Bourguignon, professeur émérite en études scandinaves de l’université de Lorraine, et par ailleurs spécialiste de littérature scandinave et de littérature comparée. Annie Bourguignon restitue la pièce dans l’œuvre et la biographie de Strindberg, ne lésinant pas sur les précisions et rappelant que l’expression « chemin de Damas » désigne « une conversion soudaine et spectaculaire », thème cher à Strindberg. Les lecteurs comprendront pourquoi l’écrivain, à sa mort, a été conduit au cimetière par des milliers de socialistes suédois – en dépit de ses retournements et contradictions. « …Que faites-vous ici, au coin de la rue ? » - « Je ne sais pas ; il faut bien que je sois quelque part quand j’attends. »
* August Strindberg, Le Chemin de Damas (Till Damaskus I, 1898), trad. Annie Bourguignon, Classiques Garnier (Littératures du monde), 2015
La Danse de mort

Certes, La Danse de mort n’est pas vraiment une nouveauté mais puisque l’éditeur (L’Arche) réédite cette pièce, signalons la pertinence et l’actualité du théâtre de Strindberg. Sur une île au large de Stockholm, dans une tour de forteresse, vivent Edgar, capitaine dans l’artillerie, et sa femme Alice, naguère actrice. Les relations entre eux sont tendues et toute leur ambivalence se joue lorsqu’intervient Kurt, à la fois vieil ami du capitaine et confident de sa femme. Tous personnages peu amènes, comme Strindberg sait si bien en tracer le portrait. Et ne jurerait-on pas entendre l’écrivain se dépeindre lui-même dans cette réplique désabusée du Capitaine à Kurt et à Alice : « Toute ma vie je n’ai eu que des ennemis, mais ils m’ont aidé au lieu de me nuire. Et quand je mourrai, je pourrai dire que je ne dois rien à personne et qu’on ne m’a rien donné pour rien » ?
* August Strindberg, La Danse de mort (Dödsdansen), trad. Alfred Jolivet & Georges Perros, L’Arche (Scène ouverte), 2017
Gertrud
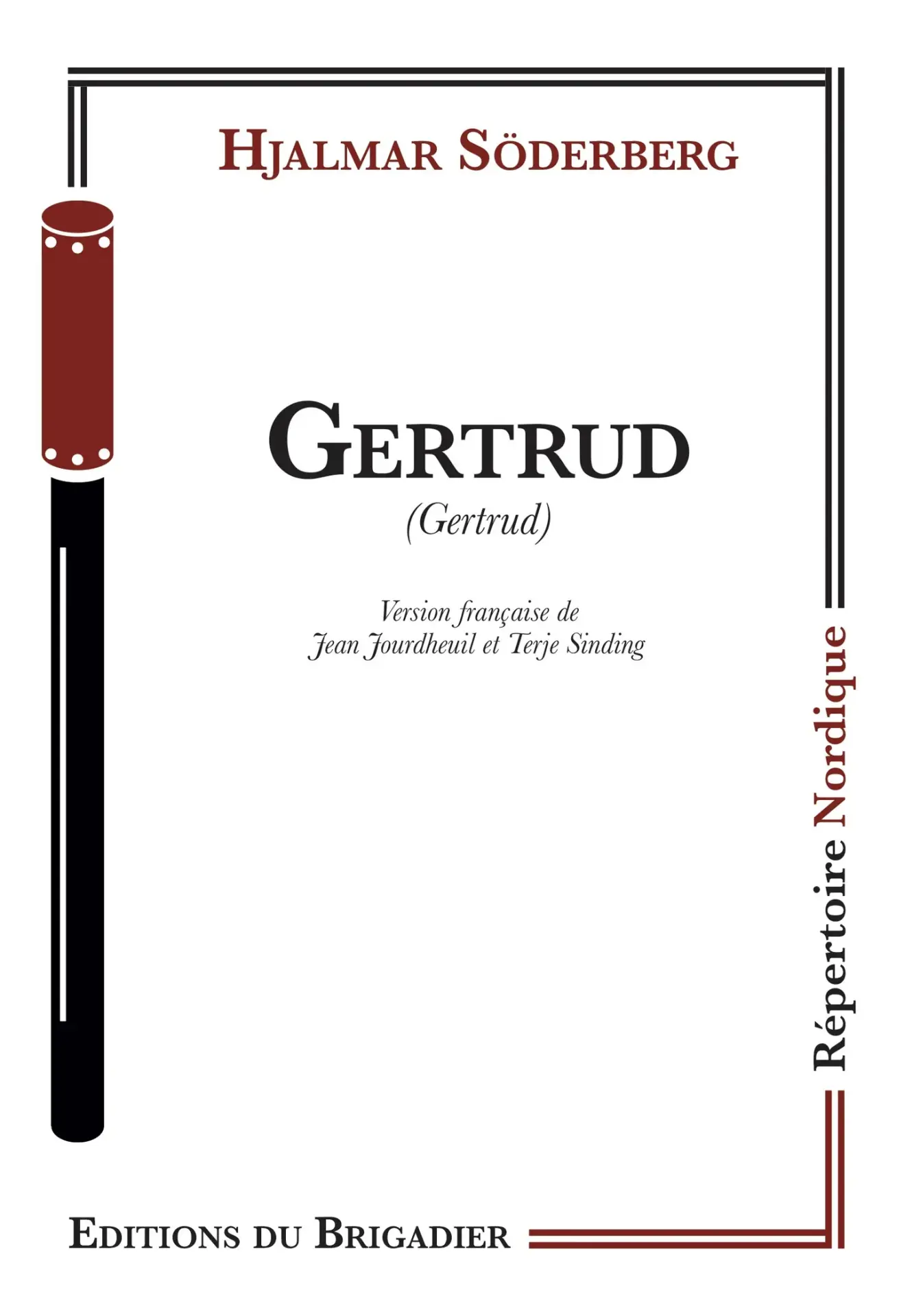
Journaliste, poète, traducteur (notamment de Maupassant et d’Anatole France), dramaturge, romancier, Hjalmar Söderberg (né à Stockholm en 1869 et décédé à Copenhague en 1941) livre, avec Gertrud, une pièce de théâtre (précédemment traduite par Vincent Dulac pour les éditions L’Esprit ouvert, 1994) qui défie le temps, objet par ailleurs du dernier film éponyme du réalisateur danois Carl Theodor Dreyer. Cantatrice quelque peu oubliée, Gertrud s’ennuie après de son époux, Gustave Kanning, politicien aux dents longues. Pendant qu’il se rend à un dîner politiques entre hommes (« Entre hommes, oui. Et vaguement politique. »), elle préfère occuper sa « place habituelle à l’opéra ». Et peut-être retrouver Erland Jansson, jeune compositeur dont on dit qu’il est « un génie », « un génie authentique » et qui la comble de joie. À moins que son cœur ne lui rappelle Gabriel Lindman, dont elle était autrefois amoureuse et qui est aujourd’hui de retour au pays. Franche, honnête, directe, Gertrud a du mal à dominer ses sentiments, au rebours de ses prétendants qui, eux, savent se montrer cyniques. Ainsi, Kanning avouant : « ...Je n’ai pas de préjugés. C’est peut-être ma plus grave faiblesse en tant qu’homme politique, mais ça peut aussi être une force. » Hjalmar Söderberg livre là un beau portrait de femme « sincère et tranquille », daté mais néanmoins étonnamment actuel, comme en écho, par exemple, à ces femmes fortes (Nora, Hilde, etc.) qui parsèment l’œuvre de son prédécesseur le Norvégien Henrick Ibsen (1828-1906), également au catalogue des éditions du Brigadier.
* Hjalmar Söderberg, Gertrud (Gertrud, 1906), version française de Jean Jourdheuil & Terje Sinding, Éditions du Brigadier (Répertoire nordique), 2024
Nobel et Bertha

Le titre est un peu étrange ; pourquoi le patronyme de l’un et le prénom de l’autre ? Mais Alfred et Bertha, cela n’aurait pas été si parlant, bien entendu. Signée du metteur en scène Christopher Thébault, cette pièce, Nobel et Bertha, donc, met la lumière sur la relation entre le Suédois inventeur de la dynamite et la pacifiste autrichienne Bertha von Suttner. Pas mal de choses ont déjà été écrites sur eux, qui n’ont vraisemblablement jamais été amants mais entretinrent une liaison intellectuelle basée sur une affection mutuelle et une vision du monde proche. Pacifiste, auteure du beau roman Bas les armes ! (1899, réédité aux éditions Turquoise en 2015), Bertha von Suttner fut la première femme à recevoir le prix Nobel de la paix (1905), bien après le décès d’Alfred (1896). Cette pièce, créée au festival les Fabricoles de Meung-sur-Loire en 2023, se place dans le registre de l’humour, pas le plus fin. C’est plutôt bon enfant, plutôt grand public, jeune public peut-être, plein de plaisanteries tirées par les cheveux.
* Christophe Thébault, Nobel et Bertha, L’Harmattan (Théâtres), 2024


