E-F-G
Ceux d’à côté

« Je suis sûre que ça va bien se passer, a dit Bianca en posant son bras sur le mien. Je ne veux pas t’effrayer. Nous habitons Bråkmakargatan, au numéro 13 : qu’est-ce qui pourrait bien nous arriver, hein ? » Mikael et Bianca Andersson et leurs deux jeunes enfants viennent d’emménager dans une maison en lotissement d’une petite ville de Scanie, au nord de Malmö. Micke est professeur de sport et Bianca, agente immobilière. Tout semble s’annoncer sous les meilleurs auspices, mais c’est sans compter sur leurs voisins, qui vont s’immiscer d’une façon ou d’une autre dans leur vie et la chambouler. Après Une Famille presque normale, M. T. Edvardsson signe là un nouveau roman fort bien construit et déroutant sur ce même thème, la structure familiale – source intrinsèque de maladie mentale ? La question de la culpabilité se pose d’un bout à l’autre de l’ouvrage. « C’est un danger mortel de fréquenter ses voisins », observe Micke lors d’une discussion avec son épouse, ne croyant pas si bien dire. Les voisins : autrement dit Åke et Gun-Britt, le couple de retraités au courant de tout dans la rue, Ola, dont nul ne sait exactement ce qu’il a à se reprocher sinon une réputation sulfureuse, et surtout Jacqueline, ex-mannequin, et son fils Fabian, un adolescent pas très bien dans sa peau, pléonasme, dont Micke va être le mentor au lycée. De petite fête en petite fête, les voisins font connaissance et bientôt, il est trop tard, une catastrophe se produit – que le lecteur n’appréhende que progressivement. Ceux d’à côté est un livre qui se referme avec un pincement au cœur, tant les événements s’enchaînent de manière juste. À classer parmi les « thrillers psychologiques », sans prétentions sociales, au contraire de nombre de romans policiers nordiques (si ce n’est une charge contre ce que l’on appelle la classe moyenne), et pourtant d’une lecture enthousiasmante.
* M. T. Edvardsson, Ceux d’à côté (Goda grannar, 2020), trad. Rémi Cassaigne, Sonatine, 2022
Une Famille presque normale
« Nous étions une famille tout à fait normale », se remémore Adam Sandell, le père, pasteur à Lund. Sa femme, Ulrika, est avocate. Leur fille, Stella, vient d’être arrêtée par la police, accusée du meurtre d’un homme d’affaires, Christopher Olsen. Adam va tout faire pour prouver l’innocence de Stella, mais plus il progresse, se souvenant de sa fille lorsqu’elle était petite ou allant voir des témoins, plus la culpabilité de celle-ci s’affirme. Ulrika, elle, ne sait trop que penser, semble-t-il, d’autant plus que Stella ne crie pas à l’innocence. Divers autres personnages pourraient avoir eu le désir de tuer Christopher Olsen. Le roman est construit en trois parties, trois points de vue. D’abord celui du père, puis de Stella, violée ou pas, puis de la mère. Tout ce qui semble évident est méticuleusement battu en brèche, déstabilisant le lecteur. Il s’agit ici d’un roman de procédure, au cours duquel la police n’a qu’une place mesurée. Au gré des versions, les retournements se succèdent, renforçant la logique de l’enquête. La fin du livre fait fi de la justice – celle de l’appareil judiciaire – mais le lecteur ne s’en plaindra sûrement pas. « Nous ne pouvions pas faire autrement. De toute façon, la justice n’existe pas. » Donné pour être le premier roman de M. T. Edvardsson, (né en 1977, enseignant à Trelleborg), Une Famille presque normale joue astucieusement avec les rouages de la cohérence familiale. Prenant.
* M. T. Edvardsson, Une Famille presque normale (En helt vanlig familj, 2018), trad. Rémi Cassaigne, Sonatine, 2019
L’Ange des neiges
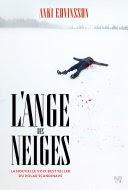
La policière Charlotte von Klint emménage avec sa fille Ania à Umeå, dans l’idée de mener une vie plus calme qu’à Stockholm. Mais voilà que Tony Israelsson, notoire trafiquant de drogue qui lui en veut personnellement, arrive lui aussi dans cette paisible ville du nord de la Suède pour régler quelques comptes. Bientôt, son collègue Per Berg, « le policier aux yeux tristes », enquête avec elle sur le suicide d’Anton, un adolescent, puis sur la disparition de Frida, sa meilleure amie, du même âge. Un trafic de drogue à destination plus particulièrement des jeunes frappe-t-il Umeå ? La découverte de plusieurs assassinats vient alimenter cette hypothèse. Signé Anki Edvindsson (née en 1971), L’Ange des neiges n’est pas un roman qui brille par son originalité, mais il est rondement mené et prend pour cadre une région, les bords du golfe de Botnie, d’ordinaire assez oubliée des auteurs de romans policiers suédois. Ancienne animatrice de télévision et journaliste, l’auteure a étudié la criminologie après avoir passé une enfance « dans une famille de policiers », lui garantissant de connaître les habitudes des commissariats. L’Ange des neiges est son deuxième roman, une suite est d’ores et déjà annoncée.
* Anki Edvinsson, L’Ange des neiges (Snöängeln, 2021), trad. du suédois Anna Gibson, Hachette (Black lab), 2025
La Maison au bout du monde

La supposée-mort de l’inspecteur Erik Winter dans le prétendu dernier volume de ses aventures (Le Dernier hiver), nous laissait comme un sentiment de colère envers Åke Edwardson. Si, en effet, nous avions attaqué la série avec scepticisme, le policier avait su gagner notre sympathie. Scepticisme ? Parce que Eric Winter venait après pas mal d’autres flics du même acabit, se dépêtrant tant bien que vaille avec ses problèmes personnels, son travail et sa conscience d’homme plutôt honnête. Comment ne pas voir derrière ce portrait rapide celui, antérieur, de Kurt Wallander, le héros de Henning Mankell, par exemple ? Mais au fil des volumes Erik Winter a acquis une vraie personnalité et celui qui pouvait d’abord exaspérer le lecteur par ses côtés dandys a réussi à mettre en avant des qualités beaucoup plus profondes. Les soucis de la Suède d’aujourd’hui apparaissent ainsi dans chacun des volumes de cette série : multiplication des formes de délinquance, montée d’une droite extrême décomplexée, désignation des immigrés comme responsables de la plupart des maux actuels… Åke Edwardson surprend le lecteur en s’inscrivant dans une tradition littéraire policière ouverte par le couple Sjöwall-Wahlöö alors que, avec son flic apparemment propre sur lui, il aurait pu prendre place dans cette « fashionisation » des lettres qui accueille de nombreux auteurs.
La Maison au bout du monde (Hus vid världens ände, 2012, trad. Rémi Cassaigne, JC Lattès, 2015) commence par la découverte de trois corps, celui d’une femme et de ses deux jeunes enfants, dans une maison des environs de Göteborg. Un bébé a été laissé en vie dans sa chambre. Pourquoi ? Erik Winter, lui, a failli mourir noyé en Espagne, deux ans plus tôt ; il souffre d’un acouphène. Mais il laisse Angela, sa femme, et leurs deux filles sur la Costa del Sol et revient dans sa ville natale, reprendre son poste de policier. L’enquête progresse lentement. Les suspects sont nombreux. Il est obligé de retourner à plusieurs reprises en Espagne car sa mère, qui s’y était installée avec son père, aujourd’hui décédé, souffre d’un cancer et finit par s’éteindre. Les suspects sont nombreux et peut-être n’y a-t-il pas qu’un seul coupable. « On pouvait tout et rien dire sur les comportements humains. Mieux valait ne rien ajouter. » Un roman policier qui, de toute évidence, va au-delà de la simple enquête.
Marconi Park

C’est dans une énième enquête de Erik Winter que Åke Edwardson nous entraîne, avec Marconi Park, mais nous ne nous en plaindrons pas car ce flic à l’humeur nonchalante sait gagner la sympathie du lecteur. Un cadavre est retrouvé à Göteborg, un homme d’une quarantaine d’années, un sachet en plastique sur le visage, une lettre peinte sur un morceau de carton à côté ; puis un deuxième, un troisième, une femme. Quel lien entre eux ? Le roman est mené tambour battant, de Göteborg à Málaga, en passant par Stockholm, « Toc-toc-holm », avec un Erik Winter plutôt mal en point : Angela, sa compagne, est restée en Andalousie avec leurs enfants, Elsa et Lilly, elle aimerait qu’il change de métier et surtout qu’il la rejoigne au soleil. L’alcool et la nourriture, le jazz aussi, lui procurent des petites joies, non moins que son travail, le quotidien de son travail, avec ses collègues et les montées d’adrénaline lorsque les enquêtes sont sur le point de se conclure. On le trouve cependant ici exténué, alignant les préjugés, faux comme beaucoup de préjugés ou, parfois, pertinents. Il n’ignore pas tout ce qu’il aime et tout ce qu’il réprouve. « « Il n’aimait pas les gens riches, la plupart s’étaient procuré du fric de manière malhonnête. » Comme d’habitude, il se fie à son instinct plus qu’aux découvertes de l’enquête, ce qui permet à celle-ci de progresser rapidement. Une vengeance ? L’essentiel du roman se compose de non-dits. À chaque fois qu’une avancée semble possible, l’auteur bifurque, laissant le lecteur sur sa faim, puis revient à la charge et lui révèle une part des faits. On a souvent envie de donner un coup de pied aux fesses à Erik Winter, si tant est qu’il se laisse faire, mais le quitter à la fin de chaque volume est toujours un moment que l’on préfèrerait éviter. Markoni park n’échappe pas à cette règle.
* Åke Edwardson, Marconi Park (Marconi Park, 2013), trad. Rémi Cassaigne, JC Lattès, 2016
Le Malmö de Fredrik Ekelund

Né en 1953 en Suède, Fredrik Ekelund a signé une dizaine de pièces de théâtre et plusieurs romans policiers. Le Garçon dans le chêne entraîne le lecteur dans la Suède d’aujourd’hui, confrontée à des problèmes d’intégration et de violence. L’inspecteur Hjalmar Lindström, cinquante ans, ne reconnaît plus guère Malmö, cette ville dans laquelle il a passé son enfance et qui a tellement changé qu’elle est aujourd’hui comparée à Marseille. Il est accompagné de Monica Gren, d’abord stagiaire puis policière, Asiatique adoptée à l’âge de quelques mois par un couple de Suédois, qui devient sa compagne. Blueberry Hill prend pour cadre un quartier en pleine rénovation de Malmö. Des immeubles flambant neufs côtoient les ruines du chantier naval, parmi lesquelles subsistent quelques SDF. Quand l’un d’entre eux est victime d’un incendie, Monica Gren est convaincue qu’il s’agit d’un assassinat. Qui est le coupable ? Un autre SDF, un locataire mécontent, un jeune néo-nazi ? Le trafic de drogue est au centre de l’intrigue de Casal Ventoso. Un riche homme d’affaires, « une charogne de première » selon un policier qui n’est jamais parvenu à le coincer, est assassiné à coups de hache, une seringue emplie de lessive lui est plantée dans l’œil. Le lecteur découvre comment le trafic de drogue a évolué entre les années 1970 et le début des années 2000, comment il est devenu un véritable fléau, une « épidémie » contre laquelle la police est désarmée.
* Le Garçon dans le chêne (Pojken i eken, 2003), trad. Philippe Bouquet, Gaïa (Polar), 2012
* Blueberry Hill (Blueberry Hill, 2003), trad. Philippe Bouquet, Gaïa (Polar), 2013
* Casal ventoso (Casal Venteso, 2005), trad. Philippe Bouquet, Gaïa (Polar), 2015
Dans le labyrinthe

Dans une belle maison d’une banlieue huppée de Stockholm, Magda, une fillette de onze ans, disparaît. Le père, éditeur, est suspecté par la police ; la mère, psychologue, fait également figure de coupable. D’autres personnages participent à l’intrigue, eux aussi coupables potentiels. Dans le labyrinthe est un roman essentiellement psychologique, qui n’est pas sans évoquer ceux des Suédois Hans Kopel ou Karin Altvegen. Scénariste et producteur pour la télévision, journaliste web et blogueur, Sigge Eklund (né en 1974) a déjà publié quatre romans, tous noirs. Puisque « raconter, c’est préserver un secret » (on détourne l’attention de ce que l’on veut cacher), disons que la fin de ce roman, Dans le labyrinthe, qui n’est pas vraiment un policier, surprendra le lecteur.
* Sigge Eklund, Dans le labyrinthe (In i labyrinten, 2914), trad. Martine Sgard, Piranha, 2017
Les Veuves

Quand le cadavre de Rikard Olsson, un policier, est découvert dans un parc du centre de Stockholm, toutes les pistes sont ouvertes. Pourtant, peu après, un deuxième corps, celui d’une femme, est retrouvé. Il s’agit de Natacha, une amie de Vanessa Franck, enquêtrice, laquelle se sent directement concernée. Natacha a disparu depuis quelques années, apparemment retournée en Syrie. La guerre des gangs qui sévit en Suède livrerait-elle une explication ? « La Suède et Stockholm avaient changé (…). Des PDG et des directeurs d’entreprises étaient suivis par des gardes du corps qui les protégeaient eux et leurs familles contre les tentatives d’enlèvement et d’extorsion. » Après Féminicide, Pascal Engman (le nègre de Camilla Läckberg ?) offre Les Veuves, roman dans lequel le lecteur entre de plain-pied, avec nombre de précisions contemporaines. Les certitudes de Vanessa Franck sont ébranlées. « ...Comme elle l’avait déjà compris, les enquêteurs s’étaient aveuglément concentrés sur Rikard Olsson », avant tout parce qu’il était policier. Le lecteur peut se demander comment l’enquêtrice, si perspicace, n’a pas observé de signes de radicalisation chez celle qui se faisait appeler Natacha et qui a habité chez elle – puisque tel est le thème principal de ce roman policier : l’infiltration de l’EI, « le soi-disant État islamique », dans le corps social suédois. Vanessa « avait donné naissance à une fille », Adeline, à Cuba, où elle a résidé une dizaine d’années plus tôt : « Elle qui avait été la jeune fille d’un riche PDG d’Östermalm était tombée amoureuse d’un militaire cubain, avait tout plaqué et s’était installée dans une dictature communiste des Caraïbes, au grand dam de son père. » Elle a vécu ensuite une relation proche avec Nicolas Paredes, ancien des Forces spéciales, baroudeur à présent garde du corps d’un entrepreneur empêtré dans un scandale financier lié à... l’EI ! « ...Il se retrouvait à un carrefour de sa vie, sans projet d’avenir. Il ne savait pas où il voulait vivre ni ce à quoi il allait consacrer le reste de son temps sur terre. (…) Une chose était sûre : comme soldat, la vie aurait été plus simple. » Les différents meurtres qui parsèment ce roman s’imbriquent, les hypothèses convergent. « Certaines femmes du Califat dont les maris avaient été tués s’étaient remariées avec d’autres combattants. D’autres, particulièrement capables et croyantes, avaient été sélectionnées, envoyées dans des camps d’entraînement, puis mélangées au flot de réfugiés qui se dirigeaient vers le nord. » Les Veuves est un roman dense et bien conçu sur un sujet d’actualité. Les rebondissements ne manquent pas, la lecture est rapide.
* Pascal Engman, Les Veuves (Änkorna, 2020), trad. du suédois Catherine Renaud, Nouveau monde, 2025
Féminicide

Si ce n’est pas le polar de l’année, il s’agit tout de même d’un roman dans l’ensemble bien mené. Comme l’indique son titre, Féminicide (un « s » aurait pu être ajouté), de Pascal Engman (né en 1986 à Stockholm, ancien journaliste), relate une série d’assassinats de femmes dans la capitale suédoise, de nos jours. Qui donc peut les commettre ? Assistée du « gros enquêteur » Ove Dahlberg, Vanessa Frank, « enquêtrice à la Crim’ », est chargée de le découvrir. « Je me promène dans le pays et j’aide mes collègues à enquêter sur des meurtres », explique-t-elle avec modestie à son ancien petit ami, lui indiquant ainsi qu’elle a changé de service, quand il lui demande si elle travaille toujours dans la police. Quel est le fil directeur entre ces meurtres ? Présenté comme « l’auteur suédois de romans policiers le plus vendu de sa génération » – combien avant lui ont ainsi été présentés, de Jens Lapidus à Camilla Läckberg, de Stieg Larsson à David Lagercrantz, etc. ! les éditeurs rivalisent de superlatifs autant que de platitudes – Pascal Engman ne brille pas par son originalité. Tout est plus ou moins convenu, les rebondissements ne manquent pas et des questions restent en suspens à la fin du roman – en gros, tout finit bien. Le monde a tant changé en quelques années, la paisible Suède est en proie à la violence. « Stockholm regorgeait d’armes à feu et de jeunes gens prêts à s’en servir pour obtenir une part du marché de la cocaïne ou pour se venger d’un affront supposé. » Féminicide est le deuxième titre d’une série de quatre (avec ici plusieurs références au volume précédent, dont l’action semble prendre en partie pour cadre l’Amérique du sud, pourquoi ne pas commencer par publier le premier volume ?), centrée sur le personnage de Vanessa Frank. Le thème des « incels », pour « involuntary celibacy », le « célibat involontaire » ce « mouvement de dizaines de milliers d’hommes sur Internet qui sont unis par leur haine des femmes », est décliné. L’un de ces olibrius décide de se venger du sort qu’à cause des femmes il subit – ou qu’il croit subir. Ah, ces hommes qui n’aiment pas les femmes ! dirait Lisbeth Salander.
* Pascal Engman, Féminicide (Råttkungen, 2019), trad. du suédois Catherine Renaud, Nouveau monde, 2024
C’est ainsi que tout s’achève

Pas de difficulté à lire ce roman de Caroline Eriksson (le quatrième – seul L’Île des absents a été traduit en français), C'est ainsi que tout s'achève : tout est limpide, les mal comprenant de Babelio devraient apprécier, mais... Comme un air de déjà vu, de déjà lu. Elena, une écrivaine recluse dans une petite maison suite à sa rupture conjugale, se met à observer ses voisins d’en face. Puis à les surveiller. Jusqu’à ne plus savoir, entre eux et elle, qui est qui, qui a fait quoi ? Le roman qu’elle est en train d’écrire s’en ressentira-t-il ? « Les visions convergent puis s’éloignent, la réalité se confond avec mon imagination. Qu’ai-je réellement vu ? Je repousse l’ordinateur et me frotte le visage. Je ne peux plus le supporter. Mais quoi, au juste ? Les épreuves que mon texte va peut-être infliger à la famille Storm ou ma confusion grandissante ? » Sa sœur surgit en renfort, lit le manuscrit qu’Elena vient de terminer, découvre que... « Quand j’entamerai un nouveau livre – si j’en entame un –, je me surveillerai. Je serai particulièrement attentive à la différence, parfois mince mais décisive, entre réalité et fiction, entre moi et les autres. » Voilà, quand tout s’achève, tout peut recommencer.
* Caroline Eriksson, C’est ainsi que tout s’achève (Hon som vakar, 2017), trad. Laurence Mennerich, Presses de la Cité (Sang d’encre), 2020
L’Île des absents

Alex, Greta et leur fillette Smilla font une promenade en barque sur un lac suédois nommé le Cauchemar – nul ne sait exactement pourquoi, sans doute s’agit-il d’un surnom. Au centre du lac, une île, sur laquelle Alex et Smilla accostent, tandis que Greta les attend dans la barque. Mais ils ne reviennent pas. Elle descend les chercher – ils ont disparu. Les jours suivants, elle ne contacte pas la police, mais tente de les retrouver. Quand, enfin, elle se résout à avertir les forces de l’ordre, c’est pour s’entendre dire que : « ...Selon le registre, vous n’avez ni mari ni enfant. Vous n’en avez jamais eu. » L’Île des absentsest à mi-chemin entre le roman policier et le récit fantastique. Qu’est-ce qui est vrai, qu’est-ce qui ne l’est pas ? Caroline Eriksson (née en 1976, psychologue de formation) entraîne le lecteur dans une intrigue déstabilisante, où bien vite on ne sait plus quelle confiance il faut accorder à Greta, la narratrice. Quels furent ses rapports avec son père ? Avec sa mère ? Ces personnages réapparaissent-ils dans sa vie d’aujourd’hui ? Qui est Smilla ? Enfance et vie adulte se mêlent pour tisser la trame d’un roman aux frontières de l’inexplicable.
* Caroline Eriksson,L’Île des absents(De Försvunna, 2015), trad. Laurence Mennerich, Presses de la Cité, 2018
Carin Gerhardsen

Les romans policiers de Carin Gerhardsen nous semblent peu prétentieux – et il s’agit d’une qualité tant le genre rivalise de superlatifs (combien a-t-on vu de « nouveaux Millénium ? »). Pas de bandeau en couverture annonçant des prix en rafales ou l’émoi assuré des lecteurs, juste des enquêtes qui tiennent la route, menées par une équipe de policiers que le lecteur retrouve d’un volume à l’autre. Le dernier, Dissonances, est centré sur un drôle de personnage, un certain John Gideon, suspecté par son voisinage d’être un pédophile. Mais faut-il se fier aux apparences ?
* Dissonances (Gideons ring, 2012), trad. Charlotte Drake et Patrick Vandar, Fleuve, 2015
L’Énigme de la stuga

Hasard des productions éditoriales ? « Une fête familiale qui se heurte à l’irréparable. Deux fils que tout accuse. Une mère prête à tout pour rétablir la vérité. » Ainsi le roman de Camilla Grebe, L’Énigme de la stuga, est-il présenté en quatrième de couverture. Récemment paru, le roman Les Garçons qui brûlent de Eva Björg Ægisdóttir (cf. critique sur ce site) pourrait reprendre quasiment mot pour mot cette accroche. Mais les deux romans sont pourtant fort différents. Dans L’Énigme de la stuga, Camilla Grebe présente une femme, Lykke Andersen, attachée de presse, Gabriel, son écrivain de mari récompensé par le succès (« écrivain préféré des Suédois »), et leurs jumeaux, David et Harry (ce dernier prénommé ainsi « d’après Harry Martinson (…) le plus grand écrivain prolétarien de Suède » – les références littéraires sont ici nombreuses). Plus Bonnie, dix-sept ans, l’amie des deux adolescents, qui sera retrouvée morte dans la stuga à proximité de la maison familiale à l’issue de la fête des écrevisses. Aurait-elle été étouffée par David, comme la chemise du jeune homme dissimulée à proximité le laisse à penser ? Lykke est effondrée – ses enfants ne seraient pas tels qu’elle les voyait ? « Comment pouvais-je les aimer quand l’un d’entre eux avait tué Bonnie ? Comment les haïr quand l’un d’entre eux était innocent ? » Peut-on aimer un assassin, se demande-t-elle encore, s’interrogeant sur les notions de bien et de mal. Le rôle de la police est également pointé. Jusqu’où un interrogatoire peut-il aller ? « J’ai honte de ne jamais avoir réfléchi à ce qui leur était arrivé », se dit Manfred Olsson, policier chargé de l’enquête, qui apparaît dans d’autres ouvrages de Camilla Grebe. L’Énigme de la stuga est un excellent roman policier, volontiers psychologique. Camilla Grebe est aujourd’hui l’une des plus intéressantes auteures de polars suédois et chacun de ses livres semble plus approfondi que le précédent. Elle utilise ici le principe du crime commis dans une chambre close (la stuga) pour observer jusqu’à quel point l’unité d’une famille peut tenir. Peut-être quelque peu caricaturale, machiavélique à souhait, sa description du milieu éditorial et littéraire est bien amenée. Plusieurs niveaux de lecture peuvent être envisagés, avec cette conclusion terrible : « ...La vérité appartient à ceux qui ont le pouvoir et la capacité de la formuler ». La résolution de cette « énigme de la stuga » réside dans cette phrase.
* Camilla Grebe, L’Énigme de la stuga (Välkommen till evigheten, 2022), trad. du suédois Anna Postel, Calmann-Lévy (Noir), 2023
Un Cri sous la glace

Est-il nécessaire d’orthographier le titre de ce roman de Camilla Grebe (née en 1968), Un Cri sous la glace, avec un ø ? Une idée de l’éditeur pour indiquer le caractère nordique de l’enquête ? L’éditeur qui ignore que le ø figure dans l’alphabet norvégien et danois mais pas suédois, où s’emploie le ö, moins symbolique, certes ? Cette remarque énoncée, affirmons que Un Cri sous la glace n’est pas du tout un mauvais roman. Il commence par la découverte d’un corps, celui d’une jeune femme, dont la tête a été séparée du tronc. Le crime a eu lieu chez un homme d’une quarantaine d’années, aux commandes d’une riche entreprise de mode (qui n’est pas sans rappeler H & M). L’enquête est menée par différents policiers de Stockholm, dont Peter Lindgren, qui retrouve pour l’occasion la profiler Hanne, avec laquelle il a eu une aventure une dizaine d’années plus tôt. Le roman est bien conçu, mais comme souvent, la folie permet d’expliquer nombre d’actes sinon difficilement compréhensibles : « Maman, tu dois me dire la vérité… Est-ce qu’il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ? » Rappelons que Camilla Grebe avait déjà signé avec Åsa Träff, sa sœur, Ça aurait pu être le paradis (Le Serpent à plumes, 2010), un roman policier plutôt réussi.
* Camilla Grebe, Un Cri sous la glace, (Älskaren från huvudkontoret, 2015), trad. Anna Postel, Calmann-Lévy, 2017
Le Journal de ma disparition

Le Journal de ma disparition de Camilla Grebe fait suite à Un Cri sous la glace, bien que les deux titres puissent se lire indépendamment. Dans la petite ville fictive de Ormberg, quelque part en Suède, vers Katrineholm, Hanne, une profileuse de la police de Stockholm, est retrouvée, errant dans les bois, sa mémoire en grande partie perdue. Peter, son compagnon, a disparu. Quel rapport avec la fillette enterrée à cet endroit quelques années plus tôt ? C’est ce que va s’employer à comprendre Malin, policière qui habitait autrefois à Ormberg. « Tout se concentre ici, près d’un vieux tas de pierres au milieu des bois. Cela doit avoir un sens, mais lequel ? » Quelque part entre, disons, Håkon Nesser et Kjell Eriksson, Camilla Grebe nous convie là dans une enquête au rythme rapide. Dommage de trouver ce genre de remarques qui tuent : tel personnage porte « ...un jean du style de ceux qu’on achète au supermarché qui jouxte l’autoroute, à mi-chemin vers Katrineholm ». Faut-il se vêtir dans les magasins de luxe du centre des capitales pour bénéficier du regard bienveillant de Camilla Grebe ? Mais sans doute ne convient-il pas de s’arrêter à ce détail, car de la bienveillance, Camilla Grebe en manifeste jusque pour l’assassin : »...J’ai beau savoir qu’il est un monstre, je ne peux m’empêcher d’éprouver pour lui de la pitié ». Un bon roman, incontestablement, inscrit dans son époque et avec des personnages bien dessinés et une intrigue crédible.
* Camilla Grebe, Le Journal de ma disparition (Husdjuret, 2017), trad. Anna Postel, Calmann Lévy (Noir), 2018
L’Horizon d’une nuit

« Un jour : une mère, un père, des enfants. Le lendemain : une scène d’accident, il ne reste que les débris de ce qui fut une famille. » Dans L’Horizon d’une nuit, Camilla Grebe relate la disparition d’une adolescente dans une famille qui, jusqu’à ce jour terrible, semblait tout à fait comme les autres. Certes, il s’agit d’une famille recomposée : Maria est la mère de Vincent, un enfant trisomique de dix ans, et son compagnon, Samir, est le père de Yasmin, une adolescente qui n’en fait qu’à sa tête. Certes, Samir est d’origine arabe, mais est-il pour autant musulman ? Et même s’il l’était, cela ne signifierait pas qu’il ait voulu imposer sa volonté à sa fille et, faute d’y parvenir, qu’il l’ait tuée. L’enquête démarre et l’engrenage se met en place. Samir est arrêté, puis inculpé de meurtre. Passe en procès. Est acquitté, faute de preuves, ce qui suscite la désapprobation d’une bonne partie de la population. Le récit est relaté par l’un et l’autre personnage. D’abord Maria ; puis Vincent ; puis, vingt ans plus tard, par Gunnar Wijk, l’un des policiers qui ont mené l’enquête ; puis Yasmin et enfin Maria. À chaque vision nouvelle surgissent des éléments nouveaux, qui font que l’enquête prend une tournure inattendue et que les certitudes qui s’étaient laborieusement établies volent en éclats. De rebondissement en rebondissement, la vérité se fait, tragique. Les relations complexes entre les personnages n’en finissent pas d’évoluer : entre Maria et Samir, entre Yasmin et Samir, entre Gunnar et Maria, etc. Un excellent roman policier qui, outre l’intrigue bien menée, donne à réfléchir sur des problèmes contemporains.
* Camilla Grebe, L’Horizon d’une nuit (Alla ljuger, 2021), trad. Anna Postel, Calmann-Lévy (Noir), 2022
L’Ombre de la baleine
Bourré d’invraisemblances, ce roman de Camilla Grebe, L’Ombre de la baleine, est pourtant agréable à lire. Tout commence quand un grand gamin se retrouve embringué dans une histoire de drogue, avec de méchants dealers. Sa maman a découvert son trafic et jeté à la poubelle, purement et simplement, les sachets de cocaïne destinés à la revente qu’elle a trouvé dans ses affaires. Pour échapper à la colère des dealers, Samuel n’a plus qu’à prendre le vert. Mais là où, par le plus grand des hasards, il trouve refuge, l’attend une femme qui va vite se révéler étrange et peut-être mêlée à ses malheurs. Les coïncidences sont un peu trop nombreuses (cf. Afsaneh, la femme de Manfred, l’enquêteur, qui visionne un site sur Internet justement animé par...!), mais comme tout est traité avec légèreté, on y croit presque. On apprécie même la mise en garde lancée par plusieurs personnages sur le narcissisme développé par Internet : le nez sur l’écran, nous ne prêtons plus attention aux événements qui affectent nos concitoyens. Comme dans ses précédents romans (Un Cri sous la glace, Le Journal de ma disparition), Camilla Grebe livre là un polar aussi bien conçu que gentillet, avec un inspecteur principal qui ne se creuse pas plus la tête que nécessaire : « J’avais appris à écouter (…) et je cultivais une image de marque selon moi irrésistible, caractérisée par le cynisme, le pessimisme et un humour laconique. J’avais aussi entamé ma longue histoire d’amour avec les costumes de luxe. » Du bon divertissement.
* Camilla Grebe, L’Ombre de la baleine (Dvalan, 2018), trad. Anna Postel, Calmann-Lévy (Noir), 2019
La Fille-renard

Tiret ou pas dans le titre ? La Fille renard, comme indiqué en couverture, ou La Fille-renard, comme en pages intérieures ? Un détail ? Ce roman de Maria Grund (écrivaine et scénariste, née en 1975), La Fille-renard, prend une île imaginaire pour cadre – il est facile de reconnaître Gotland, où l’auteure a vécu, et la ville de Visby. Sanna Berling et Eir Pedersen, les deux enquêtrices principales, sont confrontées à la mort d’une adolescente, apparemment un suicide, puis à celle d’une vendeuse de livres anciens. Qu’est-ce qui pourrait les relier, comme certains éléments semblent l’indiquer ? L’enquête s’oriente vers les agissements des membres d’une secte. Du déjà lu cent fois. Les considérations vaguement politiques entre deux découvertes de cadavres fleurent le populisme : « On fait face au déchirement du tissu social de notre île tous les jours. On accueille les exclus les bras ouverts. On patauge dans la boue depuis que des hommes politiques incompétents ont fait leurs petites expériences chez nous. On rattrape ceux qui dégringolent à droite et ceux qui perdent pied à gauche. » Comme dans de nombreux autres romans policiers, la folie, agrémentée ici de délires liés à la foi et de références religieuses, va expliquer l’atrocité des crimes commis. « Donc, tu crois qu’on a des rituels occultes sur les bras ? Et un tueur en série ? » Ce sera suffisant comme mobile. « Elle a rassemblé toutes les pièces du puzzle. » Tout est là, c’est un roman bien construit avec des personnages facilement identifiables, mais sans guère d’intérêt.
* Maria Grund, La Fille-renard (Dödssynden, 2020), trad. Cecilia Klintebäck, Robert Laffont (La Bête noire), 2023
Le Diable danse encore
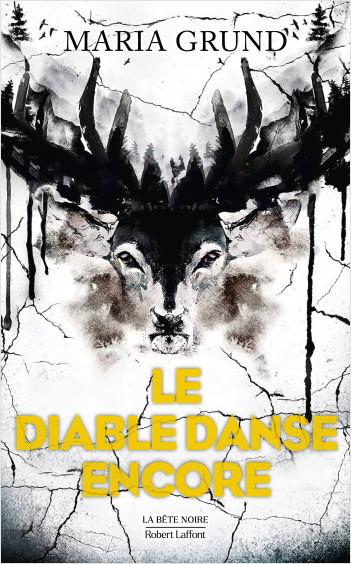
Après La Fille-renard, voici Le Diable danse encore de Maria Grund. L’action se situe de nouveau sur une île suédoise, on ne sait pas son nom, juste qu’il s’y trouve « des centaines de bunkers militaires abandonnés », dans un présent qui peut aussi être un futur proche : sur le continent en proie à la guerre, « des maisons brûlent, et les civils essaient de se défendre. Les organisations humanitaires sont repoussées. » Gotland ? Ici, tout est plus calme et pourtant... Eir Pedersen (chère Eir, tes parents ne t’ont jamais expliqué qu’il ne fallait pas dire des gros mots comme « putain » à tire-larigot ?) est appelée à enquêter sur un jeune homme qui a été retrouvé en train de mourir dans une grange. Sanna Berling se joint à elle. Se pourrait-il qu’une bande d’adolescentes circulant à cyclomoteur ou à quad soit responsable de l’agression ? Ou bien Jack Abrahamsson, meurtrier dans le précédent volume et jamais arrêté, a-t-il décidé de sévir de nouveau, de se venger ? L’enquête les mène dans un bunker, repaire peut-être d’un survivaliste. Dans ce roman (très féminin avec les divers personnages liés à l’enquête), il ne se passe pas grand-chose, les relations entre policiers sont peu crédibles, ce n’est vraiment pas passionnant. Quant au titre français, Le Diable danse encore, il frise le ridicule. Bouh !
* Maria Grund, Le Diable danse encore (Dödsdansen, 2022), trad. du suédois Cecilia Klintebäck, Robert Laffont (La Bête noire), 2024
Mör

Mör débute comme il se doit par la découverte du cadavre atrocement mutilé d’une femme, sur les berges d’un lac près de Halmstad, en Suède. Meurtre qui ressemble étrangement à ceux attribués à un serial-killer qui purge actuellement une peine de détention dans une clinique en Angleterre. Plusieurs policiers enquêtent, assistés de la profileuse Emily Roy et de l’écrivaine Alexis Castells, déjà rencontrées dans Block 46, le premier roman de la française Johanna Gustawsson. Remarquons les dialogues très envoyés, qui pourraient faire leur effet au cinéma, et surtout les nombreux détails sordides pour décrire les crimes, manière de procéder très à la mode aujourd’hui. « Si vous voulez que je vous donne tous les noms des femmes que nous avons kidnappées, étranglées, frites, bouillies, panées, rissolées, pochées et fait mijoter depuis plus de trente ans, il va falloir que vous nous proposiez quelque chose en retour… » Quand un serial-killer s’inspire de Jack l’éventreur, le plus illustre de ses prédécesseurs… ! Ou… si, si, du roman Les Frères Cœur de Lion d’Astrid Lindgren !
* Johana Gustawsson, Mör, Bragelonne (Thrillers), 2017
Sång
Le mot « sang » écrit de cette façon – Sång – prétendument à la suédoise, n’a aucun sens, mais le roman de Johana Gustawsson vise à être divertissant et rien de plus. Les parents et la sœur de la jeune analyste de Scotland Yard, Aliénor Lindbergh, sont retrouvés sauvagement assassinés près de Falkenberg. Voilà une enquête pour Emily Roy et Alexis Castels. Le couple Lindbergh dirigeait une clinique dans laquelle étaient réalisées des PMA. Un couple de clients malheureux se serait-il vengé ? Aliénor était-elle visée ? L’histoire se mêle à l’enquête et Johanna Gustawsson emmène le lecteur en Espagne, sous le franquisme et ses atrocités. « Chacun contemplait son deuil, en invitant ceux qui n’étaient plus là ; en piochant un souvenir et en le revisitant jusqu’à la douleur, pour faire exister les absents à la limite de la vie, là où l’on peut encore se rappeler leur odeur, leur rire et leur joue contre ses lèvres. » Autant de bons sentiments que des coïncidences (ah, ces deux sœurs espagnoles dont l’une est donnée pour morte, mariées, sans le savoir, chacune à un Suédois !) La chanson de Lluís Llach, L’Estaca, mentionnée – bravo, surtout en ces temps où les nostalgiques du franquisme pleurent après la tombe errante du Caudillo. Mais est-ce suffisant pour faire de ce livre, Sång, un bon roman policier ?
* Johana Gustawsson, Sång, Bragelonne (Thriller), 2019
La Femme secrète
Un roman policier, La Femme secrète ? Un roman d’aventure, plutôt, car l’intrigue est riche de rebondissements divers et la police n’a qu’un rôle secondaire. Louise est restauratrice sur l’île de Christiansø, près de celle de Bornholm, et vit depuis deux ans et demi avec Joachim, un écrivain. Lorsqu’un homme fait irruption en l’appelant Hélène et qu’il prétend être son mari, elle affirme ne pas comprendre. Mais la police est avisée et les faits vont s’imbriquer inéluctablement. « Elle n’est rien en elle-même, elle est la personne la plus affreusement dénuée d’identité au monde… » Serait-elle, comme l’affirme Edmund, cet homme qui se dit son époux, une riche héritière mère de deux jeunes enfants ? Pourquoi a-t-elle perdu la mémoire ? La Femme secrète serait-elle « …une histoire de grand amour déçu » ? Signé Anna Ekberg (pseudonyme de Anders Rønnow Klarlun et Jacob Weinreich qui ont déjà utilisé conjointement le pseudonyme de A. J. Kazinski), ce roman commence bien mais l’intrigue nous semble beaucoup trop dense, avec ces deux enquêtes parallèles menées et par Louise et par Joachim. « C’est à la fois une histoire de disparition et une énigme. » Ajoutons que Joachim reçoit des coups, beaucoup de coups, et se remet toujours étonnamment vite sur ses jambes. Il y a des règles dans l’écriture d’un thriller, c’est vrai, mais quel dommage que les auteurs ne s’en libèrent pas plus. Les bagarres et les rebondissements nuisent à la lecture d’un roman que nous pourrions classer, sinon, parmi ceux de bien bonne qualité. Mais sans doute s’agit-il plutôt d’un scénario – comme, au demeurant, les deux titres précédents signés A. J. Kazinski. (Pour l’anecdote, relevons les diverses allusions, ici, au tout premier polar au monde, Le Prêtre de Vejlbye du Danois Steen Steensen Blicher.)
* Anna Ekberg, La Femme secrète (Den Hemmelige kvinde, 2016), trad. Hélène Guillemard, Le cherche midi (Thrillers), 2017
L’Archipel des larmes
Dans L’Archipel des larmes, Camilla Grebe n’est pas tendre avec ses héroïnes. À peine a-t-on eu le temps de faire connaissance avec l’une d’elles, que celle-ci disparaît, affreusement assassinée ! Des policières, qui plus est. Mais une femme a-t-elle sa place au sein de la police, dans cette Suède des années 1940, 1950 et après ? Non ! C’est tout au moins l’avis d’un commissaire bourré de préjugés, et ce que pensent également la plupart de ses collègues et de leurs successeurs. Des meurtres ont lieu, des femmes, toujours des femmes seules, avec un enfant, quelque part dans une banlieue inventée de Stockholm. Les enquêteurs sèchent. Il s’agit-là assurément d’un excellent roman policier, de loin le meilleur dans ceux qu’a signés Camilla Grebe, dont le ton n’est pas sans rappeler le roman de Sara Lövestam, En mémoire de toi. Les deux livres sont forts différents, En mémoire de toi n’est pas du tout un roman policier, mais il y a une approche semblable, cette attention, au travers de l’histoire et d’une intrigue prenante, portée aux femmes de milieux peu aisés. L’Archipel des larmes est un roman féministe, en ce sens qu’il porte en exergue le sort malheureux fait au soi-disant « sexe faible » : par un assassin, mais pas seulement. « Le pire, c’est de ne pas savoir qui il est. Ça pourrait être n’importe qui. Le vieux monsieur qui promène son basset boiteux sur la place Nytorget, un voisin, un collègue (…). Tous les hommes sont l’Assassin des bas-fonds... » Notons les clins d’œil de Camilla Grebe à ses confrères du roman policier : ses enquêteurs se nomment Holm, Sjöwall, etc. S’il n’y avait qu’un roman policier en provenance de Suède à lire, en cette année 2020, ce pourrait être celui-ci. (Regrettons juste, de nouveau, cette orthographe fantaisiste pour le titre : L’Archipel des lärmes, destinée à faire plus nordique !)
* Camilla Grebe, L’Archipel des larmes (Skuggjägaren, 2019), trad. Anna Postel, Calmann Lévy (Noir), 2020




