Histoire
Un Archevêque venu du froid
Traductrice et spécialiste des Pays nordiques (et notamment de l’écrivain August Strindberg, auquel elle a consacré deux ouvrages), Elena Balzamo avait déjà annoté Carta marina 1539 de Olaus Magnus (1490-1557) publié en France en 2005. Elle nous parle de nouveau de cet « archevêque venu du froid » dans son dernier ouvrage, nous permettant ainsi de mieux faire connaissance avec ce personnage, un puits de science de son époque, « dont aucun portrait ne nous est parvenu », qui réalisa la première carte topographique de la Scandinavie (1539). « Première représentation de l’Europe du Nord à l’époque moderne, la Carta marina ne constitue pas uniquement un grand pas en avant de la cartographie, c’est une contribution importante aux domaines aussi variés que la géologie, l’économie, l’histoire, l’ethnologie, etc. » Avec une érudition constante et au travers de huit chapitres, précédemment des essais parus ici ou là, Elena Balzamo explique comment cette carte a pu arriver jusqu’à nous, donnant parfois à son ouvrage des allures de roman policier. « Grande comme elle est (1,25 X 1,70 m), la Carta marina fourmille d’images : êtres humains, animaux, monstres, édifices divers, bateaux, images de guerre, images de paix, sobres pictogrammes et véritables histoires en images qui font penser à des bandes dessinées. » Approchant l’œuvre sous des jours variés (« La fortune littéraire des frères Magnus ou les enjeux de la traduction », « Olaus Magnus savait-il dessiner », « L’enfer réhabilité : la Laponie et ses habitants », etc.), elle indique pourquoi celle-ci, cinq siècles après, reste exceptionnelle. N’alliait-elle pas véridicité des informations et affabulations propres à l’époque ? Et luttant contre le schisme en cours, Olaus Magnus ne se livre-t-il pas, de façon assez surprenante, à une réhabilitation des Lapons, les comparant aux Italiens dès que l’occasion lui en est donnée ? Cette carte, qui n’est parvenue jusqu’à nous qu’aux prix de nombreuses tribulations, nous en apprend beaucoup sur une région du monde excentrée – plus l’on montait vers le Nord, plus l’étrangeté était censée se manifester. Mené comme une enquête, l’ouvrage d’Elena Balzamo est très intéressant.
* Elena Balzamo, Un Archevêque venu du froid, L’Harmattan, 2019
Alfred Nobel, inconnu célèbre

Personnage ambigu, Alfred Nobel (1833-1896), puisque à la tête d’usines d’armements en divers endroits du globe et, « à la fin de sa vie (…), plus que jamais tourné vers des projets militaires » et pourtant, pacifiste convaincu, voire prosélyte ; et léguant la majeure partie de sa fortune pour la création de cinq prix, dont celui de la Paix, remis chaque année à Oslo. Grand spécialiste des Pays nordiques Jean-François Battail (né en 1939) ne manque pas de s’en étonner dans la biographie qu’il lui consacre, Alfred Nobel, inconnu célèbre, rappelant « la créativité de cet homme qui possédait à sa mort 355 brevets d’inventions dans de nombreux pays ». Une biographie passionnante, mais par trop synthétique, qui aurait assurément gagnée à être plus linéaire, car l’auteur, après avoir retracé à grands traits la vie du père de la dynamite, revient sur différents aspects de sa personnalité (« le bâtisseur d’empire », « Nobel et la France », « poète, humaniste et philosophe », etc.), ce qui entraîne pas mal de redites. Si le rôle de Bertha von Suttner dans le parcours intellectuel de Nobel est affirmé, on peut tout de même regretter qu’il n’y ait qu’une mention de leur importante correspondance, pourtant publiée récemment en français (cf.Correspondance entre Alfred Nobel et Bertha von Suttner, édition établie et introduite par Edelgard Biedermann, Turquoise, Le temps des femmes, 2015), car elle permet de comprendre leur attachement (elle faillit devenir sa gouvernante, mais rentra en Autriche pour se marier, après une semaine passée auprès de lui ; ils ne se perdirent néanmoins plus de vue) et le rôle qu’elle joua dans la décision de Nobel d’attribuer, dans son testament, un important prix en faveur de la paix. Militante pacifiste, auteure d’un roman qui eut un grand succès (Bas les armes !, 1889, disponible en français), Bertha von Suttner (1843-1914) reçut elle-même ce prix en 1905. Si elle ne fut pas la compagne d’Alfred Nobel, on peut la considérer comme son égérie. Nombre de biographies ou de travaux biographiques, en suédois, en anglais, en français et dans d’autres langues, existent aujourd’hui sur Alfred Nobel, homme au caractère paradoxalement aussi trempé qu’effacé, ses inventions et ses prix. On peut penser qu’il fut emporté très tôt par sa lignée (il s’éleva ensuite avec force contre l’héritage), et qu’il n’eut pas forcément le destin qui aurait pu être le sien dans un milieu non d’entrepreneurs, mais d’artistes, par exemple. « ...Les livres étaient la patrie immatérielle de ce cosmopolite », rapporte Jean-François Battail. Libre penseur, défenseur de l’égalité des hommes et des femmes, mais aussi de tous les individus, quelles que soient leur couleur de peau ou leur origine sociale, partisan de l’abolition des frontières et à ce titre Européen avant l’heure, il lui arriva même de se dire anarchiste. « Ma patrie est là où je travaille, et je travaille partout. » Quelques réserves énoncées, l’ouvrage de Jean-François Battail constitue une bonne présentation d’un personnage effectivement aussi célèbre qu’inconnu.
* Jean-François Battail, Alfred Nobel, inconnu célèbre, Sorbonne université presse (Essais), 2018
Elmar Krusman, Un Suédois d’Estonie au camp de concentration du Struthof

Depuis des temps reculés, une petite communauté suédoise vit sur la côte nord-ouest de l’Estonie, à l’ouest de Tallinn – ou surtout vivait, car les survivants ont quasiment tous émigré en Suède au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Comptant quelque 8 000 membres, soit moins d’un pour cent de la population, au début du conflit, elle se retrouva prise en tenaille entre l’URSS et l’Allemagne qui occupèrent tour à tour le pays, sur fond de volontés indépendantistes de l’État estonien. Esto-Suédois né en 1921, tailleur de formation et imprimeur, Elmar Krusman fut arrêté (« fin septembre ou début octobre 1941 »), sans guère de raison sinon qu’il aurait peut-être assisté à un meeting communiste et peut-être, peut-être seulement, été membre d’un groupe de résistants. Une dénonciation ? Il transita par divers camps de concentration, avant de se retrouver dans celui de Bisingen, annexe du camp de Natzweiler, dit le Struthof, sur le territoire français, dans les environs de Strasbourg. Professeur d’histoire et de géographie dans le secondaire, Nils Blanchard (né en 1976), lui-même d’origine suédoise par sa mère, tente ici de retracer le parcours de cet homme, dont il a découvert par hasard l’existence. Il ne tait pas son courroux devant le degré d’inhumanité du nazisme et de ceux, à l’instar de « l’autre ignare », qui, récemment ou aujourd’hui, tentent d’en minimiser les crimes, parlant de « détails ». « ...D’origine suédoise, visitant régulièrement en tant que professeur (nommé en Alsace) le camp du Struthof avec mes classes, me penchant sur ses statistiques pour préparer mon cours, je ne pouvais pas passer à côté du nom d’un déporté suédois sans chercher à en savoir plus sur son sort. » C’est aussi l’existence d’une paisible communauté de pêcheurs mise à mal par ce que l’on appelle les soubresauts de l’histoire que Nils Blanchard relate. Une toute petite page de l’histoire, chargée de tant de malheurs. Puisque la mémoire permet seule de contrer la mort. À partir d’un cas particulier, un ouvrage finalement essentiel.
* Nils Blanchard, Elmar Krusman, Un Suédois d’Estonie au camp de concentration du Struthof, L’Harmattan (Seconde Guerre mondiale), 2021
Parmi les prisonniers de guerre en Russie et en Sibérie, 1914-1920
Fille d’un haut diplomate suédois, née à Saint-Pétersbourg, Elsa Bränström (1888-1948) relate dans ce livre écrit en 1921, Parmi les prisonniers de guerre en Russie et en Sibérie, 1914-1920, son engagement, au sein de la Croix-rouge suédoise, aux côtés des prisonniers vaincus de la Première Guerre mondiale : les « neutres » scandinaves s’efforcèrent, en effet, d’améliorer leurs conditions de vie. Si elle souligne, à juste titre, que nombre de femmes russes de la haute société ont eu du mal à se salir les mains dans les hôpitaux, n’y faisant qu’un bref passage pour pouvoir s’en vanter après, elle n’est elle-même pas exempte de préjugés. « On se demandait instinctivement d’où venait cette force chez des hommes tombés en captivité qui luttaient contre la mort. Elle émanait en vérité de la source intérieure des peuples de haute culture, qui élève l’homme au-dessus de son environnement. » Les prisonniers des Puissances centrales (allemands, austro-hongrois, turcs ottomans, bulgares) dont parle Elsa Bränström faisaient ainsi preuve de plus de courage que les autres ? Bon ! Même genre de remarque avec le dilemme censé animer les Baltes : « Dans le conflit entre le devoir envers la Russie et l’amour de leurs frères allemands, c’est le sens germanique du devoir qui triompha » : il était du devoir des Baltes de se battre pour la Russie. Nulle remise en cause de la guerre, ici, de ses motifs. Les États se combattent et envoient leur valetaille s’entretuer, quoi de plus logique. Heureusement que de bonnes âmes passent derrière, nettoyer les champs de bataille. Vision agaçante, qui donne toutefois son intérêt à ces mémoires. On ne saurait les taxer d’être en déphasage avec leur époque. Elsa Bränström présente les différents lieux où les blessés sont soignés, souvent dans des conditions déplorables, voire atroces. Le voyage à destination de la Sibérie est équivalent à une guerre. « Les conditions insalubres et le froid hivernal auquel les prisonniers n’étaient point habitués causaient souvent, durant le voyage, gelures et maladies. (…) Lorsque quelqu’un mourait, son cadavre restait dans le wagon... (…) Pendant des mois, les prisonniers ne pouvaient se laver ; la vermine devint ainsi un fléau de plus en plus considérable. » Elle montre l’incurie des dirigeants, l’incompétence, souvent, des médecins et autres chirurgiens et, en contrepartie, le dévouement de ses collègues, dont nombre de femmes dont le courage ne faiblissait pas. « La faim et le froid, les mauvais traitements et les humiliations eurent raison des forces de bien des soldats et les conduisirent de la prison à l’asile d’aliénés ou au cimetière. » Témoignages comme il en existe peu, de l’arrière, ces mémoires offrent un spectacle de la guerre sans bravoure aucune – le réalisme est à ce prix. Précieux document.
* Elsa Bränström, Parmi les prisonniers de guerre en Russie et en Sibérie, 1914-1920 (Unter kriegsgefangenen in Russland und Sibirien, 1914-1920), trad. de l’allemand Marine Bastide ; préface à l’édition française Per Allan Olsson, Turquoise (Le temps des femmes), 2019
La Reine Christine et ses fictions

Il y a des personnages historiques plus intéressants que d’autres. Loin des fastes affectionnés par les têtes couronnées, la reine Christine de Suède (1626-1689) a laissé des traces dans les mémoires pour des raisons qui méritent, encore aujourd’hui, d’être observées avec attention. Mais... une femme, cette reine qui ne se comporte qu’à sa guise, se moquant des usages protocolaires, et s’habille de manière masculine ? Qui se préoccupe d’alchimie, « science » alors réservée aux hommes ? Qui recherche la compagnie des érudits plus que celle des guerriers ? Qui lit, rencontre des savants, est capable d’échanger avec eux ? Qui répudie sa religion pour embrasser le catholicisme, qu’elle juge, peut-on penser, plus libéral ? Les livres à son sujet ne se comptent plus, tous plus ou moins à caractère historique, du XVIIe siècle à aujourd’hui, traçant un portrait d’elle quelquefois bien hasardeux. August Strindberg lui a consacré un drame, Kristina, comme le rappelle Annie Bourguignon (« un drame déconcertant ? »). « Mon plus beau travail », selon Strindberg lui-même. L’écrivaine Sara Stridsberg la met en scène dans Dissection d’une chute de neige. On se souvient de l’actrice suédoise Greta Garbo endossant (trop) magistralement le rôle de la reine Christine dans le film éponyme (de Rouben Mamoulian, 1933). Christine Vasa est orpheline à six ans et, dès sa majorité, à la tête de la Suède, elle s’émancipe de ceux qui prétendent la mettre sous tutelle. Jean-François de Raymond relate cette période et le parcours d’une reine qui entendait être considérée comme un homme et discuter directement avec le philosophe René Descartes (qui mourra de froid à Stockholm !). D’autres auteurs traitent – divers articles – de son androgynie supposée (cf. notamment la pièce du Québécois Michel Marc Bouchard, Christine, la reine-garçon et le film, en 2015, de Mika Kaurismäki, The Girl King) ou de l’étiquette « amazone » qu’on lui a accolée – cf. l’article de Natacha Aprile, « Androgynie et construction de l’ambiguïté chez Christine de Suède ». Ses prises de parole surprennent ses contemporains. Elle ne laisse pas indifférent, son érudition la protège au moins autant que son statut et elle ne manque pas d’en profiter. Elle œuvre ainsi pour le théâtre et la musique à Rome, où ses pérégrinations l’amènent. Dans cette ville, lors du carnaval, une « course aux Juifs » se tenait. « Un groupe de Juifs était contraint de courir, créant la confusion dans la foule », explique Anna Zilli dans son article « La Reine Christine, mécène musicale à Rome », ajoutant : « une telle tradition ne fut jamais du goût de Christine, qui s’en plaignit à plusieurs reprises dans l’espoir d’y mettre fin. » Quant à George Zaragoza, il insiste dans son article intitulé « Le roi Christine » (puisque ainsi a-t-elle été sacrée monarque en Suède) sur son tempérament hors normes : « Christine de Suède possédait d’évidence le caractère exceptionnel (…) pour être promue personnage de théâtre ». Dans son article déjà mentionné, Annie Bourguignon s’interroge : « Que dire (…) du désir exprimé par Kristina de promouvoir la culture en Suède, et surtout de détourner son peuple et ses dirigeants de leur intérêt presque exclusif pour la guerre ? » La reine Christine, précurseure de la neutralité suédoise ? Cet ouvrage, La Reine Christine et ses fictions, ne peut que réjouir les amateurs d’histoire interprétée par des individus iconoclastes. Pièces de théâtre, opéras, harangues, romans, poésie, libelles, etc. : les multiples textes dans lesquels la reine apparaît montrent l’ampleur intellectuelle du personnage et tous vantent sa probité. Sa place d’exception dans l’histoire ne s’est jamais démentie. Au-delà de la légende, La Reine Christine et ses fictions livre le récit d’une femme que nous caractériserions aujourd’hui, sans que ce soit du tout péjoratif, d’un peu déjantée (dans la lignée à venir des Fifi et autres Lisbeth Salander), qui a tenu tête à son époque et dont il peut toujours être utile de s’inspirer. Notons que l’ouvrage se clôt par un appel autour du nom de Christine de Suède : « Et si l’Europe, pour sa culture, se dotait d’un symbole fort ? » « Une culture faite de tolérance et de liberté » dont elle pourrait être la figure emblématique.
* Collectif, La Reine Christine et ses fictions (sous la direction de Florence Dix et Corinne François-Denève), Éditions Universitaires de Dijon (Écritures), 2022
Les Suédois en Ukraine

« Au tout début du XVIIIe siècle, l’hetman Mazeppa (…) fait appel à Charles XII, roi de Suède, pour assurer l’indépendance de l’Ukraine contre le tsar envahisseur Pierre Ier de Russie », est-il écrit en quatrième de couverture du livre de Erik Egnel, Les Suédois en Ukraine. Et l’auteur de rappeler, fort opportunément, que « les Suédois, sous le nom de Varègues, les Vikings de l’Est, ont été les fondateurs du premier État ukrainien moderne, la Rus’ (ruotsi qui est ‘suédois’ en finnois)... » Erik Egnell (né en 1939, ancien conseiller commercial dans divers pays et fondateur des éditions Cyrano), dont les grands-parents étaient Suédois, aujourd’hui « rendu très malheureux par la guerre de Poutine », conte, après Voltaire (cf. son Histoire de Charles XII et son Histoire de l’empire de Russie sous Pierre le Grand), les menées des Suédois pour s’implanter sur cette terre lointaine. Jusqu’à la célèbre bataille de Poltava (1709) qui fit perdre définitivement à la Suède sa place de grande puissance militaire en Europe. Pourtant, rappelle Erik Egnell, l’Ukraine aurait pu obtenir son indépendance bien avant 1991, puisque Charles XII l’avait proposée. Bien évidemment, son étude documentée (avec des cartes, notamment sur « l’expansion russe » au fil des âges) prend une résonance particulière après l’invasion russe de l’Ukraine et les menaces qui pèsent sur les pays voisins de la Russie. Soulignons que Pierre le Grand, digne précurseur de Staline, est le modèle affirmé de l’autocrate au pouvoir à Moscou aujourd’hui. « Le lecteur remarquera (…) que le drapeau suédois et le drapeau ukrainien ont les mêmes couleurs. On ne renie pas ses origines. » Un petit ouvrage très intéressant pour mieux comprendre une page agitée de l’histoire contemporaine.
* Erik Egnell, Les Suédois en Ukraine, Cyrano, 2022
Le Canal de Göta

Justement sous-titré « Projet technique et pouvoirs en Europe du Nord (1790-1832) », ce livre, Le Canal de Göta, de Thomas Gauchet, présente l’histoire du « ruban bleu de la Suède » (Sveriges blå band) qui relie la mer du Nord à la mer Baltique. Pourquoi et comment l’idée d’une liaison par voie d’eau s’est-elle imposée à la monarchie suédoise et à l’aristocratie marchande de l’époque ? Un premier canal a été construit entre Göteborg, Tröllhatan et le lac Vänern, avant d’être poursuivi à l’est vers le lac Vättern, puis de desservir la côte après Söderköping. Le maître d’ouvrage, l’ingénieur Baltzar von Platen, est obligé de tenir compte du contexte politique. Le roi Gustav IV est destitué en 1809, après avoir perdu la Finlande, et le nouveau pouvoir ne perçoit pas forcément l’intérêt de cet axe économique pourtant à même d’« unifier la nation ». Son successeur, Charles XIV, saura jouer, lui, de cette « démonstration de l’unité du royaume autour d’un régime politique et d’une dynastie », attribuant à l’armée, puisque des soldats sont réquisitionnés pour la construction, un rôle non plus guerrier mais pacifique. Dès les premières décennies du XIXe siècle, la Suède affiche sa neutralité et sa volonté de progrès social. Le pays n’est plus à cheval sur la Baltique avec des possessions éparpillées aux alentours, mais associé à la Norvège et centré sur les Alpes scandinaves. « L’instrument d’un renouveau commercial », que pourrait être le canal, achève de convaincre les récalcitrants. Le Göta kanal devient un véritable enjeu national, qui s’accompagne de la création de centres d’apprentissage à divers métiers. « La fondation de l’atelier mécanique de Motala (…) bouleverse profondément la manière dont la direction du canal mais aussi les autorités politiques et scientifiques, nationales et internationales, perçoivent l’espace suédois. » La Suède devient une terre potentiellement industrielle, reconnue par ses voisins, Grande-Bretagne et Allemagne au premier rang, mais aussi plus lointains, comme les États-Unis. « Dans le contexte culturel et politique du romantisme, cette éclosion d’une ingénierie indigène est célébrée comme l’affirmation d’une science nationale, profondément en lien avec le territoire », observe encore Thomas Gauchet (par ailleurs directeur de la culture au sein du Conseil département de l’Oise) dans cet ouvrage, initialement une thèse, remarquablement documenté. La mise en perspective de ce projet industriel et économique qui a totalement remanié le paysage de plusieurs régions suédoises avant, et très rapidement, d’être supplanté par le chemin de fer, est passionnante, tant elle montre les imbrications entre les différents pouvoirs d’alors. Le Göta Kanal fait aujourd’hui « partie de l’iconographie nationale ». Un livre indispensable pour mieux connaître l’histoire de la Suède.
* Thomas Gauchet, Le Canal de Göta, Presses des Mines, 2021
Le Modèle suédois

En exergue de son livre, Le Modèle suédois, Wojtek Kalinowski, co-directeur de l’Institut Veblen pour les réformes économiques, place une dédicace à Olof Palme. Peut-être est-il temps, en effet, de souligner combien l’action politique du Premier ministre assassiné a été importante. S’inscrivant dans une démarche entreprise une cinquantaine d’années plus tôt avec Hjalmar Branting, elle a permis à la Suède d’offrir à tous ses habitants un confort de vie inégalé sur le reste de la planète, pays nordiques à part (« la Suède devenant l’emblème d’un modèle nordique ou scandinave plus large »). Il n’est pas inutile de le rappeler, et c’est ce que fait l’auteur dans ce court essai, s’efforçant de montrer que la social-démocratie n’est pas morte, quoi qu’en disent les partisans d’un libéralisme effréné – tout au moins en Suède. Longtemps, « l’économie n’y était pas un but en soi mais le moyen d’une profonde transformation sociale ». Citant un certain nombre de réussites dans divers domaines (l’économie, l’environnement, les droits sociaux, la citoyenneté et l’égalité des individus…), l’auteur note que « le modèle suédois, c’est aussi la qualité de l’action publique, ou de la gouvernance démocratique… » Si la social-démocratie a tenu tant d’années au pouvoir, c’est avant tout parce qu’elle respecte certains grands principes qui s’inscrivent dans l’Histoire et la mentalité des Suédois. Pourtant, « la spirale de la défiance et du retrait vers les solutions privées n’est jamais très loin dans une société plus inégalitaire et plus divisée. Car c’est bien ce qu’est devenue la société suédoise au terme de vingt années (ces vingt dernières années, NDA) de transformations économiques et sociales ». Le Modèle suédois est un essai intéressant, qui va à l’encontre d’idées reçues. Non, la Suède ne renonce pas tout à fait à ce qui a longtemps fait sa spécificité, la social-démocratie, mais pas une social-démocratie comme on l’entend ici, qui n’est qu’une variante du libéralisme. Une social-démocratie dont le but est toujours cette société de bien-être (« État social universel ») chère au cœur de la majorité des Suédois.
* Wojtek Kalinowski, Le Modèle suédois, Charles Léopold Mayer (Institut Veblen), 2017
Histoire de la Suède
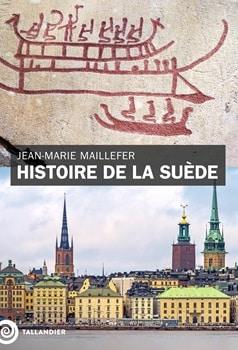
Osons un mauvais jeu de mot : ce livre est « absolut... ment » passionnant. Signé Jean-Marie Maillefer, professeur de langues et civilisations scandinaves aux universités Lille III et Paris Sorbonne, cette Histoire de la Suède est l’ouvrage qui manquait pour mieux comprendre cette région du monde. Car jusqu’ici, aussi étonnant que cela puisse paraître, il n’y avait quasiment rien de complet sur son histoire. « Régulièrement, la Suède est présentée comme une référence à l’occasion des débats économiques et sociaux en France. Son exemple est aussi fréquemment mis en avant en matière de bonne gouvernance, de transparence et de démocratie. Mais il est rare que soit dépassé le stade des poncifs (…). Pourtant, ce ‘modèle suédois’ n’est pas une donnée congénitale de l’histoire de la Suède. Il a fallu bien des chemins de traverse pour qu’il prenne corps peu à peu au XXe siècle. » Remontant le temps, l’auteur commence par montrer en quoi la formation géologique du territoire suédois explique la localisation des premiers espaces habités, des premières terres mises en agriculture et des premières installations de cités marchandes. Des Sames aux Varègues, il présente les migrations et la sédentarisation. L’ère romaine, l’écriture runique, les Vikings... Puis les rois, Gustave Vasa, dont la légende ne vacille toujours pas, Charles IX, la reine Christine (qu’il ne mentionne que brièvement, relevant son côté dispendieuse des fonds de l’État, sans s’attarder sur son attrait pour la culture de son temps ni son éventuelle androgynie), Charles XII, Gustave III... Le pays mène guerre sur guerre et pourtant parvient à se doter des infrastructures nécessaires à la puissance européenne qu’il entend être. Petit à petit, la Suède apparaît comme « le berceau des peuples » (avec les autres pays nordiques). Le livre de Jean-Marie Maillefer regorge de détails sans jamais être ennuyeux, sinon peut-être lorsque sont égrenées sur des pages et des pages les batailles militaires. Victoire, défaite, gain et perte de territoire, victoire, défaite... ! Difficile de suivre, même avec une carte en main, et puis, quel réel intérêt ? Apparaît le reproche que l’on peut faire à cet ouvrage, comme à beaucoup d’autres dits « d’histoire » : seuls sont relatés les faits des souverains. L’histoire ne concernerait-elle que les soi-disant grands de ce monde, ou que les faiseurs de guerre ? On en apprend ainsi trop peu sur la vie quotidienne du petit peuple, les paysans, artisans et autres commerçants. Petit peuple qui pourtant est le premier requis pour financer toutes ces guerres. On se dit, à rebours bien sûr, que le bonheur des populations serait plus aisé à mettre en œuvre sans autocrates névrosés et armés jusqu’aux dents. L’agriculture et l’industrie auraient peut-être, à nos yeux, mérité de plus longs développements. « La Suède devient un pays industriel entre 1850 et 1914... » Les progrès de la science, domaine dans lequel tant de noms suédois ont brillé (Carl von Linné, Anders Celsius, Svante Arrhenius, le premier à décrire l’effet de serre, prix Nobel en 1903, etc. et bien entendu Alfred Nobel), sont rapidement cités. Pourtant, note l’auteur, « les sciences dans lesquelles les Suédois s’illustrent ne sont pas le fruit du hasard, elles correspondent aux besoins d’une nation qui entend exploiter au mieux ses ressources propres ». Idem pour la peinture, la sculpture (Carl Milles), la musique (aucun nom !) – l’art, d’une façon générale. En littérature, August Strindberg, par exemple, n’est nommé que deux fois (sur près de six cents pages), et encore, fortuitement. Idem pour Viktor Rydberg, Selma Lagerlöf ou Astrid Lindgren. Les deux prix Nobel de littérature en 1974 (Eyvind Johnson et Harry Martinson) sont carrément oubliés (sinon Johnson, pour tout autre chose). Heureusement, avec l’époque contemporaine et notamment l’entrée du pays dans une politique sociale-démocrate, des considérations plus terre à terre sont traitées : travail des enfants, journées de huit heures, droit de vote des femmes, neutralité militaire, etc. Comme le préconisent Hjalmar Branting (prix Nobel de la paix en 1921) puis Per Albin Hansson, lui aussi premier ministre, « la solidarité, la justice, l’égalité et la démocratie » feront, éventuellement, le bonheur du peuple. Le « folkhem », « foyer du peuple », fait aujourd’hui encore l’unanimité de la classe politique. Ces remarques énoncées, affirmons tout de même que ce livre, bien pensé et bien écrit, est aujourd’hui incontournable. Jean-Marie Maillefer passe en revue rien moins que plusieurs milliers d’années d’histoire, c’est une œuvre d’historien considérable qu’il fournit là, sur un pays assez ignoré des Français. Un bel ouvrage qui n’a pas d’équivalent ici.
* Jean-Marie Maillefer, Histoire de la Suède, Tallandier, 2024
Bernadotte, roi d’aventures du Béarn à la Suède

Né à Pau en 1763, sergent dans l’armée royale, général des armées de la République, maréchal d’Empire, Jean-Baptiste Bernadotte devient roi de Suède en 1810 (et meurt en 1844). Dans Bernadotte, roi d’aventures du Béarn à la Suède, Guy Mathelié-Guinlet trace, sans trop s’embarrasser d’objectivité et de manière synthétique, le portrait d’un homme de son temps, peu enclin aux idéaux révolutionnaires, pas tout à fait hostile non plus, opportuniste surtout : « en l’espace de deux ans, il était passé du grade de sous-officier à celui le plus élevé de l’armée française », général de division et gouverneur militaire de Maastricht. Le tempérament de Bernadotte, plein d’un « bon sens béarnais », s’oppose rapidement à celui de Bonaparte. C’est « le côté humain du personnage », sa « générosité », qui explique que le roi de Suède, Charles XIII, trop âgé pour avoir des enfants, le choisisse un jour comme son successeur, explique encore Guy Mathelié-Guinlet. Le fait que Bernadotte prénommât Oscar son premier fils, prénom courant en Suède (Oskar), était-il prémonitoire ? On peut sourire mais aujourd’hui encore les descendants de la famille Bernadotte siègent sur le trône de Suède. Les premiers mots de Charles-Jean (puisqu’il décide de se faire appeler ainsi) Bernadotte sur le sol suédois semblent plus significatifs : « …La paix est le seul but glorieux d’un gouvernement sage et éclairé. » Sa patrie d’adoption ne l’a pas désavoué. Insistant peut-être trop sur les prétendues qualités béarnaises de Bernadotte (ceux qui sont nés quelque part ont toujours des qualités que les autres n’ont pas, aurait rigolé Brassens), Guy Mathelié-Guinlet nous restitue cependant bien le personnage, qui deviendra Charles XIV Jean, et nous montre que ce ne n’est pas se montrer traître à sa patrie (comme Napoléon tenta de le présenter) que de préférer la paix à la guerre. Mais il est vrai que la bêtise cocardière l’emporte trop souvent sur l’humanisme et l’intelligence…
* Guy Mathelié-Guinlet, Bernadotte, roi d’aventures du Béarn à la Suède, éd. des Régionalismes, 2016
Volonté éthique…
« …La culture scandinave est (…) faite de cette volonté éthique qui est bien plus qu’une attitude sociale, mais plutôt une démarche personnelle. Se connaître, s’accepter, s’assumer, le tout avec un infini mépris pour le mensonge, c’est cette rigueur morale, millénaire, qui constitue en partie la mentalité nordique. Pour le pire parfois, comme la soumission à l’ordre social, quand les Scandinaves se conforment volontairement et de façon rigide aux règles édictées au nom des maîtres des cieux et de la Terre. Mais pour le meilleur aussi, lorsque des femmes et des hommes du Nord décident de s’émanciper eux-mêmes et de défendre avec une constance et une persévérance propres, à la fois universelles et particulières, des valeurs de liberté, d’égalité et de solidarité. »
Fred Alpi (préface à Franklin Rosemont, Joe Hill, Bread, roses and songs)
Souvenirs de mon séjour en Afrique, Maroc 1831-1832
Julius Lagerheim (1786-1868) est, dirons-nous, un fils de bonne famille. Après un parcours dans diverses hautes fonctions de l’appareil d’État suédois, notamment comme consul général à Alger de 1826 à 1829, le voici diplomate par intérim au Maroc. La Suède n’a pas de colonies mais entretient des rapports diplomatiques avec certaines régions sous administrations européennes. Comme le souligne Elena Balzamo dans sa préface (la traductrice a exhumé de la bibliothèque d’Uppsala ce texte manuscrit jamais publié), Julius Lagerheim est un conservateur qui possède de l’humour, ce qui n’est pas si courant dans ce milieu, et une vision bon enfant de ses contemporains. Imbu des préjugés d’alors, notamment à propos des Juifs (« une race méprisée et méprisable » – il arrive pourtant en terre marocaine porté sur les épaules d’un Juif « sale et barbu » pour ne pas avoir à se mouiller les pieds) et des Maures (« pour la plupart pauvres, fourbes et perfides » et qui « détestent les chrétiens »), il partage la vision raciste en vogue et parle de « sous-homme » pour désigner les colonisés. Face à l’adversité, et les exemples ici fourmillent, il est pourtant capable de dépasser ces préjugés et de considérer les êtres humains avec équité. Son récit, dont la première partie suit son séjour en Angleterre, puis son trajet en bateau, est vif, plaisant à lire en dépit des multiples noms propres de personnalités depuis longtemps oubliées et des remarques qui choquent. C’est un carnet de voyage enjoué qui vaut autant pour ce qu’il donne à voir, une Afrique sous le joug des colons et qui n’a pas besoin d’eux pour se déchirer, que pour ce qu’il révèle de son auteur et de l’état d’esprit d’un Européen du Nord ouvert à des cultures nouvelles. La vie dans ces contrées pourrait se passer relativement bien si chacun se tenait à sa place, estime-t-il. Ainsi, les consuls « devraient éviter de se mêler sans nécessité dans les affaires des indigènes et ne pas froisser leurs coutumes et leurs préjugés religieux... » Honnête homme de son époque, Julius Lagerheim perçoit, comme à son corps défendant, les prémices de catastrophes futures : « plus une secte religieuse est persécutée, plus ses membres se fanatisent facilement ». Les Maures persécutent les Juifs et l’auteur, qui ne veut pas s’en mêler, en vient à prendre la défense de ces derniers. À lire cet ouvrage, on se prend à penser qu’il serait vraiment dommage d’en priver les bibliothèques au nom de la « bien pensance ». C’est toute une époque qui transparaît là, avec ses outrances et ses espoirs : le monde n’avance qu’avec les uns et les autres. Et quand les outrances disparaissent, restent les espoirs, n’est-ce pas ?
* Julius Lagerheim, Souvenirs de mon séjour en Afrique, Maroc 1831-1832 (Minnen från mitt vistande i Afrika, 2018), Le Jasmin (Le Simoun), 2020
Raoul Wallenberg

« 9 juillet 1944. Raoul Wallenberg, ressortissant suédois, pays neutre, muni d’un passeport diplomatique, arrive dans la capitale hongroise pour tenter de sauver les Juifs de la ville. » Ainsi commence l’ouvrage publié sous la direction de Fabrice Virgili (qui avait déjà présenté et annoté l’édition de Sauver Paris – éd. Complexe, 2002 – de Raoul Nordling, consul de Suède en France durant l’Occupation) et Annette Wieviorka et intitulé sobrement Raoul Wallenberg (Payot, 2014). Ce diplomate suédois ne ménagera pas ses efforts pour empêcher les assassinats de masse. 10 000 Juifs hongrois seront sauvés grâce à lui, qui leur fournira de faux papiers suédois ou leur permettra de se cacher. Ce courage lui vaudra le titre de « Juste ». Il disparaît mystérieusement lorsque l’Armée rouge entre à Budapest, en janvier 1945. Ce n’est que longtemps après, avec l’effondrement de l’URSS et la chute du Mur de Berlin, que certaines archives ont livré leurs secrets. Mort en 1947 dans une prison soviétique, Raoul Wallenberg est l’une des premières et des plus symboliques victimes de la Guerre froide. Plusieurs livres, en français, ont déjà été publiés à son sujet. Les Secrets de l’Affaire Raoul Wallenberg, l’un des plus intéressants, était signé Claudine et Damiel Pierrejean (L’Harmattan, 1998). Dommage qu’il ne soit même pas recensé dans la bibliographie de l’ouvrage de Fabrice Virgile et Annette Wieviorka.
Stockholm 73
Nous avons tous entendu parler du « syndrome de Stockholm » sans savoir cependant d’où provient cette expression et guère plus ce qu’elle signifie. Le journaliste Daniel Lang (1913-1981) nous relate le fait divers, un cambriolage de banque à Stockholm avec prise d’otages, qui en est à l’origine. D’abord publié en anglais dans The New Yorker Magazine en 1974, ce texte n’a rien perdu de son intérêt, tant il cerne bien l’ambiguïté des relations qui se sont mises en place entre les deux malfaiteurs, Jan-Erik Olsson, trente-deux ans, et Clark Olofsson, vingt-six ; le premier, évadé de prison, et le second, extrait de sa cellule par les autorités et conduit dans la Kreditbank à la demande d’Olsson, son ami. Quatre otages : trois femmes et un homme, tous employés de la succursale. Olsson, qui dirige les opérations, exige trois millions de couronnes et un puissant véhicule pour les libérer et s’enfuir. Les tractations traînent. Les deux braqueurs seront arrêtés six jours plus tard. « ...La police mena une guerre d’usure, ayant pour enjeux la libération de victimes innocentes et la préservation de l’intégrité sociale. » Les otages, eux, surprendront les autorités et les médias : n’ont-ils pas sympathisé avec leurs geôliers, allant jusqu’à réclamer qu’ils sortent de la banque avant eux, pour leur éviter d’être assassinés par la police, et les serrer dans leurs bras au dernier moment, quand les forces de l’ordre mettent un point final au braquage. Beaucoup s’interrogeront sur cette attitude, estimant que les otages avaient peut-être des problèmes psychologiques. N’est-ce pas oublier tout de même qu’un braqueur n’est pas toujours un être assoiffé de sang et qu’un policier peut ne guère inspirer confiance ? Un fait divers de portée historique, traité intelligemment à la façon de ces écrivains américains qui, à l’instar de John Dos Pasos ou de Norman Mailer, donnent aux faits dits de société une profondeur sur laquelle réfléchir.
* Daniel Lang, Stockholm 73 (The Bank drama, 1974), trad. de l’ang. Julien Besse, Allia, 2019
Le Diable dans la Baie des Anges

« Il faisait si chaud ce soir-là, comme si souvent un soir de 14 juillet à Nice. » Cadre chez Volvo et appelé à travailler régulièrement en France, Henrik Moberger décide en 2014, au moment de sa retraite, de quitter Göteborg pour s’établir en France avec sa femme. De préférence dans une région ensoleillée une bonne partie de l’année, afin de faire des randonnées et des parties de pétanque. Ainsi se retrouve-t-il à Nice, ville qu’il apprécie particulièrement, le 14 juillet 2016, quand un terrible attentat est commis sur la Promenade des Anglais : un camion-bélier est lancé dans la foule. Bilan : 86 morts, de très nombreux blessés et de plus nombreuses encore victimes psychologiques – dont Henrik Moberget, son épouse, leur fils et sa femme. Dans ce livre très illustré par des photos de l’auteur et de sa famille, Le Diable dans la Baie des Anges, sous-titré « Je suis Nice » (en écho bien sûr au célèbre « Je suis Charlie », puis « Je suis Paris » de 2015), Henrik Moberger livre un témoignage sans prétention. Façon journal intime, il recense ce qui l’attache à cette ville, où la vie pourrait être douce. Explique qu’un attentat laisses des traces, pour les victimes directes évidemment, mais aussi pour tous les individus qui passaient là ou connaissaient l’une des victimes. « Une vision incompréhensible et épouvantable qui nous a causé des blessures pour un long moment et peut-être même jusqu’à la fin de nos jours. » Il mentionne les diverses déclarations des politiques après l’attentat. Le relie à celui qui a frappé Stockholm, Drottninggatan, quelque temps après (7 avril 2017, cinq morts), regrette que les autorités suédoises ne prennent pas, comme cela se fait en France, de solides mesures de sécurité. Le récit d’un témoin, très simplement. Ce livre ne va pas au-delà, c’est dommage mais c’est aussi ce qui en fait son intérêt.
* Henrik Moberger, Le Diable dans la Baie des Anges, trad. Julius Holmertz & Anders Holmertz, Saint-Honoré éditions, 2021
Ils ont tué Monsieur H
Mourir avec mystère, serait-ce une spécialité suédoise ? Pensons à Raoul Wallenberg, disparu vraisemblablement dans un camp soviétique à la fin de la Deuxième Guerre mondiale sans que son corps ait été retrouvé ; à Olof Palme, dont l’assassin court toujours, s’il n’est pas mort lui-même ; et à Dag Hammarskjöld, dont l’avion s’est écrasé en Rhodésie (aujourd’hui la Zambie) un jour de septembre 1961. Des hypothèses, jusqu’à aujourd’hui, pour l’un ou pour l’autre, mais aucune explication totalement convaincante. Sauf peut-être celle que livre Maurin Picard dans son ouvrage, Ils ont tué Monsieur H, à propos de la disparition de Dag Hammarskjöld, « secrétaire général (de l’ONU) d’une trempe inédite ». « Il voulait faire de l’ONU un acteur à part entière de l’échiquier planétaire. (…) Il croyait éveiller les consciences et expédier les pratiques coloniales aux oubliettes de l’histoire. Une colombe, face à des rapaces. » Alors que la Guerre froide bat son plein, l’ONU adopte la position des non-alignés pour tenter d’instaurer la paix ici ou là. Les combats post-coloniaux font rage en Afrique centrale et les efforts de Dag Hammarskjöld pour leur trouver une solution pacifique sont vains. Alors qu’il a rendez-vous avec un leader dans la crise du Katanga, au Congo, son avion chute. Un simple accident ? Une attaque par un autre avion, comme l’ont rapporté plusieurs témoins, non « fiables » car... Noirs ! Les autorités des divers pays concernés émettent leurs versions, évacuant toute intention préméditée de se débarrasser d’un Secrétaire général de l’ONU trop encombrant – si obstiné dans sa volonté de décolonisation. Ils ont tué Monsieur H, le livre de Maurin Picard, journaliste à Guerres et histoire et au Figaro et auteur d’ouvrages sur les États-Unis et la Seconde Guerre mondiale, est troublant. S’il n’apporte pas une vérité définitive – avec les années, avec la mort des derniers témoins et la destruction de diverses archives, comment une vérité incontestable peut-elle encore surgir ? – il replace cette disparition dans une perspective historique et internationale : « Les autorités françaises vouent Monsieur H aux gémonies. Elles ne sont pas les seules. » Maurin Picard montre ainsi combien les intérêts économiques de quelques-uns priment sur le droit des peuples. Dag Hammarskjöld n’a pas été le Secrétaire général obéissant et pro-Occident que beaucoup souhaitaient. Une certitude : il l’a payé de sa vie.
* Maurin Picard, Ils ont tué Monsieur H, Seuil, 2019
Milicien et ouvrier agricole…

C’est en tant que marin que Nils Lätt (1907-1988), suédois et espérantiste, anarchiste jusqu’à son dernier jour, part d’abord en Espagne. En 1936, il s’engage dans le Groupe international de la colonne Durruti ; en avril de l’année suivante, il est gravement blessé (il perd l’œil gauche) et pourtant rejoint une collectivité agricole en Aragon. De retour en Suède en 1938, il livre ses souvenirs, aujourd’hui publiés en français par les éditions du Coquelicot : Milicien et ouvrier agricole dans une collectivité en Espagne. « Le marin anarchiste Lätt nous offre, avec ce témoignage attentif rédigé à chaud, une lecture passionnée et passionnante des événements, avec une lucidité extraordinaire et une richesse de détails qui seront largement confirmés par l’historiographie ultérieure », note l’historien Renato Simoni dans sa préface. Nils Lätt s’établit ensuite à Göteborg, poursuit ses activités au sein de la SAC (Sveriges arbetares centralorganisation) et édite la revue anarchiste Brand. Après la mort de Franco, il retourne un moment en Espagne et retrouve certains de ses compagnons anarchistes de jeunesse. Son témoignage, Milicien et ouvrier agricole dans une collectivité en Espagne, n’en est qu’un parmi d’autres, beaucoup d’autres (songeons aux travaux de Gaston Leval ou de Frantz Mintz sur les collectivisations). Il est cependant capital car toujours très précis, toujours argumenté, toujours ancré dans un contexte que l’auteur se charge d’expliciter en quelques mots. « Lutter et apprendre, apprendre et lutter, c’était le mot d’ordre des anarcho-syndicalistes espagnols », relève Nils Lätt, ajoutant, plus loin : « …seule la collectivisation pouvait donner de l’enthousiasme aux jeunes travailleurs des fronts, enthousiasme nécessaire pour compenser le manque d’armement face à un ennemi incroyablement supérieur. » L’Histoire ne se répète pas, espérons-le, mais, comme Nils Lätt, gardons toutefois cette page, l’Espagne libertaire, en mémoire car l’Histoire peut quelquefois se conjuguer à l’espoir et, avec un tel exemple, nous rappeler la pertinence de belles idées comme l’égalité, la justice et la fraternité.
* Nils Lätt, Milicien et ouvrier agricole dans une collectivité en Espagne (Som milisman och kollektivbonde i Spanien, 1938), trad. Anita Ljungqvist, présentation et annotations Renato Simoni & Marianne Enckell, Le Coquelicot (Cahier n°4), 2013
La Citoyenneté locale en Suède

Idée originale, que propose ici Marie-Pierre Richard : examiner l’état de la citoyenneté aujourd’hui en Suède par le prisme des initiatives locales. « Il s’agit de montrer qu’en Suède le local fait sens pour décrire et expliquer la citoyenneté, montrer que si la citoyenneté suédoise présente évidemment une composante étatique, elle possède une composante infra-étatique plus significative encore. » En effet, en Suède, existent deux sortes de citoyenneté, la citoyenneté locale et la citoyenneté nationale, et les deux, si elles ne s’affrontent pas, ne sont pas forcément identiques. Ce que l’on nomme le « contre-pouvoir » est une tradition établie en Suède depuis fort longtemps et a permis à la société d’évoluer sans heurts trop violents. Le principe de transparence en est l’une des expressions les plus connues. N’importe quel citoyen suédois peut avoir accès à la plupart des documents administratifs. Mais les concepts de citoyenneté évoluent au même rythme que la société. Le phénomène de l’immigration, par exemple, modifie les rapports sociaux, d’autant plus que la Suède est un pays qui s’est toujours refusé à stagner, quitte, pour cela, à se transformer en profondeur. « La citoyenneté locale égalitaire a été théorisée à une époque de grande homogénéité sociale et culturelle, à une époque où les étrangers étaient des travailleurs… » Aujourd’hui, alors que la Suède, dont la population a longtemps été très homogène, est le pays d’Europe qui accueille le plus d’immigrés (par rapport à sa population totale), l’idéal de justice et d’égalité qui a prévalu est-il encore effectif ? Quelles traces ont laissé les émeutes qui ont secoué la banlieue de Stockholm et d’autres villes suédoises en 2013 ? L’individualisme, qui a toujours été sous-jacent dans l’égalitarisme suédois, est en train de devenir primordial : quels changements en attendre ? Les collectivités locales peuvent-elles empêcher le démantèlement de l’État providence voulu par la droite libérale ? Et que penser de la montée de l’extrême droite, qui dépasse souvent aujourd’hui, notamment dans le sud du pays, 10% des suffrages ? Marie-Pierre Richard pose des questions et, grâce à un examen attentif de divers médias, apporte de très nombreux éléments de réponses. Sa conclusion ? Il y a bel et bien une « remise en cause » de l’État providence et ce, dans tous les domaines : « la cohésion sociale s’effrite et des agitations de quartiers apparaissent ».
* Marie-Pierre Richard, La Citoyenneté locale en Suède (préf. Michel Hastings), Presses universitaires du Septentrion (Espaces politiques), 2016
Derrière les barricades de Barcelone

« La signification de la révolution espagnole, pour les pays occidentaux, est incalculable. Ce peuple courageux et conscient a montré aux travailleurs européens le chemin vers la liberté, l’autonomie et le communisme libertaire », écrit Axel Österberg en prologue de son petit ouvrage publié en Suède en 1936 et jamais réédité depuis, Derrière les barricades de Barcelone. Les éditions du Coquelicot, à Toulouse, qui publient notamment des ouvrages consacrés à cette période, ont l’excellente idée de le proposer aux lecteurs français. « La solidarité avec l’Espagne, pendant la guerre civile de 1936-1939, a été très active en Suède », explique Marianne Enckell, spécialiste de l’histoire du mouvement anarchiste, dans sa postface. Comme, aujourd’hui, nous sommes loin, peut-on regretter, de cette belle utopie fraternelle, qui fut capable de s’élaborer en pleine guerre civile. Militant anarchiste au sein de la SUF, les Jeunesses libertaires suédoises, journaliste pour Arbetaren, le journal de la SAC (Sveriges arbetares centralorganisation), Axel Österberg se trouvait par hasard à Barcelone le 18 juillet 1936, lors du coup d’État militaire de Franco. Son récit est un témoignage, un témoignage engagé, un peu à la façon de celui, l’année suivante, de George Orwell, Hommage à la Catalogne. « Les fascistes ont les armes mais les ouvriers ont l’enthousiasme et le courage », note Österberg, qui déplore combien le gouvernement catalan, la Generalitat, tergiverse et hésite à donner à la population les moyens de se défendre contre les militaires. Les collectivisations vont pourtant aller bon train, en dépit de la nouvelle guerre civile (communistes contre trotskistes et anarchistes) qui éclatera bientôt au sein même de la guerre civile en cours (franquistes contre Républicains). Action et émotion ont guidé la plume de ces chroniques et nous laissent, à leur lecture, le sentiment que les événements de cette période ont marqué effectivement et durablement notre histoire. « Ce que signifie la socialisation de la Catalogne est sans comparaison dans l’histoire de l’humanité. » Les réalisations anarchistes des années 1936-1939, en Espagne, sont toujours à méditer et, pour nombre d’entre elles, à recommencer.
* Axel Österberg, Derrière les barricades de Barcelone (Bakon Barcelonas narrikader, 1936), trad. de l’espagnol Jacqueline Cortès Coumerly, introduction Albert Herranz, traducteur de l’édition originale suédoise, Le Coquelicot (Les Cahiers du Coquelicot n°8), 2016




