M-N
À tout moment la vie

Bilan de maternité : « Femme enceinte, l’enfant va bien selon le compte rendu, trente-troisième semaine… » Mais soudain, la santé de Karin s’aggrave, elle est hospitalisée, une leucémie myéloïde aiguë. Le narrateur, Tom, son compagnon, est désemparé. Il essaie d’être auprès d’elle autant que possible, puis l’enfant naît, une fille, Livia. Karin meurt brusquement et Tom se retrouve avec Livia. Il lui faut reprendre le dessus, la vie continue, Livia lui interdit de perdre pied même si, se rend-il compte avec effroi, « mon regard était complètement vide, comme si tout ce que j’avais jamais vu avait coulé de mes yeux ». Tout au long de ce récit, Tom, se débat avec la souffrance causée par la disparition de sa femme, puis, un peu plus tard, celle de son père. Poète (deux recueils publiés en Suède) et musicien, Tom Malmquist (né en 1978) livre, avec À tout moment la vie, un texte fort, inspiré de sa propre vie. Trop, peut-être, car au fil de la lecture le récit prend des allures de journal intime. La mort d’un proche est un sujet très sensible : dès lors, comment émettre une critique sans passer pour un sans-cœur ? Mais est-il vraiment utile, pour le lecteur, de découvrir la vie quotidienne, jusque dans les moindres détails (« …Mon caleçon est mouillé d’urine... (…Je) me remplis un verre Duralex d’eau »), que menaient Karin et Tom, ou, ensuite Tom et Livia ? La douleur et le chagrin ne se partagent pas, peut se dire ce lecteur. Lequel ne se retrouve-t-il pas, ici et quelque peu contre son gré, en position de voyeur ?
* Tom Malmquist, À tout moment la vie (I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv, 2015), trad. Hélène Hervieu, Noir sur blanc (Notabilia), 2016
Les Bottes suédoises

Les Bottes suédoises peut se lire à la suite ou indépendamment du (très bon) roman Les Chaussures italiennes (paru en Suède en 2006 et en France en 2009). Médecin à la retraite, Fredrik Welin vit seul sur une petite île du Golfe de Finlande, au large de Västervik. Une nuit, il est réveillé par l’incendie de sa maison. Il s’en échappe mais en quelques minutes son existence chavire. « …J’ai compris que j’avais réellement tout perdu. De mes soixante-dix ans de vie, il ne me restait rien. Je n’avais plus rien. » Comment l’incendie a-t-il éclaté ? Personne, à sa connaissance, ne lui en veut. Serait-il pyromane ? Il en vient à douter de lui-même. « J’ai pris peur. J’ai du mal à imaginer un destin plus effrayant que celui-là : être en bonne santé en apparence, et que ma fille, ou quelqu’un d’autre, m’annonce soudain que je perds la mémoire et que mon cerveau ne fonctionne plus comme il le devrait. » Sa fille débarque. Il n’a fait sa connaissance que fort tard, elle avait trente-sept ans – il faut se replonger dans Les Chaussures italiennes pour se remémorer exactement cet épisode de la vie de Fredrik Welin, personnage pas antipathique mais pas des plus sympathiques non plus, souvent en proie à de brusques accès d’humeur. Il y a aussi Lisa Modin, cette journaliste de la presse locale, qui vient l’interviewer et dont il tombe amoureux, sans réciprocité. Ces vies, donc. Et en toile de fond la vie – la maturité, la vieillesse et l’enfance, comme un retour à ce qui a été et à ce qui sera. Sans omettre la Suède et son devenir, avec la découverte que l’incendiaire pourrait être non pas un étranger, un « migrant », mais l’un des membres de la communauté des insulaires : « …À qui donc pourrait-on accorder sa confiance désormais ? » (Cette question ne fait-elle pas écho à celles qui surgissaient dans Meurtriers sans visage ?) L’incendie de cette maison, c’est la fin d’une vie, la fin d’une époque. Ce qui ne signifie pas que tout disparaît mais le monde dorénavant sera autre. Avec ces interrogations existentielles : que sait-on de soi ? que sait-on des autres ? Henning Mankell nous livre là, pour son ultime ouvrage, une œuvre à son apogée. Ce n’est pas un roman policier mais pourtant une intrigue puissante et présente de la première à la dernière page incite le lecteur à ne pas relâcher le livre, accompagnant Fredrik Welin jusqu’à la conclusion. « La mort des autres m’est aussi incompréhensible que celle qui m’emportera, moi aussi, le moment venu », fait encore penser Henning Mankell à son personnage, comme si l’écrivain réfléchissait tout haut. Remarquable adieu, que ce livre, donc.
* Henning Mankell, Les Bottes suédoises (Svenska gummistövlar, 2015), trad. Anna Gibson, Seuil, 2016
+ « …Je pense parfois que le temps et le lieu où j’ai vécu forment une parenthèse exceptionnelle dans l’histoire. » (Henning Mankell, Les Bottes suédoises)
Daisy Sisters

Il y a les Maigret de Simenon et il y a ses « romans durs ». Il est permis de préférer les seconds. Il y a, de Mankell, les Wallander, et il y a ses autres romans. Il est, là aussi, permis de préférer ses autres romans, notamment ceux pour adultes, qu’ils prennent ou la Suède (Les Chaussures italiennes, Profondeurs) ou l’Afrique pour cadre (L’Œil du léopard, Un Paradis trompeur).
Publié en Suède sous ce même titre en 1982, Daisy Sisters (trad. Agneta Ségol et Marianne Ségol-Samoy, Seuil, 2015) est l'un des premiers romans du prolifique Henning Mankell. On ne peut que regretter qu’il soit publié seulement aujourd’hui, bien qu’il soit vrai que les traductions de Mankell en français s’échelonnent, tous registres confondus, au rythme d’au moins deux titres par an et qu’il risquerait d’y avoir saturation.
Daisy Sisters emmène le lecteur en Suède, en 1941. Deux jeunes correspondantes se rencontrent enfin. C’est l’été, le pays est neutre mais la guerre résonne aux frontières. Elles sont insouciantes, elles ont dix-sept ans et rêvent des joies que la vie leur apportera. Hélas, Elna se fait violer par un soldat, tente d’avorter, échoue. Une fille naîtra, Eivor, que le lecteur suit jusqu’en 1981. Quarante années qui ont vu la Suède évoluer profondément, Comme à son habitude, Mankell sait captiver le lecteur à partir de petits riens, il sait tracer le portrait de personnages que l’on n’oubliera plus : ici, Anders, par exemple, ce clown raté qui décide de se suicider au vin et à l’aquavit ; ou Vivi, bien sûr, l’amie d’Elna, dont le père était communiste ; ou cette petite frappe de Lasse Nyman ; ou Rune, le grand-père sévère et plus humain que beaucoup (« Il faut être courageux. Dans la vie, la seule chose dont on peut être fier c’est d’avoir été courageux… ») ; ou tel ou tel autre personnage… Les femmes prédominent. Ce sont en grande partie des femmes, en effet, que Henning Mankell observent dans ce roman dense, toutes celles qui, parce que femmes, justement, et qui plus est femmes des classes populaires, voient leur vie leur échapper du premier au dernier jour. Elles ne comprennent pas ce qu’il leur arrive, elles ne savent pas ce que sont les règles ni les enjeux dans une société où le pouvoir est détenu par les hommes, comme Liisa le dira à plusieurs reprises à son amie Eivor. Femmes désirables aux yeux des hommes, tout d’abord, qui les engrossent, c’est le terme à employer, femmes qui deviennent mère, qui font des ménages, qui travaillent en usine, parce qu’elles sont faites pour travailler en usine, dixit de nouveau Liisa, qui jonglent avec un emploi du temps pas extensible, qui essaient de satisfaire les besoin de tous ceux qui les entourent, besoins qui ne sont pas pour autant les leurs… Femmes que l’angoisse n’abandonne jamais… Bien entendu et heureusement, durant cette quarantaine d’années les lois changent en Suède, le statut de la femme devient l’égal de celui de l’homme. Mais les femmes issues des couches pauvres de la population ne sont qu’indirectement concernées, les victoires féminines ne modifient pas immédiatement leur vie, elles touchent d’abord les femmes des milieux aisés ou relativement aisés. Pour un roman de débutant, Daisy Sisters est un coup de maître. Mankell réactualise la littérature prolétarienne, comme on le sait si efficiente en Suède. Il entraîne le lecteur dans une saga passionnante, une page d’Histoire récente au travers de personnages qui ne sont pas des héros, des gens vraiment comme vous et moi, et c’est pourquoi les aléas de leur vie nous émeuvent autant. Si nous ne le connaissions pas, nous affirmerions que voilà un écrivain avec lequel il faudra compter… !
Changement d’époque
« Même un vieux social-démocrate comme moi qui a connu l’époque où les poux manifestaient parce que les gens étaient trop maigres doit comprendre que les temps changent (…). Pour votre génération, ce sont les voitures et le rock qui comptent. Aujourd’hui les gens se permettent de refuser un boulot parce qu’il ne leur convient pas. » (Henning Mankell, Daisy Sisters)
Sable mouvant

Au tournant de l’hiver 2013/2014, Henning Mankell découvre qu’il est atteint d’un cancer extrêmement grave. Plus qu’un retour sur sa vie, le livre qu’il compose alors, Sable mouvant, est un regard sur l’avenir. Ainsi, s’interrogeant, par exemple, sur la responsabilité de notre génération d’enfouir dans le sous-sol (notamment en Suède et en Finlande) des déchets nucléaires qui demeureront dangereux 100 000 ans (portons-nous donc 100 000 ans en arrière, suggère-t-il !), il ne cherche pas à discerner un sens à la vie, n’en appelle pas à un dieu quelconque, mais observe au contraire la vacuité de toute vie intelligente. Ce qui n’empêche pas l’être humain de faire de sa propre vie quelque chose d’unique, écrit-il, en se donnant les moyens de choisir, à condition de ne pas craindre de profonds changements dans cette vie. C’est un écrivain différent de celui que le lecteur avait rencontré dans Mankell (par) Mankell, cette longue série d’interviews de Kirsten Jacobsen, qui apparaît ici. Les choses du présent, ces choses comme la politique ou les changements sociaux qui le travaillent tellement, l’écrivain les délaissent quelque peu pour déployer une vision privilégiant l’Histoire – l’Histoire sur le long terme. Ainsi réfléchit-il à l’apparition de l’homme sur Terre et à sa probable future disparition, aux âges glaciaires, ceux d’hier et ceux à venir, aux premiers témoignages de l’art, etc. Il nous entraîne également dans ses « voyages sans but » (pour reprendre un titre de Harry Martinson) de jeunesse et d’après, dans des villes d’Europe ou d’Afrique. Et même si « tant de questions reçoivent si peu de réponses », partout, on peut apprendre, partout on peut profiter des expériences d’autrui ou se forger les siennes et se sentir plus fort. Et l’écriture d’un roman consiste à tresser ces multiples fils. Avec, toujours, ces grandes et indispensables questions sur lesquelles repose son œuvre : « Est-ce un rêve outrancier que d’imaginer une civilisation à l’échelle mondiale qui ne soit pas fondée sur l’oppression ? Outrancier ou non, c’est un rêve nécessaire. » Homme parmi les hommes, homme qui se veut libre parmi d’autres qui parfois tentent de l’être sans y parvenir... Espérons que la voix de Mankell ne s’éteigne pas de sitôt.
* Sable mouvant (Kvicksand, 2014), trad. Anna Gibson, Seuil, 2015
* Kirsten Jacobsen (Mankell (om) Mankell, 2011), trad. du danois et du suédois par Anna Gibson, Seuil, 2011
Les livres
« Quand j’ai réussi (…) à me hisser hors du sable mouvant et à commencer la résistance, mon principal outil a été tout trouvé : les livres. Dans les moments difficiles, prendre un livre et m’y perdre, disparaître dans le texte, a toujours été ma façon à moi d’obtenir soulagement, consolation ou, du moins, un peu de répit. Quand une histoire d’amour se terminait, je prenais un livre. Après un échec au théâtre, ou un texte impossible à finir, j’ai toujours pu compter sur eux. Ils sont pour moi un réconfort et aussi un instrument qui me permet de diriger mes pensées dans une autre direction et de rassembler mes forces. » (Henning Mankell, Sable mouvant)
Le Dynamiteur

Le Dynamiteur est le premier roman publié de Henning Mankell – en 1973. Dans un style assez différent des ouvrages suivants (car avec une narration non linéaire), ceux, par exemple, qui mettent en scène Kurt Wallander, Mankell conte ici la vie d’un « dynamiteur ». Si le titre est suivi du mot « roman » sur la couverture, sans doute s’agit-il plutôt d’un récit, voire d’un documentaire (relevons que le traducteur aurait peut-être pu éviter ces tripotées de « putain » et de « bordel » pas forcément en usage au début du XXesiècle). Oskar Johannes Johansson naît en 1888. En 1911, il travaille sur le chantier d’une ligne ferroviaire, dans la région de Norrköping, au percement de tunnels. Une charge de dynamite explose à cinquante centimètres de lui. Il survit, mais le voilà gravement blessé. Un œil en moins, une main arrachée et la verge presque en morceaux – il reprend pourtant son travail, se marie avec la sœur cadette de sa fiancée, a trois enfants. « Oskar Johansson a été ouvrier toute sa vie. Il a pensé et agi différemment, en restant tout le temps ouvrier. Qu’est-ce qui a changé sa façon de penser ? Changé sa façon d’agir ? » Un « agitateur » socialiste de passage lui explique que la société pourrait fonctionner autrement. Que les ouvriers pourraient et devraient avoir de vrais droits. Parce qu’il est devenu socialiste, son père le chasse de la maison. Oskar loge chez un camarade de travail. « Nous devons avoir notre part et partager les moyens de production », lui dit ce dernier. Qu’est devenu cet idéal, moins d’un siècle plus tard, alors que règne l’individualisme et la consommation ? interroge Henning Mankell de manière sous-jacente. Des Oskar Johansson, ouvriers jetés lorsque leur utilité n’est plus reconnue par les actionnaires des entreprises, patrons rapaces d’aujourd’hui, combien y en a-t-il ? Sauf que la conscience de classe s’est étiolée, que les discours qui ne promeuvent pas la réussite sociale sont présentés comme désuets. Qui, à cinquante ans, n’a pas une Rolex à son poignet a loupé sa vie, n’est-ce pas ? Que l’on puisse posséder d’autres valeurs que la course au pouvoir et à l’argent n’effleure pas les tristes individus qui nous gouvernent. « Aujourd’hui, je me dis que la vie n’est pas assez drôle pour qu’on ait envie de recommencer », songe Oskar sur le tard. C’est tout à l’honneur de Mankell de retracer la vie de ce personnage, par le biais d’un narrateur un peu mystérieux (lui-même ?), cet ouvrier « qui est juste présent », condamné à demeurer anonyme comme tous ceux de sa condition. « On peut changer les choses. Il faut évidemment les changer. La situation actuelle est mauvaise et injuste. Et l’inquiétude crée le besoin. » Un livre imparfait, pour qui connaît la production littéraire de Mankell, son premier, donc, à considérer comme tel. Un livre relevant de la riche littérature prolétarienne suédoise. Un grand livre, pour ce qu’il révèle de l’auteur et pour cette vision profondément humaine qu’il portait sur le monde.
* Henning Mankell, Le Dynamiteur(Bergsprängaren, 1973), trad. Rémi Cassaigne, Seuil (Cadre vert), 2018
La Réalité jusqu'à la mort

« Vers la fin du XIXe siècle, la civilisation franchit les limites de la modération et de la sobriété et s’emballa, échappant dans sa course effrénée à tout contrôle. » Non, il ne s’agit pas du énième rapport du GIEC ! Ce livre de Harry Martinson aujourd’hui seulement traduit en français, La Réalité jusqu’à la mort, date de 1940. Étonnamment actuel – et même doublement actuel ! L’écrivain évoque d’abord ici la Finlande et la guerre que l’URSS y mène par des températures de -40°. « ...Autrefois, il avait cru que l’URSS était un pays pacifique, il y voyait un garant de la paix ; à présent, il en était revenu. » Après la guerre d’Hiver (1939-1940), celle dite de Continuation (1941-1944) prend la relève. Comme le souligne à juste titre Elena Balzamo (directrice de l’équipe de traduction) dans sa préface, l’histoire bégaie et nul doute qu’aujourd’hui Harry Martinson aborderait la situation en Ukraine : « Il aurait probablement rejoint les rangs de ceux qui, au péril de leur vie, informent le monde de ce qui s’y passe, et, plus tard, il en aurait tiré un récit aussi vibrant que celui qu’il a consacré jadis à une autre guerre. » Récompensé par le prix Nobel de littérature en 1974, remis conjointement à son compatriote Eyvind Johnson, Harry Martinson (1904-1978) jouit d’une grande popularité en Suède. Orphelin à l’âge de six ans, placé dans une famille paysanne au sein de laquelle il sera réduit en quasi-esclavage, il s’engage dans la marine marchande alors qu’il n’est encore qu’un enfant. De retour en Suède, il publie Nässlorna blomma (traduit en français sous le titre Même les orties fleurissent) en 1935 puis Vägen ut (Il faut partir) un an plus tard. Deux récits autobiographiques prenant sa région natale, le Blekinge, au sud de la Suède, pour cadre. En France, une bonne partie de son œuvre est depuis quelques années disponible, grâce notamment au traducteur Philippe Bouquet. Classique de la littérature s’il en est en Suède, son récit de science-fiction Aniara a été adapté il y a peu au cinéma (on peut songer, à voir cet excellent film, à 2001, l’odyssée de l’espace de Stanley Kubrick). Dans La Réalité jusqu’à la mort, il n’est pas question de futur mais de présent, un présent ensanglanté par la folie totalitaire. En 1934 et de plus en plus au cours des années qui suivront, il faut « souligner l’éclat de la personnalité de Staline et le bonheur de marcher dans l’incomparable lumière de sa sagesse », observe l’écrivain. Staline ou Poutine, les fondamentaux demeurent, notamment ce répugnant culte de la personnalité qui repousse à jamais l’hypothèse démocratique. Quant à la révolution... Jetée aux orties ! « ...Il s’agissait de romantisme industriel de bas étage, écrit dans un jargon journalistique. À cela s’ajoutaient des doses appropriées de panégyriques de l’État et du Concret. De Staline. » Écrivain qui s’inscrit dans le courant dit prolétarien (très bien représenté en Suède par Ivar Lo-Johansson, Vilhelm Moberg, etc.) Martinson ne fait pas partie de ces intellectuels béats, de ces artistes ravis de voir leurs noms accolés à celui du dictateur, comme l’époque en comptera tant. Plutôt Georges Bernanos (La France contre les robots), lui, ou mieux, Victor Serge (S’il est minuit dans le siècle), que l’un ou l’autre des thuriféraires du communisme autoritaire (Aragon et consorts) comme il y en eut tant. De gauche, révolutionnaire au besoin, il se veut avant tout un esprit libre – alors que l’heure était à un embrigadement forcené. S’il célèbre la Suède, c’est en n’oubliant pas de s’élever contre sa neutralité à l’heure où unir les forces contre Staline et Hitler lui semble être une priorité. « Une nation qui veut coûte que coûte rester en paix doit en payer le prix : voir ce qui se passe et se taire. » La position de Harry Martinson et celle également de sa femme, Moa, alimentèrent des débats passionnés en Suède et au-delà. Jusqu’à quel point, le soutien à la Finlande ? « ...La civilisation russe s’est alliée à l’allemande pour envahir notre paisible Nord peuplé de rêveurs... » Renvoyant dos à dos l’Allemagne hitlérienne et l’URSS stalinienne, Harry Martinson se fait le chantre de la démocratie – une démocratie qui ne s’en laisse pas conter, une démocratie offensive. Comme un rempart contre la sauvagerie guerrière. « Dans un État démocratique, on pouvait se révolter contre la réalité, ce terrible concept forgé et encensé par la civilisation, sans être accusé de sabotage, et exécuté. (…) Le poète et le philosophe avaient encore leur place dans la société... » Une société démocratique n’est pas un acquit, elle doit être défendue, plaide-t-il, allant dans le sens de la remarque déjà citée d’Elena Balzamo : la défense de l’Ukraine aujourd’hui s’apparente à celle de la Finlande plus de quatre-vingt ans auparavant. « Le principe de la démocratie est la conviction que les principes ne peuvent pas légitimer des meurtres. » Ce texte est donc d’une actualité incontestable, sans omettre le fait que Martinson allie intelligemment critique sociale et critique politique et ce, en usant d’une prose très poétique. « Doutez, prenez votre temps, ressentez – et vous vous accomplirez en œuvrant sur vous-mêmes, au lieu d’œuvrer à produire des bombardiers ou des tracteurs. » Guerre et culte du progrès technologique vont de pair, affirme l’écrivain, précurseur des théories de la sobriété et de la décroissance : « Toute tentative de s’élever au-dessus de sa condition vers un bonheur consistant à posséder des choses et des biens était voué à un lamentable échec. » Notons que la couverture de ce livre, qui se situe quelque part entre le récit et l’essai (et qu’il ne serait peut-être pas vain de mettre en parallèle avec Automne allemand de Stig Dagerman), reprend une toile de l’auteur – excellente idée puisque Harry Martinson était aussi un peintre de talent.
* Harry Martinson, La Réalité jusqu’à la mort (Verklighet till döds, 1940), trad. Elena Balzamo et collectif, Belloni, 2023
Femmes et pommiers

Auteure reconnue en Suède, Moa Martinson (Helga Maria Swartz, 1890-1964) n’avait jamais été traduite en France. C’est enfin chose faite avec la publication de son premier roman, Femmes et pommiers, un fort volume dans lequel celle qui fut l’épouse de Harry Martinson (Prix Nobel de littérature en 1974, avec Eyvind Jonhson) nous présente trois générations de femmes travailleuses dans la ville de Norrköping au début du XXe siècle. Pas d’angélisme ni de misérabilisme ici, ce roman largement autobiographique se veut très réaliste et porteur d’espoir. Moa Martinson a signé une œuvre riche s’inscrivant pleinement dans la littérature prolétarienne, courant qui a rencontré un vif succès en Suède (avec des auteurs comme Vilhelm Moberg, Ivar Lo-Johansson, Folke Fridell, etc.). Engagée politiquement bien à gauche, Moa Martinsson aurait assurément encore son mot à dire aujourd’hui, tant subsiste la misère sous toutes ses formes.
-
Moa Martinson, Femmes et pommiers (Kvinnor och äppelträd, 1933), trad. Lise Froger-Olsson, L’Élan/Ginkgo, 2017
Le Viking qui voulait épouser la fille de soie

Il y a du Selma Lagerlöf dans ce roman de Katarina Mazetti, Le Viking qui voulait épouser la fille de soie : pensons à Gösta Berling, par exemple. L’auteure du très bon Le Mec de la tombe d’à côté nous livre ici une saga érudite et drôle, riche de détails, qui deviendra peut-être un classique de la littérature suédoise. L’action se passe dans la seconde partie du Xe siècle, en Europe centrale, notamment à Kiev, et dans le sud-est de la Suède, quelque part dans la région du Blekinge. Les Vikings sont encore forts et prospères mais, au quotidien, les habitants du Blekinge ont à lutter contre beaucoup de fléaux : notamment les gens de Bornholm ou de plus loin qui arrivent par la mer et qui pillent et détruisent les villages, ou ceux, sur place, qui entendent faire régner leur loi. Des questions se posent, déjà, sur les droits des uns et des autres, des femmes et des esclaves, de tous ceux qui habitent dans ce pays. « …Un roi, qu’est-ce réellement ? Quelqu’un qui exige de toi de l’or et de l’argent et en contrepartie promet de te défendre contre des ennemis ? Des ennemis, qui le sont peut-être devenus parce qu’il a essayé de soumettre leur pays ? À quoi nous servirait un tel roi ? » Une fois de plus, Katarina Mazetti nous livre un petit roman enthousiasmant, susceptible d’éveiller de nombreuses réflexions.
* Katarina Mazetti, Le Viking qui voulait épouser la fille de soie (Blandat blod, 2008), trad. Lena Grumbach, Gaïa, 2014
Petites histoires pour futurs et ex-divorcés

Présenter la littérature des Pays nordiques comme triste ou morbide, comme cela se fait fréquemment, n’est vraiment pas de mise. Pour preuve, par exemple, ce recueil de nouvelles de Katarina Mazetti, Petites histoires pour futurs et ex-divorcés (joliment et discrètement illustré par Anne-Valérie Guerber). Contant diverses histoires propres aux couples les mieux unis au moment précis où ils se séparent, elle nous montre, finalement, que l’être humain n’est pas forcément destiné à vivre avec un conjoint ou une conjointe. Comme dans ses autres livres, ses récits semblent puisés dans la vie de tous les jours, celle que nous connaissons tous, au point que, parfois, il serait peut-être judicieux d’en oublier des passages. « À partir de là, j’ai eu des trous de mémoire », confesse ainsi la narratrice de la nouvelle intitulée « Au diable Downton Abbey ! », au cours d’un mémorable réveillon de Noël. Dans l’histoire suivante, « Libre de toute dette », une femme est au centre d’une escroquerie, contre sa personne mais avec son consentement. Puis c’est un homme, dans « Les retrouvailles », qui assiste, quelque peu médusé, aux « retrouvailles » de son premier amour avec son meilleur ami à lui, alors qu’il pensait que la soirée lui serait réservée Et ainsi de suite. Avec autant d’humour que de talent, Katarina Mazetti nous expose dans ce livre les aléas de la vie amoureuse sous toutes ses formes : la rencontre, la lassitude, la rupture… et les quiproquos, les engueulades, la jalousie, le ressentiment, voire l’agressivité (« Vagina dentata »)… Ou encore l’« éternel recommencement ». Bref, ces moments forts qui, tôt ou tard mais à coup sûr, rythment gravement ou joyeusement la vie sentimentale de tout un chacun. « La fenêtre la plus noire est celle qui un jour fut éclairée. »
* Katarina Mazetti, Petites histoires pour futurs et ex-divorcés (Berättelser för till-och frånskilda, 2013), trad. Lena Grumbach, Gaïa, 2017
Ma vie de pingouin

Les pingouins, on le sait, vivent en Arctique ; les manchots, en Antarctique. Ce roman aurait donc dû s’appeler Ma Vie de manchot, puisque l’action se passe sur le chemin du Pôle Sud. Mais Ma Vie de pingouin (traduction exacte du titre suédois) sonne mieux. Trois personnages principaux, parmi une cinquantaine de passagers, prennent place sur un paquebot en direction de l’Antarctique. Wilma, trente-deux ans, un « garçon manqué » jamais en panne d’optimisme, qui se lie d’amitié avec Thomas, deux ans plus âgé, séparé de sa femme et de ses enfants et d’humeur suicidaire, et Alba, la doyenne de soixante-douze ans, qui observe le groupe avec amusement. « Pourquoi faut-il toujours que je me déprécie ? Que je parle de mon prognathisme et de mes jambes en poteaux ? (…) Je sais bien que ce n’est pas ça, le plus important, que ce serait une injure à Thomas de croire qu’il se détournerait de dégoût de toute femme qui n’est pas siliconée, avec des lèvres de canard bourrées de collagène et des cheveux en barbe à papa », s’interroge Wilma, peu avant le retour des voyageurs. Un roman pour passer le temps, derrière son hublot.
* Katarina Mazetti, Ma Vie de pingouin (Mitt liv som pingvin, 2008), trad. Lena Grumbach, Gaïa, 2015
La source

« Je suis l’eau, je suis l’origine. Je fus avant les chênes, l’herbe et les fleurs. Je fus avant les bêtes qui mangent l’herbe. Je fus avant l’aile qui plane et le pied qui court. Je fus avant les bourdons, les abeilles et les oiseaux.
Je fus avant les joies et les peines, les pleurs et les rires. Je fus avant le chant, le jeu et la danse. Je fus avant que ne viennent sur terre la souffrance, l’angoisse et la peur. Je fus avant que ne survienne la race des hommes.
Mes veines coulent dans les sombres entrailles de la terre, mes veines que personne ne connaît. Mais je jaillis ici au pied de la colline et les cimes des chênes se mirent dans mon eau. Je vois la marche des générations à travers le monde.
Je suis la source, je suis l’origine. » (Vilhelm Moberg)
Prélude à Les Fiancés de la Saint-Jean (Brudarnas källa, 1946), trad. Georges Ueberschlag, Presses universitaires de Lille, 1989
Mon instant sur cette terre

« J’habite un hôtel situé entre la rue et la mer. (…) Entre l’éphémère et l’éternel, c’est là mon foyer. » Albert Carlson/Karlsson, le narrateur qui s’est enrichi en cultivant des oranges, contemple le monde depuis la fenêtre de son appartement de Laguna Beach, près de Los Angeles. Il vit depuis plus de quarante ans aux États-Unis. C’est le soir de sa vie. Ses pensées l’entraînent vers ceux, parents et amis, qui ont été les siens, quelque part en Suède. Tout en nuances, ce roman de Vilhelm Moberg (1898-1973), Mon instant sur cette terre, interroge la vulnérabilité de l’émigrant, sa solitude mais aussi ses attaches, la dislocation de son identité et sa mémoire écharpée dans les tourbillons de la ville. Il se nourrit d’allers-retours entre la Californie et la Suède, le Nouveau monde et l’Ancien. Dans la continuité de son opus majeur, La Saga des émigrants, et de son superbe roman La Femme d’un seul homme, il évoque la destinée de proches restés au pays natal. « J’ai quitté le pays du genévrier pour celui de l’oranger parce que je voulais vivre longtemps sur cette terre. » Plus que jamais, Vilhelm Moberg cherche sens à la vie. Un très grand texte.
* Vilhelm Moberg, Mon instant sur cette terre (Din stund på jorden, 1963), trad. Raymond Albeck, Ginkgo/L’Élan, 2023
La Femme d'un seul homme

La Femme d’un seul homme est un roman qui s’inscrit dans le temps et dans un lieu précis et pourtant c’est un roman presque intemporel. Il se passe dans le sud de la Suède et pourrait pourtant se passer ailleurs. C’est une femme qui aime un homme et cet homme n’est pas son mari. Celui-ci ferme les yeux : peut-être ne comprend-il pas ce que souhaite sa femme, ce qu’elle ne souhaite pas, ce qu’elle est en train de vivre ; la communauté villageoise devine, en revanche. Märit, la femme hésite, rebrousse chemin, puis saute le pas. C’est un roman qui nous montre une Suède encore très rurale et très imprégnée de luthéranisme, un pays dans lequel l’émancipation des femmes ne se discutait pas encore. L’un des plus beaux romans de Vilhelm Moberg, à notre avis, par ailleurs l’auteur de la magistrale Saga des émigrants.
* Vilhelm Moberg, La Femme d’un seul homme (Mans kvinna, 1933), trad. Marguerite Gay, L’Élan, 2012
* La Saga des émigrants (Utvandrarna och Nybyggarna, 1949-1959), trad. Philippe Bouquet, Gaïa (1999-2000 et réédition en 2 volumes en 2013 et Le Livre de poche)
Dieu est un garçon noir à lunettes

Adi vit avec les siens, à Dar es Salam, en Tanzanie. Son père est un « ingénieur mathématicien qui aurait dû devenir linguiste » et qui travaille pour l’ambassade du Zaïre : « il apprend les mots dans les dictionnaires et, quand il a fini, il arrache la page ». Peu amène, ventripotent, il règne sur sa famille : une épouse obéissante avec de longues griffures étranges sur le corps, qui, le soir, « se transforme en une personne solitaire et anxieuse », et trois filles (parmi les sept enfants). Dina l’aînée s’amuse avec son amie presque homonyme Dima ; la dernière, Maï, semble un peu absente ; âgée de six ans, Adi observe ce petit monde, sans tout comprendre. « Un jour, tu seras peut-être écrivaine », lui dit sa mère et l’idée fait tilt. Mais bientôt les événements s’emballent pour les ressortissants de l’ex-Congo belge. Kayo Mpoyi (née au Zaïre en 1986, elle vit aujourd’hui à Stockholm) livre, avec Dieu est un garçon noir à lunettes, un truculent roman. (Qui ne prend pas du tout la Suède pour cadre, qui n’a aucun lien avec ce pays, mais puisqu’il est écrit en suédois, il a sa place sur ce site consacré à la littérature des Pays nordiques.) Les détails abondent, le lecteur est plongé dans la vie quotidienne de cette famille. Ce qui pourrait faire tiquer (ce sale personnage de Monsieur Éléphant, par exemple, pédophile, violeur) est traité avec recul et, sans perdre de sa gravité, apparaît comme un élément parmi d’autres dans une société où périodes de guerre et périodes de paix se succèdent, où les enfants vont à l’école dans des classes de cent élèves avec des enseignants brutaux, où l’existence est toujours précaire. Dieu, ou plutôt son invocation, est présent à chaque page, ni plus ni moins utile qu’un ventilateur au milieu de la savane africaine : « Dieu est assis à notre table et note tout ce que dit papa... » C’est profond et virevoltant, si l’on peut dire. Un roman à découvrir.
* Kayo Mpoyi, Dieu est un garçon noir à lunettes (Mai betyder vatten, 2019), trad. Anna Gibson, La Belle étoile, 2022
La Malédiction des Stensson
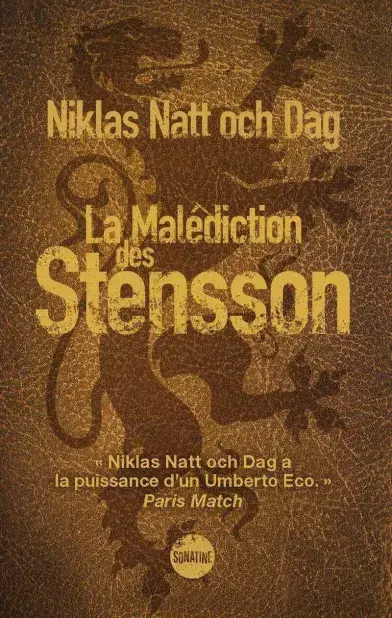
« Je suis allé au nord. Des événements sont en cours là-bas, des événements qui promettent des temps nouveaux. » 1434. Sous le règne d’Erik XIII de Poméranie, le royaume de Suède est mal en point, nombre de familles de la noblesse supportent mal son joug. « Le roi Erik siège au Danemark (…). Il ne s’est pas donné la peine d’apprendre beaucoup plus de suédois, mais il est devenu querelleur, bilieux, pusillanime et susceptible dans ses efforts pour tenir le royaume mal rapiécé par sa mère adoptive. » Les nobles veulent le faire abdiquer. Une lignée se détache, celle de Sten Bosson, et les secrets qui lui sont liés abondent. Auteur des romans 1793, 1794 et 1795, Niklas Natt och Dag, s’aventure donc là, avec La Malédiction des Stensson, plus haut dans le temps, à la fin du Moyen âge. Les informations sur cette période de l’histoire assez méconnue sont précieuses, l’écrivain les utilise à bon escient. « Les événements relatés (…) sont si lointains qu’il est difficile de prétendre à la vérité. (…) La vie des hommes puissants peut être cernée grâce à leur participation à des conseils, aux héritages ou aux transactions foncières. Le versant féminin des familles tend à être négligé. Le peuple est quasiment oublié », observe l’auteur dans sa postface. Le lecteur peut vite s’égarer dans ce roman copieux (plus de 600 pages) avec une foultitude de personnages plus ou moins apparentés, et rester en chemin faute d’une intrigue assez resserrée – bien que bardée d’érudition.
* Niklas Natt och Dag, La Malédiction des Stensson (Ödet och hoppet, 2023), trad. du suédois Rémi Cassaigne, Sonatine, 2025
1793
« On a laissé chaque plaie cicatriser assez longtemps pour que le corps supporte l’amputation suivante. Des mois durant, il (la victime) a été gardé quelque part, attaché à un lit. Il a sans doute appelé à l’aide, en vain, puisque sa langue a été tranchée. Il a sans doute tenté d’en finir, mais on ne lui a même pas laissé ses dents. Ni ses yeux. (…) Rester étendu là, seul, impuissant, jusqu’au jour où tu sens la scie sur une autre partie de ton corps ? » Le roman de Niklas Natt och Dag (c’est son nom), 1793, démarre très fort et l’intrigue ne faiblit pas, de la première à la dernière page. À Stockholm, en 1793, un cadavre amputé de ses membres est retrouvé au sud de Gamla, la « ville entre les ponts », le cœur de la capitale suédoise minutieusement décrit. Homme de loi, tuberculeux et conscient de sa mort prochaine, Cecil Winge est chargé de l’enquête. Il demande l’assistance de Jean Michael Cardell, un vétéran de la guerre russo-suédoise, avec une « main en buis » à la place du « bras gauche qu’il ne possède plus ». En dépit des menaces qui leur sont adressées, les deux hommes ne se laissent pas intimider. Le crime relève du plus malade des esprits, se convainquent-ils. Des musées consacrés à la torture existent dans différentes villes de la planète. Ce livre, 1793, y figurera certainement avant peu, tant il décrit avec détails divers procédés. Bien des lecteurs risquent d’interrompre en cours leur lecture ! Ce serait dommage, 1793 est un roman étonnant, qui prend pour cadre une société en plein changement, dans laquelle l’esprit des Lumières se répand tant bien que mal. « Dans la cave où je suis descendu chercher encore à boire tard dans la nuit, j’ai vu un roi-des-rats dans la lueur de l’allumette, un essaim de vermines hurlantes aux queues nouées ensemble. Où ai-je rêvé ? Ça s’est carapaté le long du mur avec un bruit affreux avant de disparaître dans un trou. Il paraît que c’est un présage. » L’archaïsme règne mais une modernité que l’on peut qualifier d’humaniste émerge, représentée par les deux enquêteurs. « Il y a des choses en ce monde que personne ne peut changer, et le droit du plus fort en est une, quelles que soient les bavasseries de ton cher Rousseau », balance un personnage désagréable dans les dents de Cecil Winge, lequel, un peu plus tard, en vient à se dire que « personne ne devient criminel sans d’abord avoir été victime ». Niklas Natt och Dag (né en 1979) « est le descendant d’une des plus anciennes familles de la noblesse suédoise » : ainsi l’auteur est-il présenté sur la couverture de l’ouvrage. Renvoi au contenu du roman, bien entendu. Peu d’écrivains suédois ont décrit leur société à une époque aussi lointaine (Strindberg, certes, ou Moberg, mais guère plus). Quoi que, deux siècles et quelques années, qu’est-ce, dans l’histoire de l’humanité ? Ce volume fera date, incontestablement.
* Niklas Natt och Dag, 1793 (1793, 2017), trad. Rémi Cassaigne, Sonatine, 2019
1794

Après 1793, roman dans lequel un crime commis à la fin du XVIIIe siècle à Stockholm était résolu par deux improbables enquêteurs nommés Jean Michael Cardell et Cecil Winge, Niklas Natt och Dag avance dans le calendrier. Voici aujourd’hui Cardell et Winge (son frère, cette fois, Emil) amenés à enquêter sur la mort d’une jeune fille, qui aurait été victime d’une attaque de loups le jour de son mariage - « qui d’autre que des loups en meute auraient pu lui faire autant de mal ? » Auparavant, le marié, le jeune Erik Tre Rosor, séjourne sur l’île de Saint-Barthélémy, où il découvre les ravages de l’esclavage. Quand il rentre en Suède, c’est avec Ticho Ceton, un homme apparemment plus humaniste que les autres, qui le prend sous son aile et lui assure qu’il veillera sur lui. Erik lui laisse la gestion de son domaine. Alors que la Terreur s’exerce en France, la Suède est à cette époque gouvernée par l’autoritaire baron Reuterholm, qui craint la contagion de la révolution et va jusqu’à interdire la consommation de café. « Les cafés rassemblent le haut et le bas du pavé et tout ce qu’il y a entre, on y fraternise et on y brocarde l’autorité à qui mieux mieux. Le baron veut un peuple silencieux et docile, aussi cloue-t-on les graines noires au pilori. » Sans trop de surprise, l’enquête mène à l’orphelinat que dirige Ceton. L’intérêt de cet ouvrage est surtout dans les descriptions d’un Stockholm d’il y a plus de deux cents ans – ce pourrait être le Moyen Âge. (Note au traducteur : d’origine germanique, le mot « schlass », p. 172, ne sera en usage qu’à la fin du XIXe siècle.) L’aristocratie règne, s’en donnant à cœur joie, et la populace survit dans des conditions de précarité extrêmes. Le tableau est sombre. Comme dans le précédent volume, l’auteur ne rechigne pas à décrire des corps blessés, torturés, avec un luxe de détail. Ayez le cœur accroché, lecteurs !
* Niklas Natt och Dag, 1794 (1794, 2019), trad. Rémi Cassaigne, Sonatine, 2021
1795

Après 1793 et 1794, Niklas Natt och Dag conduit le lecteur en 1795. « Ce siècle a vu s’accomplir beaucoup de bonnes choses. Les idées nouvelles promettent un avenir plus lumineux. » Heureux auspices ? La Suède, « cette ancienne grande puissance qui vacillait aujourd’hui comme un ivrogne au bord du précipice », est toujours en pleine ébullition, la famille royale se sent menacée et réprime à tout-va les opposants éventuels. Jean Michael Cardell et Emil Winge unissent leurs efforts pour retrouver Anna Stina Knapp avant la police secrète. La jeune femme serait en possession d’une lettre indiquant des noms de conspirateurs, que les autorités souhaitent récupérer au plus tôt. Enquêtant dans un Stockholm guère affriolant tant la crasse et la violence y affleurent, ils en profitent pour venir en aide aux filles d’origine modeste maltraitées par les détenteurs de pouvoir en tout genre. Leur allure n’est même pas insolite : « Cardell, le manchot, avec son poing en bois encore noirci de suie, pendu par ses lanières à son épaule, et à côté de lui Winge le fou, absolument immobile, pipe au coin des lèvres et mains jointes dans le dos. » Ou est-ce ainsi que les voit Tycho Ceton, « diable défiguré », sinistre personnage organisateur d’orgies, à présent en fuite après avoir perdu tout ce qu’il possédait et traqué par Cardell et Winge. Comme s’interroge l’un de ses vagues protecteurs, « certains se sont demandés avec force quelle sorte d’homme avait si peu d’amis qu’il devait se tourner vers ses ennemis pour chercher assistance... » Abondant de détails, 1795 est un roman dense. Le lecteur est complètement immergé dans une époque relativement proche et qui n’a pourtant plus grand-chose à voir avec la nôtre. À l’exception peut-être de la corruption et de la lutte pour le pouvoir, peu visibles en Suède mais qui prospèrent partout ailleurs ou presque. Tenus par une intrigue forte, les trois volumes de Niklas Natt och Dag, 1793, 1794 et 1795, forment un ensemble cohérent présentant des personnages singuliers et une ville en plein devenir. Une œuvre profondément originale.
* Niklas Natt och Dag, 1795 (1795, 2021), trad. du suédois Rémi Cassaigne, Sonatine, 2023
Comment cuire un ours

« Le ciel est froid au-dessus des paysages du Norrland, tel l’œil vide d’un géant. » Comment imaginer que des crimes puissent être commis là, à Pajala, où la densité de population est si faible ? Nommer son enquêteur, pasteur dans « les contrées du Grand Nord de la Suède », Lars Levi Læstadius, il fallait oser. Car, personnage réel, Lars Levi Læstadius (1800-1861) est surtout connu pour avoir fondé une branche dissidente du luthérianisme, dont se revendiquent nombre de Sames encore aujourd’hui. Dans ce livre de Mikael Niemi (né en 1959, à Pajala), Comment cuire un ours, Læstadius est assisté d’un jeune orphelin same, Jussi, bientôt rebaptisé Johan Sieppinen, aussi perspicace qu’obéissant. Tous deux vont essayer de retrouver une jeune fille disparue, enlevée par un ours, selon la population et un commissaire de police autoritaire et lourdaud. Passionné de botanique, Lars Levi Læstadius se conduit à la façon de Sherlock Holmes et Jussi joue le rôle du docteur Watson. « Remarque la forme de ces taches, Jussi, ce sont des gouttes qui ont aspergé la blouse, en tombant d’une certaine hauteur. Sur l’envers de l’étoffe, elles sont moins marquées, avec des contours estompés, ce qui signifie que le sang n’a pas totalement traversé. Autrement dit... ? » La Tornédalie, cette région du nord de la Suède limitrophe de la Finlande, au-dessus du golfe de Botnie, abrite des villages reclus sur eux-mêmes, où la foi, se désole le pasteur, n’est que superstition. C’est un homme cultivé, intelligent, tolérant, que présente là Mikael Niemi. Un pédagogue qui apprend à Jussi à parler convenablement et espère bien éradiquer le « Mal » de la région car « le venin du Serpent suinte goutte à goutte sur Pajala ». La cause ? L’alcool. « Avec l’instruction, l’ivrognerie diminuerait, le pasteur en était convaincu. Le peuple des campagnes, quand il aurait goûté à l’érudition, préférerait débourser pour des livres plutôt que de l’eau-de-vie. » Hélas, ce fléau, les tenanciers et autres marchands ont intérêt à le voir se répandre. « ...L’alcool, ce venin, cette pisse corrosive qui embrase les foyers pour ne laisser derrière elle que des huttes en cendres et des enfants abandonnés. » Un roman bien construit, plein d’érudition, intelligent, autour de la figure d’un personnage incontournable de la Tornédalie. De l’écrivain, on trouvait, traduit en français, Le Goût du baiser d’un garçon, un agréable roman contemporain (les années 1960) au titre ambigu et trompeur. Ce nouveau livre, au titre également déconcertant, nous entraîne presque deux siècles plus tôt. Une belle surprise.
* Mikael Niemi, Comment cuire un ours (Koka björn, 2017), trad. Françoise et Marina Heide, Stock (La Comopolite), 2021
Celui qui a vu la forêt grandir

« Les souvenirs sont presque toujours liés à un endroit. Les miens, je les ai déposés dans la forêt », confesse Kåro pour elle-même dans ce roman de Lina Nordquist (née en 1977, chercheuse en biologie et membre du Parlement suédois pour les Libéraux depuis 2018), Celui qui a vu la forêt grandir. Quel livre ! 1897. Accusée de pratiquer des avortements, Unni fuit la Norvège avec Armod, un vagabond qu’elle connaît à peine, et Roar, son nouveau-né. « Oui, lui ai-je dit. On est arrivés. » Elle ne sait pas exactement où, peut-être dans le Hälsingland, la région semble accueillante, c’est là qu’ils vivront, sans retour possible. « ...Ici, il y avait du lin, des collines bleues, et un ciel ardoise. » Une maison en piteux état leur est louée, « l’avenir nous appartenait » croit-elle. Ils la rénovent comme ils le peuvent, travaillent. Plus tard, beaucoup plus tard, en 1973, dans cette maison ne vivent plus que Bricken, veuve de Roar, et sa belle-fille Kåra, cinquante-trois ans, veuve elle aussi. Deux récits vont s’entrecroiser, deux époques avec chacune ses tourments, à côtoyer la mort plus souvent qu’à son tour. « Il fallait vivre avec la forêt. Celui qui s’oppose à la nature est perdu », observe Unni. Mais l’installation se passe moins bien que ce qu’elle et Armod avaient espéré, les hivers sont rudes et, l’été, la canicule peut sévir. Bientôt, la famine les frappe. « Nous pourrissions de l’intérieur, nous êtres humains, soumis à une épreuve que nous n’arrivions pas à surmonter. » Quand Armod décède, le paysan propriétaire de la baraque exige son « dû » : Unni. Comme en écho et à quelques décennies de là, Kåra se remémore ses jeunes années, quand elle s’éprend de Dag, le fils de Roar et de Bricken, un sale type ; elle se débarrassera de lui comme elle parviendra à éliminer quiconque tente de lui gâcher sa vie. Sur deux époques, la campagne suédoise se déploie ici pour accueillir divers personnages, elle est un personnage à part entière, chatoyante et inattendue. « Ce n’est pas la forêt, le danger (…). Mais le feu, la faim et les autres », prévient Roar. « J’étais aussi seule qu’une souche moisissant au fond de la forêt », songe, de son côté, Unni : « Nous autres humains, nous ne sommes sur Terre que l’espace d’un instant », réfléchit-elle encore à quelques reprises (rejoignant le Vilhelm Moberg de Mon instant sur cette terre !). Celui qui a vu la forêt grandir est un roman qui a rencontré un grand succès en Suède, ce qui est tout à fait justifié. Tour à tour enthousiasmant, triste, affligeant, débordant d’espoir, il soumet le lecteur à une gamme de sentiments forts. Le bonheur n’a pas qu’un visage, il est comme le malheur, généreux ou ingrat selon les jours. Ce roman nous le démontre de manière assez prodigieuse.
* Lina Nordquist, Celui qui a vu la forêt grandir (Dit du går, följer jag, 2021), trad. Marina Heide, Buchet-Chastel, 2023
