Q-R-S
Un Amour infaillible

La « trilogie » des Neshov comptera donc au moins... cinq volumes. Celui-ci, Un Amour infaillible, poursuit la narration entreprise avec La Terre des mensonges. Les différents membres de la famille Neshov sont éparpillés en Norvège et au Danemark. Torrun revient à la ferme, embauchée par Margido, son oncle, dans son entreprise de pompes funèbres. Le travail lui convient. Anne B. Ragde offre dans ce volume de très intéressantes pages sur le métier de « croque-mort », quelque peu déconsidéré ou mal connu et pourtant indispensable. C’est d’ailleurs ce qui en fait l’intérêt principal, car le reste est poussif. Pourquoi systématiquement nommer les objets par leur marque ? Nombre d’auteurs le font, c’est une mode, entendu, mais n’est-ce pas lassant ? Quant à l’action... Il ne se passe grand-chose dans ce livre dont les personnages ne sont pas des plus sympathiques. Nous ne nous en plaindrons pas, mais on peut se demander ce qui en lie les trois cents soixante pages.
* Anne B. Ragde, Un Amour infaillible (Liebhaberne, 2017), trad. Hélène Hervieu, Fleuve, 2018
Les Liens éternels
Après la mort de son oncle Margido, Torunn reprend son entreprise de pompes funèbres. Ainsi commence le roman de Anne B. Ragde, Les Liens éternels. Comme dans les précédents romans de la série Neshov, l’évolution des relations familiales constitue le gros de l’intrigue. Les personnages peinent à se déployer, tous un peu, beaucoup insignifiants. Anne B. Ragde nous relate ainsi en long et en large les questionnements de Torunn : sur la couleur du papier-peint, la pâte à gaufres, sa nouvelle cuisine ou sa nouvelle salle de bain, ses collants qui filent, ses lectures (sans originalité, « ...deux romans qui avaient reçu de bonnes critiques »). Ah ! Et ces « magazines de déco hors de prix »... ! Le célibat lui pèse, heureusement le pasteur est sensible à son charme, à moins que ce ne soit un vieil ami. Des pages et des pages de considérations au ras du sol et des larmes en veux-tu, en voilà. Ce n’est pas palpitant – et nous sommes gentils. Une série (cinq volumes) de moins en moins intéressante au fil des parutions. Ronf, ronf... !
* Anne B. Ragde, Les Liens éternels (Datteren, 2019), trad. Hélène Hervieu, Fleuve, 2020
L’Espoir des Neshov

L’Espoir des Neshov, de Anne Birkefeldt Ragde, conclut les trois volumes précédents : La Terre des mensonges, La Ferme des Neshov et L’Héritage impossible. Une trilogie familiale, dans laquelle des événements survenaient et incitaient le lecteur à avancer dans le récit. Rien de tel ici, puisque nous retrouvons les personnages quelque temps après : chacun est rentré chez lui et vit sa vie – celle de responsable d’une entreprise de pompes funèbres pour l’un (Margido) ; de femme trompée qui s’en fiche pour l’autre (Torunn) ; ou encore, de jeunes pères (pour Erlend et son compagnon Krumm). Tout cela est bien gentil mais pas franchement passionnant, d’autant que les descriptions de courses alimentaires ou vestimentaires sur Internet ou la préparation de plats se succèdent, dans des milieux où l’argent n’est pas le premier des soucis. Les parturientes – par exemple – qui ne mènent pas « une vie de pacha » dans une « clinique privée » apprécieront. Mignon ? Limite. En espérant que cette « trilogie » ne comportera pas un cinquième volume. Mais au détour d’un chapitre, l’auteure s’insurge contre le sort que les cinéastes des studios Disney ont réservé au conte d’Andersen, La Reine des neiges, et là, nous ne pouvons que l’approuver : « ...Une version simplifiée, édulcorée et bourrée de stéréotypes sur les genres, alors que l’histoire parlait en réalité de deux pauvres enfants, Kay et Gerda, et non pas de deux sœurs qui ressemblaient à des blogueuses en quête de célébrité, minces comme un fil, à la taille de guêpe. »
* Anne B. Ragde, L’Espoir des Neshov(Alltid tilgivelse, 2016), trad. Hélène Hervieu, Fleuve, 2017
Je ferai de toi un homme heureux

Ah, comme c’est horripilant, ces quatrièmes de couverture du style « Anne B. Ragde est une romancière à succès, déjà traduite en 15 langues, aux millions d’exemplaires vendus » ! Est-ce réellement important ? Pourtant, la lecture de cet ouvrage de Anne B. Ragde n’est pas désagréable. L’auteure met en scène ici, dans un immeuble de la banlieue de Trondheim, huit familles représentatives des classes moyennes de l’époque – le milieu des années 1960. Dans chaque logement ou presque les femmes règnent ; les hommes ont des emplois salariés, elles s’occupent, elles, du foyer et des enfants. Leur objectif de parfaite ménagère est contenu dans le titre de l’ouvrage : Je ferai de toi un homme heureux. « Elle entendit ses propres paroles. Jusqu’à ce jour, pas une seule fois elle n’avait pensé à son ménage comme à un travail pesant, elle avait tout simplement l’habitude de le faire comme ça, un point c’est tout. » Le décor est important : table en formica, télévision à tube cathodique, couches lavables pour les jeunes enfants, etc. Plus qu’un roman à proprement parler, c’est un catalogue des us et coutumes en milieu urbain et dans un pays d’Europe occidentale de cette époque charnière, celle entre une société encore fortement liée à l’agriculture et une société comme nous la connaissons, où l’informatique règne. Il n’y a pas à proprement parler d’intrigue. Un ouvrage léger et plus intéressant qu’il n’y paraît, puisque fourmillant de détails sur des années encore proches et relevant déjà d’un autre temps.
* Anne B. Ragde, Je ferai de toi un homme heureux (Jeg skal gjøre deg så lykkelig, 2011), trad. Hélène Hervieu, Balland (Littérature étrangère), 2013
Une Montagne, un fusil, un lac

« Je ne peux rien affirmer avec certitude, parce qu’on a depuis longtemps franchi la frontière lumineuse de la mémoire, lui et moi. » Lars-Einar a neuf ans en 1983 quand son père, « toujours entre deux eaux, à la fois poète, athlète, aventurier », l’emmène pour une promenade dans la montagne norvégienne. L’aventure, puisqu’il s’agit d’une véritable aventure contée là par Lars Ramslie (né en 1974 à Tønsberg), n’est pas de tout repos et au fil des pages prend une allure de véritable rite initiatique. Peut-être à cause d’une maladie au cerveau, ce père est assez imprévisible, capable de colères monstrueuses et pour cela rejeté par la plupart de ses proches, à commencer par la mère du gamin. Sobre, il n’est pas dépourvu de bons côtés, aimant à se montrer généreux et à jouer les vedettes, mais quand il boit, comme tant d’autres hommes, il fait preuve d’une grande violence, que le lecteur découvre au fur et à mesure du récit. « Toi avec tes cheveux longs à la Samson, une grosse barbe sur les joues et jusqu’à la pointe du menton, avec des allures de gourou, sachant écrire et féru de rhétorique, pugiliste émérite... » Le passage dans une fête foraine est éloquent du type de personnage immature que ce père incarne aux yeux de son fils. Lars Ramslie, dont le premier roman paru en 1997 (Biopsi, non traduit en français) a été récompensé par le prix Tarjei Vesaas, livre là un récit fort, cependant assez courant dans la littérature.
* Lars Ramslie, Une Montagne, un fusil, un lac (Fjellet, geværet, vannet, 2023), trad. du norvégien Hélène Hervieu, Paulsen (La Grande ourse), 2024
Le Tribunal des oiseaux

Le lecteur ne sait trop ce que Allis Hgtorn fuit, mais la voici aujourd’hui aide à domicile d’un homme qui ne cesse de l’étonner. Il est vrai qu’elle n’est pas non plus une employée comme les autres, elle qui exerce ce métier pour la première fois – un métier fort loin de celui qui était le sien auparavant, sur une chaîne télévisée. À présent, « j’avais tout le nécessaire : la solitude, de longues journées à remplir, des obligations prévisibles et peu nombreuses. J’étais libérée du regard des autres, les rumeurs ne pouvaient plus m’atteindre. Et j’avais un jardin pour moi toute seule. » Croyant avoir été embauchée par un vieux ronchon pour s’occuper de sa maison et surtout de son jardin, elle découvre que Sigurd Bagge, certes peu loquace, n’est guère plus âgé qu’elle et qu’il n’est pas le monstre qu’il paraît au premier abord. Mais le mystère qui émane de lui la déroute. « J’étais épuisée. J’avais toujours un temps de retard par rapport à lui, il me manœuvrait selon son humeur, agissait sur des coups de tête. Je me sentais triste, esseulée. » Une surprenante liaison s’installe entre les deux personnages, que la journaliste Agnes Ravatn (née en 1983) restitue par petites touches, avec une montée en tension progressive et une fin qui peut décontenancer le lecteur. S’il fallait faire une comparaison, ce serait peut-être avec les écrits de Vigdis Hjorth, autre Norvégienne abordant par le biais de la fiction des thèmes d’actualité. Le Tribunal des oiseaux est un roman inattendu, l’une de ces bonnes surprises que nous offrent régulièrement les éditions Actes sud.
* Agnes Ravatn, Le Tribunal des oiseaux (Fugletribunalet, 2013), trad. Terje Sinding, Actes sud (Lettres scandinaves), 2023
Le Gang des bras cassés

De Tore Renberg (né en 1972), nous avions beaucoup apprécié L’Homme qui aimait Yngve(2003, paru en France l’année suivante, chez Odin), un peu moins les volumes suivants : nous nous étions endormis sur Les Rois du pétrole. Celui-ci, Le Gang des bras cassés, dans la même veine, nous éreinte littéralement. L’intrigue est là, pourtant, une vraie intrigue, avec de vrais personnages... : Ben et Rikki, deux frères grands adolescents, décident de cambrioler la maison de leur oncle, acteur porno, à Stavanger, ville où, nul ne l’ignore, le pétrole et donc l’argent coulent à flot. « À l’âge de cinq ans, les gosses ont des iPad. Nous vivons dans la ville la plus riche du monde. Et les perdants, c’est qui ? Les junkies ? Non. Les handicapés mentaux ? Les vieux ? (…) Tous ceux-là, les sociaux-démocrates s’en occupent. Les perdants (…), c’est nous. » Et également les lecteurs, peut-on ajouter. Car les petits trafics et les petites misères de ces « bras cassé » (le titre, pour une fois, est approprié), ne sont pas des plus passionnants, les dialogues ne s’élèvent jamais bien haut non plus. Déception.
* Tore Renberg, Le Gang des bras cassés (Angrep fra alle kanter, 2014), trad. Terje Sinding, Presses de la Cité, 2018
D’autres étoiles

À la différence d’autres auteurs, Ingvild H. Rishøi (née en 1978 à Oslo) n’écrit pas pour ne rien dire. Très fort, ce roman, D’autres étoiles, avec deux ou trois leçons de vie dès les premières pages : quand le gardien de l’immeuble explique à Ronya, sa jeune locataire (forcément « fille de brigands », Astrid Lindgren a fait des émules), comment son papa peut décrocher un boulot de vendeur de sapins... ! Sous-titré Un Conte de Noël, il fait évidemment référence à La Petite fille aux allumettes d’Andersen. Le papa de Ronya (laquelle est par ailleurs la narratrice) est donc embauché pour vendre des sapins sur un bout de trottoir. Le voici soumis à des horaires pas trop sévères mais qui le contraignent à ne plus fréquenter le Stargate, bar où se retrouvent ses amis, afin de conserver une certaine sobriété. Difficile ! Quand il est mis à la porte, Mélissa, sa fille aînée, le remplace, regrettant la situation familiale (« deux enfants sans mère et avec un père alcoolique »). Tommy, un employé, a une idée : si la petite sœur se montre, les clients seront attendris et achèteront plus de sapins. Puis une autre idée : s’ils proposent, à eux trois, de livrer les sapins, les clients seront contents et ça rapportera. Mais le patron ne l’entend pas de cette oreille. Présenté comme le premier roman de Ingvild H. Rishøi, journaliste « de fond » auteure de nouvelles et de livres pour enfants, D’autres étoiles a une fin qui n’est pas sans évoquer celle du conte d’Andersen. Tout n’est pas bien qui finit bien. Comme la vie. Un roman qui aborde, mine de rien, le thème de la précarité (pas seulement salariale) et celui de l’immigration. Qui brandit avec intelligence et sensibilité les valeurs de solidarité et de liberté. Un roman traité avec un humour iconoclaste (« Croire, c’est bon pour la mosquée. »), qui laisse un goût de revanche à prendre sur cette vie. Un roman qu’on recommande vivement.
* Ingvild H. Rishøi, D’autres étoiles (Un Conte de Noël) (Stargate, En julefortelling, 2021), trad. Jean-Baptiste Coursaud, Mercure de France, 2022
Une Femme dans la nuit polaire

Publié pour la première fois en Autriche en 1934 (et en français, chez Denoël, en 1952), ce roman, Une Femme dans la nuit polaire, relate le séjour de Christiane Ritter (1897-2000) auprès de son mari, Hermann, sur l’île du Spitzberg. Celui-ci, trappeur, insiste pour qu’elle vienne le rejoindre. Elle hésite d’abord. « …Pour moi, comme pour tout Européen calfeutré dans son existence confortable, un séjour prolongé dans les régions polaires signifiait (…) une double misère : un froid sibérien, dans le sens littéral du mot, et une solitude pesante, continuelle, intolérable. » Elle finit pourtant par se laisser convaincre et, l’été 1933, accoste au nord de l’île. Il lui faut très vite s’adapter à une existence rudimentaire et s’imposer, comme femme, face à son mari et à Karl, compagnon de chasse de celui-ci. « …J’ai l’impression d’être bien petite, une pauvre fourmi perdue dans un univers démesuré. » Mais la jeune femme a des ressources et surmonte vite ses réticences, découvrant que la vie dans cet espace sauvage, avec la « splendeur lumineuse du paysage », peut ne pas manquer d’attraits. Une Femme dans la nuit polaire évoque par moment les récits de Jack London, quand l’homme – ou, ici, la femme – doit faire face aux éléments déchaînés pour survivre. Bien que l’époque et les conditions soient différentes, on peut penser aussi au Voyage d’une femme au Spitzberg de Léonie d’Aunet. « L’Arctique ne dévoile pas ses mystères à ceux qui ne font que l’effleurer. (…) Il faut avoir vu de ses propres yeux cette mort de toutes choses, pour apprécier la vie : le retour de la lumière dans la magnificence de la glace, la juste ordonnance de l’univers, c’est là que résident le secret de l’Arctique et sa beauté grandiose. » D’une lecture aisée (et ne s’attardant pas sur les relations entre la narratrice et son mari, qui ne couchent apparemment jamais ensemble), on comprend vite pourquoi ce livre fait partie des classiques de la littérature dite polaire. Issue d’une famille d’intellectuels, Christiane Ritter se fera ensuite connaître comme peintre.
* Christiane Ritter, Une Femme dans la nuit polaire (Eine frau erlebt die polarnacht, 1938), trad. de l’all. (Autriche) Max Roth, Denoël, 2018
Alberte et la liberté
Ce roman, Alberte et la liberté, s’intitule en norvégien Alberte og friheten. Pourquoi affubler le titre français d’une esperluette sur la couverture ? N’est-ce qu’un détail ? Les éditions des Femmes avaient publié Alberte et Jacob, le premier volume de cette trilogie, en 1991, passé plutôt inaperçu en France. Un très grand succès en Norvège, du vivant de Sara Fabricius, dite Cora Sandel (1880-1974). Un roman initiatique, autour de la figure de cette Alberte Selmer, « une proie banale, une femme », qui pose pour des peintres dans le quartier du Montparnasse, à Paris, dans les années 1910. La bohème artistique se trouve rassemblée là et les échanges sont fructueux. Alberte y assiste sans réussir à s’intégrer véritablement. Elle vit des histoires d’amour tristes ou sans perspectives, subit un avortement. Sa description du Paris du début du XXe siècle fourmille de détails (on peut penser à L’Autre Paris du Suédois Ivar Lo-Johansson, un peu plus tardivement), comme « cette chaude soirée d’août » sur le boulevard de Clichy. « D’immenses affiches expliquent que l’on peut voir ici, entre autres curiosités, des tribus anthropophages originaires du centre de l’Afrique. » Du coup, « l’atmosphère est dense, traversée d’effluves, beignets de pommes, crêpes, bêtes sauvages. » Une trilogie que l’auteure assurait non autobiographique. À quand la publication du troisième tome (Bare Alberte, Alberte et rien qu’elle) ? Tous les trente ans, cela nous fait vers 2050 ! Et peut-être les trois titres réunis en un seul volume pour la fin du siècle ? Entre la Norvège et la France, ce pont littéraire, artistique, toujours, donc, à découvrir.
* Cora Sandel, Alberte et la liberté (Alberte og friheten, 1931), trad. Françoise Heide, Presses universitaires de Caen/Office franco-norvégien d’échanges et de coopération, 2020
Un Fugitif recoupe ses traces

S’il est un livre qui fut longtemps précédé par sa réputation, c’est bien celui-ci, Un Fugitif recoupe ses traces, du Dano-Norvégien Axel Nielsen, dit Aksel Sandemose (1899-1965). Né à Nykøbing-Mors, dans le Jutland, petite ville immortalisée plus tard dans son œuvre sous le nom de Jante, Sandemose choisira la Norvège comme patrie littéraire. En France, ce livre n’a été traduit qu’en 2014. Ce n’est pas un roman policier, certes, bien qu’un meurtre soit annoncé dès les premières pages. Un meurtre déjà ancien, dont le narrateur s’accuse, dont il use surtout pour parler de ce qui fut sa vie et celle des siens dans cette petite ville fictive de Jante. « Pour moi, il n’existe pas d’endroit plus sordide au monde. » Voilà qui est dit ! Un Fugitif recoupe ses traces n’est peut-être même pas à proprement parler un roman, plutôt une suite de récits qui se répondent, se complètent, forment un ensemble cohérent qui finit par laisser apparaître le portrait psychologique du narrateur, Espen Arnakke (qui apparaît dans quatre romans), né à Jante et fils d’ouvrier, et surtout celui d’une ville selon lui terriblement oppressante. « Comment un être peut-il se trouver une âme dans un milieu pareil, comment Jante peut-elle enfanter autre chose que des esclaves – ainsi qu’un ou deux scorpions ou meurtriers ? » Les dix commandements de la « loi de Jante » ont mille fois servi à illustrer, à tort ou à raison, la rigidité morale des Pays nordiques : « 1. Tu ne dois pas croire que tu es quelque chose. 3. Tu ne dois pas croire que tu es plus intelligent que nous. 6. Tu ne dois pas croire que tu vaux mieux que nous. » Et ainsi, à l’avenant. Il s’agit d’une fiction, rappelons-le, mais les critiques de tous poils des sociétés nordiques, à commencer par les Nordiques eux-mêmes, spécialistes s’il en est de l’autocritique, ont cru distinguer dans ces « commandements » l’essence d’une culture. Résistant réfugié en Suède durant la Deuxième Guerre mondiale, écrivain polémiste qui signa des articles dans la presse ouvrière, Aksel Sandemose fut assez précurseur dans sa façon de décrire le monde, associant volontiers politique, psychanalyse et sexualité. Plusieurs de ses romans ont été publiés en France (Le Loup-garou, R. Laffont ; Le Marchand de goudron, Actes sud ; Le Clabaudeur, L’Élan…).
* Aksel Sandemose, Un Fugitif recoupe ses traces (En flykting krysser sitt spor, 1933), trad. Alex Fouillet, préf. Philippe Bouquet, Presse Universitaires de Caen/OFNEC, 2014
Lucie

« Seigneur, comme la vie était différente de ce qu’on imagine. » En France, on connaît Amalie Skram (1846-1905) pour cette trilogie naturaliste publiée au début des années 2000 par les éditions Gaïa, Les Gens de Hellemyr (en fait, quatre romans en trois volumes). Le traducteur et éditeur Vincent Dulac nous propose aujourd’hui Lucie, un roman de mœurs, peut-on dire, qui plaça l’auteure au banc de la société de son époque. Lucie, personnage central, une jeune femme de vingt-trois ans, a épousé un avocat d’une quarantaine d’années. Il recherchait une femme pour tenir son foyer, alors qu’elle, si jeune et à la réputation de « femme de mauvaise vie », a surtout envie de s’amuser et de danser. N’est-elle pas « la petite femme de Tivoli, la fille du charpentier Rasmussen, l’ancienne danseuse de revue... » ? Il est jaloux, les querelles entre eux se succèdent. Ce roman s’inscrit dans la « percée moderne », ce renouveau de la littérature des pays nordiques souhaité alors par le critique danois Georg Brandes. Lucie n’est pas des plus sympathiques ; elle n’agit pas au nom de la liberté ou de l’émancipation féminine. Ce qu’elle voit, c’est son quotidien : à son âge, la voici contrainte de se flétrir auprès d’un homme engoncé dans les traditions, qui lui reproche de mal se comporter. « Tu as tes amis, toi, tu as tes affaires », rétorque-t-elle, « tu fréquentes des dames, tu vas à des soirées, tu t’offres des parties de campagne, des promenades en ville et j’en passe. Et moi... moi, je suis comme en prison... » Elle étouffe. Par qui remplacer son mari ? Un homme de son rang, lui importe-t-il. Mais un vagabond la violente. « Elle rêvait d’un beau lieutenant et se voyait offrir un vulgaire ouvrier... », qui de plus la met enceinte. Mme Reinertson, douée de « ...cette instruction, cette culture et cet esprit bien fait », auprès de qui Lucie se confie parfois, n’est hélas disponible que de loin et loin. Lucie est désemparée. C’est un peu par défaut qu’elle réclame des droits. L’humour d’Amalie Skram met bien en exergue le statut des femmes à l’époque : « ...Une femme qu’on épouse doit être pure, aussi vrai que Dieu existe ! » Et ce, « pour être le parfait reflet de son mari ». Outre son aspect égalitariste et, finalement, féministe, Lucie est un beau tableau de la vie d’une certaine petite bourgeoisie à la fin du XIXe siècle en Norvège.
* Amalie Skram, Lucie (Lucie, 1888), traduit du norvégien et annoté par Vincent Dulac, Cupidus Legendi, 2023
Onzième roman, livre dix-huit

Dans sa préface, l’écrivain japonais Haruki Murakami se lance dans l’explication du titre de ce roman de Dag Solstad, Onzième roman, livre dix-huit (tout simplement parce que sur dix-huit livres publiés, celui-ci est le onzième roman de Dag Solstad) et révèle par ailleurs pourquoi il considère ce livre comme une œuvre remarquable. Le percepteur Bjørn Hansen (« ...un homme qui avait eu la chance de pouvoir tout quitter... ») laisse derrière lui son épouse et leur enfant de deux ans pour rejoindre à Kongsberg, petite ville à soixante-dix kilomètres à l’ouest d’Oslo, Turid Lammers, une comédienne dont il est follement épris. Les représentations théâtrales les rapprochent, avant de les éloigner. Quatorze ans plus tard, le couple se sépare. Bjørn Hansen loge seul dans un appartement, jusqu’à ce que son fils se rappelle à lui et vienne emménager pour mener des études d’opticien. Écrit d’une traite, avec très peu de retours à la ligne ou de chapitres, ce roman aux accents kafkaïens met en scène un homme que l’on peut qualifier de quelconque, qui ne voit le monde qu’au travers de sa personne et qui est, de fait, peu sympathique. Un employé du Trésor public, qui avoue avoir le cœur brisé lorsqu’il doit confisquer « leur appartement aux gens ordinaires incapables d’honorer leurs engagements. (…) ...Mais nul ne le voit sur mon visage car mes sentiments ne peuvent de toute façon pas aider les gens concernés. » Un huissier tiendrait-il un autre discours ? Un jour, on ne sait trop pourquoi, une idée terrible le traverse, et il s’associe avec un médecin de ses amis et un autre médecin de Vilnius pour la réaliser. « ...Il ne voyait absolument rien de génial à avoir réussi à tromper les gens en leur faisant croire qu’il était paralysé et de ce fait se retrouvait cloué à un fauteuil roulant, alors qu’en vérité il n’avait pas le moindre problème de santé... » Onzième roman, livre dix-huit ne compte que des anti-héros plongés dans une existence sans sel. Roman étonnant, sur la banalité de l’être, pourrait-on dire sans vouloir paraphraser Hannah Arendt, quand cet être flirte avec un mal anodin, heureusement peu conséquent. Dag Solstad (né en 1941) est traduit dans de nombreuses langues et, en Norvège et dans les Pays nordiques, a reçu des prix prestigieux pour l’ensemble de son œuvre. Celle-ci a pourtant d’abord été accueillie sèchement, Solstad faisant profession de foi marxiste. Avec son acolyte Jon Michelet (par ailleurs connu ici comme auteur de romans policiers), il est célèbre comme spécialiste du football. On ne trouvait traduit de lui qu’un roman, Honte et dignité (trad. Jean-Baptiste Coursaud, Les Allusifs, 2008). Onzième roman, livre dix-huit lui procurera sans doute de nouveaux lecteurs attentifs.
* Dag Solstad, Onzième roman, livre dix-huit (Ellevte roman, bok atten, 1992, 2005 ; préface Haruki Murakami, trad. du japonais Jean-Baptiste Flamin), trad. Jean-Baptiste Coursaud, Noir sur blanc (Notabilia), 2018
T. Singer

« C’était un cogiteur dépourvu de caractère, un négateur de vie dépourvu d’identité, un esprit exclusivement négatif qui observait tout d’une manière presque autosacrificielle. » Durant sa jeunesse, T. Singer, le personnage central du roman éponyme de Dag Solstad (on ne saura jamais son prénom), se laisse porter, il ne sait pas ce qu’il veut, il évite les choix. «À l’âge de trente-et-un ans seulement, il sentit qu’il était temps de faire preuve de détermination. » Un poste de bibliothécaire à Notodden, une petite ville du Telemark, voilà qui peut correspondre à sa personnalité. Il n’a pas d’ambition, ne désire rien, sauf peut-être devenir écrivain. Une phrase lui trotte dans la tête depuis « l’âge de vingt ans » : « Un beau jour il se tint face à un souvenir mémorable qui le submergea et le fit tomber à terre. » Il n’y a quasiment pas d’intrigue et le héros-qui-n’en-est-pas-un n’est pas des plus sympathiques. Rien ne se passe pendant des pages et des pages, puis tout s’accélère et le lecteur, à son grand étonnement, se trouve emporté. Singer épouse une céramiste ; le couple bat de l’aile, ils vont se séparer ; mais elle meurt avant, un accident de la route, et il décide de s’occuper de la fillette de quatre ans qu’elle avait eue d’une précédente liaison. La vie à Notodden le lasse, il obtient un poste de bibliothécaire à Oslo, une promotion. Achète un appartement dans le centre. Scolarise la fillette sans parvenir à se faire aimer d’elle. Fréquente un ami. Son seul ami. Il pourrait en avoir d’autres, il n’est pas démuni mais rien ne force son intérêt, la solitude le comble et le roman se termine ainsi, dans une sorte de bonheur à peu de frais. À peu près comme dans Onzième roman, livre dix-huit, précédent ouvrage de Dag Solstad traduit en français. La préface de Sophie Divry donne envie de lire ce roman, T. Singer. Une lecture exténuante pourtant, tant la progression de la pensée du narrateur est laborieuse : il pense en boucle. Aussi, pour aller d’un point A à un point B, tournant sur lui-même et ressassant ses pensées, ne s’éloigne-t-il que très lentement de son point de départ. Le lecteur peut avoir envie de sauter des paragraphes. Cela ne se fait pas ? Chut !
* Dag Solstad, T. Singer (T. Singer, 1999), trad. Jean-Baptiste Coursaud ; préf. Sophie Divry, Noir sur blanc (Notabilia), 2021
Oiseau

C’est un court et beau roman que signe Sigbjørn Skåden (né en 1976) avec Oiseau. De la vraie science-fiction, évidemment dystopique. En 2048, quelques membres de la population humaine migrent, on ne sait pas pourquoi, sur une autre planète et sous un dôme fondent la cité de Montifringilla – Home. « Dans la lumière naissante, Montifringilla ne semble qu’un assemblage de constructions basses exposées aux éléments. Et le dôme, un trait au-dessus de la ville, un tracé illusoire. » Il n’y a pas d’atmosphère, la parole cesse, la communication se fait par écrit, grâce à des claviers d’ordinateurs. Le temps est aléatoire, il peut s’allonger, en fonction des vents violents qui soufflent à la surface et qui accélèrent ou ralentissent l’orbite de la planète. Chargée de consigner la vie quotidienne dans ce nouveau monde, ce à quoi elle renonce (« Je n’en peux plus, je ne veux plus consigner le manque de résultats pertinents, ces perpétuels rapports et analyses qui pointent vers la même obscure direction. »), Heindrun décide que sa fille Su sera un oiseau et qu’elle quêtera la lumière. En 2147, un vaisseau débarque, avec des individus venus de la Terre. La méfiance est de mise. « On est seuls depuis des générations, sans le moindre contact avec le monde extérieur. Et tout à coup, vous débarquez en force. Personne ne pense que vous nous voulez du mal, mais on a besoin de temps. » Les deux groupes peuvent-ils pactiser ? Dans l’immédiat, que faire d’autre qu’attendre ? Les habitants de Montifringilla comprennent qu’ils n’ont pas progressé depuis leur arrivée et que leur avenir est incertain : « Nous ne sommes qu’un fardeau ». Artiste et écrivain same, Sigbjørn Skåden signe là son deuxième ouvrage, après un roman sur le nord de la Norvège dans l’entre-deux guerres. Poétique et étonnamment réaliste, Oiseau est un texte fort, qui fera date, assurément : quel genre de vie peut avoir l’humanité si elle quitte la Terre ?
* Sigbjørn Skåden, Oiseau (Fugl, 2019), trad. Marina Heide, Agullo (Court), 2021
Veiller sur ceux qui dorment

Un drôle de sentiment nous envahit à la lecture de Veiller sur ceux qui dorment. Celui de ne pas avoir compris ce roman (ou ce récit ?) ou... que l’auteur est passé à côté de ce qu’il avait à dire (ou surtout, de ce que suggère la quatrième de couverture : « le point de départ est une vaste affaire d’abus sexuels qui a secoué la région quelques années plus tôt » ?). Kautokaino, Norvège, il y a quelques décennies et de nos jours, en parallèle. Amund Andersen est un artiste qui intervient au lycée de la petite cité lapone pour produire des vidéos avec les élèves. Il est jeune, mais plus âgé qu’eux. Il n’est pas insensible aux charmes des adolescentes. Des idylles se nouent. Il travaille aussi à monter une exposition de ses œuvres à Karasjok. « Il vient de Skånland, et vit aujourd’hui à Tromsø », dit de lui la directrice du centre culturel le jour du vernissage, auquel assistent une cinquantaine de personnes. « Diplômé de l’Académie des beaux-arts de Bergen, il a décroché cette année une bourse de travail de trois ans auprès du conseil des arts sames. » Il a tenu à réserver une surprise. Une vidéo qui le met en scène avec une adolescente, de manière de plus en plus scabreuse. Malaise. Malaise du public, malaise du lecteur. Et l’artiste s’en va. Le livre se laisse lire, il n’y a pas tant d’ouvrages écrits par des Sames, sur ce monde encore méconnu. Il ne tait pas l’ostracisme dont ils sont victimes – cf., par exemple, dans les dernières pages, ce match de foot entre des gamins : quand pour certains il devient nécessaire de déterminer qui est Same et qui ne l’est pas. On le sait, le racisme n’est pas qu’une question de couleur de peau. De Sigbjørn Skåden, un court texte d’anticipation, Oiseau, avait déjà été publié. Celui-ci nous convainc beaucoup moins.
* Sigbjørn Skåden, Veiller sur ceux qui dorment (Våke over dem som sover, 2014), trad. Marina Heide, Agullo (Fiction), 2022
Zombie nostalgie

L’idée de départ de Zombie nostalgie de l’écrivain norvégien Øystein Stene (né en 1969) a un air de déjà vu et pourtant, le lecteur se laisse prendre : un individu s’éveille quelque part, dans un lieu nommé Labofnia apprend-il rapidement, sans avoir conscience de son identité. Qui était-il ? Que fait-il là ? Il est un être neutre, « une sorte de personnage général, dépourvu de tout ce qu’on associe au mot ‘personnalité’ » : « Tout ce qui vous singularise en tant que personne – traits de caractère, souvenirs intimes, préférences affectives, caractéristiques physiques – semble effacé. » Il va peu à peu s’installer dans la « communauté autonome insulaire et démocratique » de Labofnia. Ou plutôt, le gouvernement lui donne un nom, un travail, un logement. Et il découvre que Labofnia est une île et que les humain, êtres plutôt différents de lui en dépit d’une ressemblance physique, la contrôlent et se méfient de ses habitants. Pourquoi ? Le roman est plutôt agréable à lire mais perd de son intérêt lorsque, comme l’indique le titre, il ne nous conte plus qu’une histoire de zombie. Les morts-vivants sont-ils parmi nous ? Comment les considérer, dans la mesure où ils ne poursuivent qu’un but : se rassasier d’être humains !
* Øystein Stene, Zombie nostalgie (Zombie nation, 2014), trad. Terje Sonding, Actes sud, 2015
N’oubliez pas leurs noms

Conçu comme un lexique, chaque lettre évoquant des souvenirs s’échelonnant entre la Deuxième Guerre mondiale et aujourd’hui, N’oubliez pas leurs noms est un roman de Simon Stranger (né en 1976). Dans les années 1950, un couple (les ancêtres juifs de l’épouse de l’auteur) et leurs enfants emménagent dans une belle maison de Trondheim. Le prix est peu élevé – et pour cause. « ...Si nous l’avons eue pour une bouchée de pain, c’est pour une raison bien particulière. » C’est ici, dans cette villa surnommée « Bandelklosteret », « le cloître de la bande », que Henry Oliver Rinnan (1915-1947) a sévi comme agent de renseignement de l’occupant nazi. Sous l’égide allemand, ce Norvégien jusqu’alors simple petite frappe, a constitué un groupe nommé « Sonderabteilung Lola », chargé d’infiltrer la résistance, d’arrêter ses membres et de les torturer pour obtenir des informations. Trondheim était un site important pour l’Allemagne de Hitler, qui souhaitait en faire un grand port militaire et une ville aryenne. Vivre dans cette maison de l’horreur n’est pas facile, surtout pour Ellen, dont le grand-père, marchand de vêtements à l’enseigne « Paris-Wien », a été torturé par ce Rinnan et exécuté. « ...Tu ne vois pas que cette maison va nous détruire ? » s’exclame-t-elle devant Gerson, son époux. Même refaite à neuf, les cris des victimes résonnent encore entre ses murs. N’oubliez pas leurs noms est un beau texte sur la mémoire, quand elle se niche là où on ne l’attend pas, et sur les raisons de l’engagement des uns et des autres de tel ou tel côté. Car si Rinnan et sa bande ont choisi d’infiltrer, de torturer et de répandre la terreur, des Norvégiens anonymes ont mis en place des réseaux d’entraide à destination des Juifs et des résistants. « Qu’est-ce qui pousse des gens, au péril de leur vie, à organiser une évasion au-delà de la frontière, à pied, en voiture, en bateau, pour aider des réfugiés... ? » Un souci d’humanité, peut-on répondre. Ce qui fait que la société norvégienne de cette époque ne ressemblait pas à l’enfer allemand. Aller de l’avant, comme beaucoup le préconisèrent après la défaite du nazisme, ne signifiait pas oublier la tragédie. De nombreuses questions et réflexions, donc, à la lecture de ce beau roman.
* Simon Stranger, N’oubliez pas leurs noms (Leksikon om lys og mørke, 2018), trad. Jean-Baptiste Coursaud, Globe, 2021
Car si l’on nous sépare

Edvard Munch n’a sans doute pas volontairement cultivé le mystère autour de sa personne mais, comme avec tout artiste de cet acabit, son caractère sombre a suscité nombre d’interrogations, lesquelles ont alimenté les secrets autour de son œuvre. Celles qui permettent à Lisa Stromme de tracer l’intrigue de ce beau roman, Car si l’on nous sépare. L’auteure (née en 1973), Anglaise qui vit aujourd’hui en Norvège, imagine ici une liaison entre Munch et Tullik, une jeune femme d’Ågårstrand. Liaison prohibée par la famille de celle-ci, qui considère, à l’instar de nombre de ses contemporains, le peintre comme un fou. Son œuvre est en effet tellement novatrice, tellement provocatrice… Comment la comprendre ? « J’essaye de peindre les questions insolubles que nous pose l’existence, toutes ces choses qui nous laissent perplexes. J’essaye de peindre la vie telle que nous la vivons », affirme Munch sous la plume de Lisa Stromme. Dans sa postface, celle-ci explique avoir inventé cette liaison, ou tout au moins avoir pris énormément de libertés avec la biographie de Munch. Le titre anglais de ce roman, The Strawberry girls, La Cueilleuse de fraises, met plus l’accent sur Johanne Lien, l’autre personnage principal (ils sont trois, donc : Edvard Munch, Tullik Ihlen et Johanne Lien), ici la narratrice. Cette jeune servante de seize ans, au service de la famille Ihlen et surtout de Tullik, peint elle-même et, du coup, observe Munch avec sympathie. Amie de Tullik qui fait d’elle sa confidente, elle voit la jeune femme s’enfoncer dans les affres d’un amour désespéré. Roman empreint de sensibilité qui permet d’aborder l’œuvre de Munch, dont certaines toiles apparaissent au fur et à mesure de l’intrigue, par un biais peu conventionnel.
* Lisa Stromme, Car si l’on nous sépare (The Strawberry girl, 2016), trad. de l’anglais Séverine Beau, HarperCollins, 2017
Le Livre de la mer ou l’art de pêcher un requin géant...
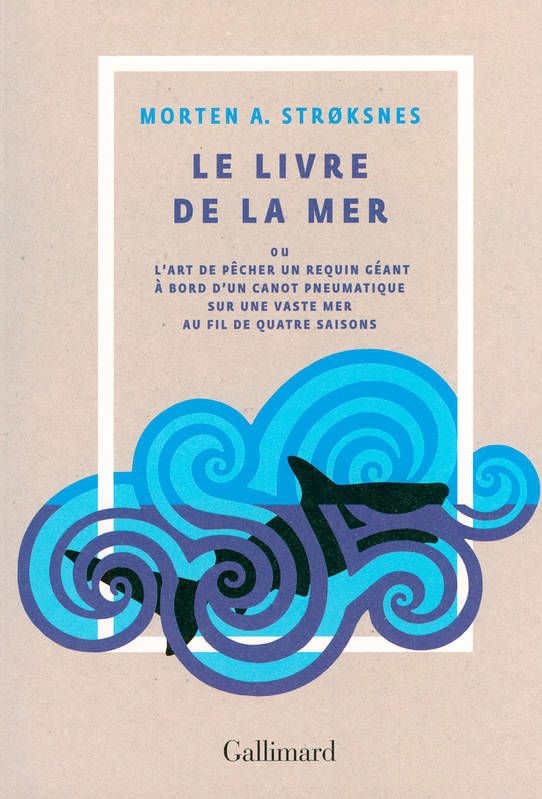
Le Livre de la mer ou l’art de pêcher un requin géant à bord d’un canot pneumatique sur une vaste mer au fil de quatre saisons fait partie de ces livres difficiles à classer. Doit-on opter ici pour le roman, le roman d’aventures quelque peu à la Jack London (pensons à La Croisière du Snarck) ou à la Herman Melville (Moby Dick), un ouvrage forcément dépaysant. Ou pour l’essai, brillant, érudit, sur la vie marine. Ce livre permet plusieurs approches et se laisse tranquillement dévorer en dépit du sujet initial : quand deux amis se retrouvent pour une partie de pêche au requin du Groenland, forcément pas de tout repos. Passant d’une anecdote à une autre et emmenant le lecteur de l’océan Atlantique à la mer de Barents en s’arrêtant longuement dans les îles Lofoten, Morten A. Strøksnes (né en 1965, journaliste et photographe) relate non seulement la vie des pêcheurs (« il régnait des conditions féodales en mer et, à bien des égards, les pêcheurs étaient les fermiers des propriétaires ») que celle de leurs proies, ces poissons considérés uniquement comme de la matière à exploiter. « Une baleine bleue peut avoir plus de huit mille litres de sang dans le corps, et les dépeceurs pataugeaient sans cesse dans la graisse, le sang et la chair pendant les quatre mois que durait la saison. » Les passages de l’ouvrage sur les baleines et autres rorquals et cachalots ne peuvent que révolter tout ami du monde animal. Pourchassées, tuées en grand nombre et notamment par la flotte norvégienne encore aujourd’hui, les baleines sont en voie de disparition, comme de nombreuses espèces de poissons, pourtant indispensables à la régulation de la vie des océans. C’est donc à une partie de pêche que le narrateur convie le lecteur, mais plus le récit avance et plus le cœur de ce lecteur se soulève, non pas à cause du mal de mer mais en raison des traitements infligés aux poissons par les pêcheurs et aux pêcheurs par la mer et leurs patrons. Les pêcheurs de naguère perdaient souvent la vie en mer, comme une fatalité, et ceux d’aujourd’hui, sur les bateaux usines, connaissent le sort des prolétaires en usines. « Bateau surchargé + paquet de mer + eau glacé = noyade. » Nul besoin d’inventer des monstres marins, à l’instar de l’évêque catholique Olaus Magnus (1490-1557), contraint à l’exil et auteur d’une Carta marina et d’un bestiaire quasi fantastique des animaux vivant dans l’océan, que Morten A. Strøksnes convie un moment. L’auteur restitue avec brio la vie des pêcheurs et, de fait, celle des animaux marins, montrant que toutes sont liées et que toutes sont menacées par les activités humaines et la pollution qui en émane. « Par nos activités, nous exterminons les espèces à un rythme étourdissant, car nous sommes parvenus à une hégémonie sur terre, et nous régnons aussi sur les océans. » Un beau documentaire animalier et… humain, en somme.
* Morten A. Strøksnes, Le Livre de la mer ou... (Havboka eller kunsten å fange en kjempehai...), trad. Alain Gnaedig, Gallimard, 2017
Les Enfants de Dieu

« Certains prétendent qu’un homme honnête et droit est un homme respectueux de la loi. Mais qui décide quelles lois sont justes ? Qui rédige les lois ? » On dit que, dans la région de Bethléem, un homme juste et bon soigne les malades. Il serait doté de pouvoirs immenses. Le père de Jacques emmène son fils atteint de bégaiement à sa rencontre. Jésus lui rend momentanément l’usage de la parole. Il ne serait donc pas un charlatan comme tous ceux qui pullulent par ici ? Puis d’autres personnages se lancent dans son sillage, avec l’intervention régulière d’un aveugle dans le rôle du vieux sage. Dans Les Enfants de Dieu, Lars Petter Sveen (né en 1981) signe un ouvrage très érudit et cependant très libre avec des faits qui demeurent incertains. Sa relecture de la Bible peut être iconoclaste, le ciel nocturne est ainsi traversé par des OVNI : « ...J’observais le ciel étoilé, je vis une lumière intermittente. D’abord rouge, puis verte. Elle se déplaçait. » Pas sûr qu’elle réconcilie croyants et non-croyants, puisque tout est traité comme de la fiction, comme une histoire ancrée dans un passé lointain, pas forcément véridique. Mais sans doute est-ce ainsi qu’il s’agit de traiter les événements qui sont à la base des religions monothéistes. Quand des pèlerins décident de bannir les armes, ils ne trouvent devant eux que des ennemis. « Nous nous sommes battus, nous continuons de nous battre pour notre peuple. Nous combattons pour Dieu. (…) Je peux les honorer, je peux poursuivre leur combat, comme nous le faisons chaque jour. » Que répondre à cela ? La guerre s’auto-alimente ; nationalisme, traditions, vengeance... : elle produit les arguments pour se poursuivre. L’assassinat de jeunes enfants, comme dans les premières pages de ce roman, n’est finalement qu’une anecdote parmi tant d’autres liant guerre et religion. L’action peut être transplantée aujourd’hui et le lecteur reconnaîtra les luttes entre Israël et la Palestine, les attentats des « fous de Dieu » djihadistes ou encore, peut-être, le 22 juillet 2011 à Oslo et à Utøya : « Loin, très loin d’ici, il y a un lac aux eaux noires. Et au milieu de ce lac, il y a une île. Chaque été, des enfants se rendaient sur cette île... » ; tout comme il constatera que les violences à l’encontre des femmes ne datent pas d’hier. Bien qu’il soit « impossible de faire ressortir un quelconque schéma » des récits bibliques, bonne lecture en compagnie de ces combattants prêts, autrefois comme aujourd’hui, à zigouiller leurs contemporains et à tout détruire au nom d’une entité archaïque...
* Lars Petter Sveen, Les Enfants de Dieu (2014), trad. Frédéric Fourreau, Actes sud, 2021

