G-H
Là-bas chante la forêt

Au XVIIIe siècle, en Norvège, des ours peuplaient encore les forêts. L’un s’en prend aux animaux domestiques et c’est par le combat d’un fermier contre lui que s’ouvre le roman de Trygve Gulbranssen (1894-1962) Là-bas chante la forêt : « Ce n’était assurément pas un ours ordinaire que ce rôdeur à la forte charpente, aux yeux verts et phosphorescents. Jamais on n’avait vu animal si majestueux, si sauvage et si terrible. » Initialement paru en France en 1938 et intitulé Là-bas... chante la forêt, ce titre est le premier d’une trilogie consacrée aux « maîtres de Bjørndal » ; Le Salut du gaard et Le Souffle de la montagne restituent la suite de l’épopée. On ne peut que se réjouir de voir réédité un tel ouvrage, alors que les nouveautés occupent beaucoup de place dans les librairies. La lecture de ce roman est agréable, les personnages sont bien campés, il y a peu de temps morts. Mais que de références à la « race » et à la « vengeance », hélas ! « Les Björndal naissaient avec le goût de la vengeance dans le sang ; Tore était bien de leur race. » Le personnage central, le vieux Dag impitoyable et sage, sévère mais juste peut-on dire, relève plus du conte pour enfant que du modèle social. Il est cependant capable de s’amender ; ainsi, à la fin du volume, lorsqu’il découvre qu’« ...il n’est pas facile d’être sincère quand on est pauvre » et qu’il aide les démunis. La misère « enlève aux hommes non seulement leur liberté d’action, mais leur liberté de penser ». La trilogie fut un best-seller en son temps (traduite dans une trentaine de langues et vendue à douze millions d’exemplaires), à l’image de la série familiale des Neshov de Anne B. Ragde aujourd’hui. Notons que l’éditeur de ce livre, les Amis de la culture européenne, se revendique des Wandervogel (« l’oiseau de passage », « l’oiseau migrateur »), mouvement national-romantique de la jeunesse allemande de la fin du XIXe siècle, organisation de scoutisme qui finira de plus ou moins bon gré par se fondre dans la Hitlerjugend. Durant la Deuxième Guerre mondiale, Trygve Gulbranssen ne se rangea pas du côté de l’occupant allemand, lui, au contraire de son concitoyen Knut Hamsun, et tenta de développer une ferme dans les environs d’Oslo. Malgré son succès, Trygve Gulbranssen, qui travailla dès son plus jeune âge, notamment comme garçon de course, ne cessa jamais ses activités : commerçant, premier importateur de tabac en Norvège au milieu du XXe siècle, journaliste sportif, fermier. Un auteur complètement oublié en France, bien injustement.
* Trygve Gulbranssen, Là-bas chante la forêt (Og bakom synger skogene, 1933), trad. Mercedes Sundt ; préface Marie Gevers, Les Amis de la culture européenne, 2020
Le Souffle de la montagne

Après Là-bas chante la forêt, voici Le Souffle de la montagne, sa suite non moins épique, de l’écrivain norvégien Trygve Gulbranssen. 1809. Adelheid Barre a vingt-sept ans, l’âge, dit-on, de se marier. Le postulant est un paysan, pas un « gros propriétaire », ce que ses proches acceptent mal. Un rustre, puisque homme de la terre ? Dag, son père, le « maître de Björndal », dont il porte aussi le prénom, « sortait d’une race qui avait su s’élever au-dessus du commun des hommes », ce qui lui donne sa légitimité. Adelheid voit l’union avec espoir. Un enfant, puis un autre naissent. Le vieux Dag continue d’exercer un pouvoir patriarcal et bienveillant. « Il était bien l’enfant des anciens temps austères, des hautes colonies forestières. Il avait durant bien des jours travaillé dans le vent et dans la tempête et acquis au cours de sa propre vie une longue expérience ; mais il en possédait une plus grande et plus ancienne, c’était celle qui lui avait été transmise par son père comme un vieux trésor de sagesse résultant du dur travail de nombre et nombre de générations. » Pour ses contemporains, « à n’en pas douter, Dag possédait un pouvoir magique ». 1815. La vie ancestrale est remise en cause, la valeur des biens ne se calcule plus comme autrefois, des fortunes se rejouent. La mort d’un enfant est un drame hélas fréquent. Mais Adelheid surmonte les épreuves. « Un jour de premier printemps où le vent soufflait... » La vie triomphe, la vie doit toujours triompher. Et pour cela, s’en remettre à Dieu s’impose, ce n’est ici pas plus compliqué ! « ...Nous avons des forces en nous, des pensées, une volonté et des sentiments, qui nous conduisent encore plus loin que la mort... jusque vers Dieu. » Avec une intrigue profondément inscrite dans son époque, le début d’un XIXe siècle fécond en bouleversements de toutes sortes jusque dans les contrées reculées des montagnes norvégiennes, Trygve Gulbranssen montre bien ces enjeux. Ce n’est pas une mauvaise idée que de rééditer ce roman, publié une première fois en France en 1946, de rendre ainsi de nouveau accessible l’œuvre de cet écrivain oublié.
* Trygve Gulbranssen, Le Souffle de la montagne (Det blåser fra Dauingfjell), traduction du norvégien Y. Bercher-Mangin & A. Moser, Les Amis de la culture européenne (Heimat), 2022
Au nord du Nord

Né à Minneapolis, l’Américain Peter Geye est l’auteur de plusieurs volumes. Dans Au nord du Nord, qui peut se lire après L’Homme de l’hiver puisque les personnages de ce dernier roman apparaissent de nouveau, il relate la quête de Greta Heide-Nansen en Norvège, en 2017-2018, sur les traces de son aïeul Odd Einar Eide. La figure de Fridtjof Nansen est incontournable, c’est lui, en 1897, qui a poussé Eide, pêcheur pauvre, à appareiller pour le pôle. Plus d’un siècle plus tard, Greta se rend à Hammerfest pour rompre une relation qui lui pèse avec Frans. « Jusqu’où irait-elle dans la déraison ? » Son mari séjourne en Norvège en ce moment, vraisemblablement avec sa jeune maîtresse. « Elle n’avait pas plus décidé de la tournure prise par leur relation qu’elle n’avait d’influence sur les changements de la météo. » En parallèle, le parcours de Odd Einar Eide est donc retracé, lui qui a survécu deux semaines seul sur le Spitzberg/Svalbard, qui a été attaqué par un ours et dont l’exploit, relaté par la presse d’alors, l’a hissé au rang de héros. « ...Un homme ne se retrouve pas là-haut, au nord du Nord, sans avoir regardé au préalable au plus profond de son âme ». Greta fait la connaissance de Stig, pianiste et harmoniste à Tromsø. Coup de foudre réciproque. Deux époques : les personnages et les événements qu’ils vivent s’imbriquent naturellement. « ...L’histoire de sa famille », se dit Greta, « s’est toujours déroulée dans la neige et la glace. Il y a eu des pêcheurs et des juges, des douairières et des orphelins, des constructeurs navals et des enseignants, des poètes du dimanche et des artistes doués. Ils étaient natifs de Norvège ou du Minnesota, immigrants ou citadins, voyageurs ou sédentaires. » Ce roman met en exergue les liens ancestraux entre la Norvège et les États-Unis – en l’occurrence le Minnesota (pour une approche assez semblable de l’histoire des deux pays, souvenons-nous de La Trilogie du Minnesota de Vidar Sundstøl, publiée en France en 2011-2013). Au nord du Nord est un roman attachant qui permet de se plonger dans une Norvège dont le poids du passé continue d’agir sur le présent.
* Peter Geye, Au nord du Nord (Northenmost, 2020), trad. de l’anglais (États-Unis) Isabelle Maillet, Rivages, 2022
Histoire d’un mariage

« Elle avait pris l’habitude de tout partager avec moi. Ou presque tout : les conflits et les négociations, les petits agacements, mais aussi ce qu’elle trouvait intéressant ou amusant, ou réconfortant. Elle avait trouvé sa place et s’y sentait bien, elle le savait. » Mais le temps défait les plus belles histoires d’amour ; insidieusement, les liens se distendent. Jon et « Jiminy » (l’affectueux surnom qu’il lui donne), en conviennent et décident de se séparer. Né en 1963, Geir Gulliksen a signé de nombreux ouvrages : des romans pour les adultes et pour la jeunesse, et du théâtre. Il est aussi l’éditeur de l’écrivain Karl Ove Knausgaard et, comme lui, n’hésite pas à tout mettre à plat. Quelque peu à la façon d’une télé-réalité (rien n’est tu, même et surtout ce qui relève de l’intime), son Histoire d’un mariage relate scrupuleusement le début d’une relation entre un homme et une femme, tous deux âgés d’une trentaine d’années, la naissance de leurs deux garçons, à cinq ans d’écart, puis... La rencontre, pour elle, d’un autre homme ; le recours à la masturbation, pour lui... Si le sujet ne brille pas par son originalité, la franchise du ton procure à ce livre une exemplarité quelque peu déconcertante.
* Geir Gulliksen, Histoire d’un mariage (Historie om et ekteskap, 2015), trad. Jean-Baptiste Coursaud, Buchet-Chastel, 2018
La Faim

Assurément pas une nouveauté, à proprement parler, mais une réédition intéressante que nous offrent là les éditions 11-13 : La Faim de Knut Hamsun. Publié initialement en 1890, ce roman a fait connaître l’écrivain norvégien non seulement dans son pays mais aussi en Europe, puis dans le monde entier. Il y a différentes lectures possibles de ce texte – ce qui en fait sa pertinence, hier comme aujourd’hui. Pas seulement celle, souvent retenue, d’un révolté errant dans le Christiana/Oslo de la fin du XIXe siècle, lucide sur le monde qui l’entoure et en proie à une faim tenace. « Si seulement on avait un peu à manger par une si belle journée ! » La Faim est le roman qui va donner le ton à l’œuvre de Hamsun. Voici l’écrivain avec son personnage d’éternel réprouvé, que le lecteur retrouvera dans plusieurs romans futurs (Hans, Auguste…), personnage haut en caractère et en butte à la société tout entière, si figée dans ses normes, implacable pour les sans-le-sou, ce « vagabond » qui se répète à l’envi que « la vie continue ». Il a le cœur généreux, lui, il a l’intelligence ouverte, il est prêt à toutes les aventures humaines mais on le blâme parce qu’il n’est pas vêtu de neuf malgré sa fière allure, pas qu’il ne s’acoquine pas d’office avec ses contemporains et qu’il se méfie des puissants, parce qu’une révolte instinctive l’anime. Knut Hamsun excelle dans cette description et il est vraiment dommage que l’écrivain ait perdu ensuite l’acuité de son regard pour se mettre à célébrer l’Allemagne hitlérienne. La Faim est un roman qu’Octave Mirbeau, André Gide et nombre d’autres écrivains ont salué ici. Il fait partie des grands textes de la littérature mondiale.
* Knut Hamsun, La Faim (Sult, 1890), trad. Georges Sautreau, intr. Hélène Carron-Desrosiers, 11-13, 2016
La Faim

« C’était au temps où j’errais, la faim au ventre, dans Christiana, cette ville singulière que nul ne quitte avant qu’elle lui ait imprimé sa marque... » C’est une version toute simple de La Faim, sans appareil critique, que nous présentent les éditions La République des lettres. Le célèbre roman de Knut Hamsun (1859-1952) est restitué dans la version française, quelque peu tronquée, de sa première traduction, celle de Georges Sautreau. Choix de l’éditeur. Le lecteur retrouvera tout de même l’un des chefs-d’œuvre de l’écrivain norvégien, prix Nobel de littérature en 1920. Le narrateur, un étudiant qui est quasiment le double de l’auteur, vagabonde dans les rues de Christiana (qui se renommera bientôt Oslo), à la recherche de sa pitance. Il voit le monde avec les yeux d’un affamé que le ressentiment anime. Sa vie va basculer, tout le suggère. L’un de ces grands romans de la littérature mondiale du XXe siècle.
* Knut Hamsun, La Faim (Sult, 1890), trad. Georges Sautreau, La République des lettres, 2023
Faim

Le plus célèbre roman de Knut Hamsun, celui qui l’a propulsé sur la scène littéraire norvégienne puis mondiale, Faim (Sult, 1890), se trouve, dans ce petit volume publié par l’Harmattan (2015), adapté pour le théâtre. D’abord pour le Théâtre de la Madeleine, en 2011, puis, quelque peu modifié, pour le Lucernaire. Signée Florent Azoulay et Xavier Gallais, l’adaptation place l’action non plus à Oslo, à la toute fin du XIXe siècle, mais à Stockholm, dans les années 1920 (avant de revenir à Kristiana-Oslo à la fin !). Jean-Louis Barrault, en son temps, s’était déjà exercé à, selon les mots d’André Gide (préface à La Faim), « porter ce vaste soliloque sur la scène ». « Aucune histoire, aucune intrigue : au cours du livre rien d’autre ne nous est offert que le lamentable spectacle d’un homme sans cesse sur le point de mourir de faim. » Sujet toujours d’actualité, on en conviendra, alors que, les riches toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres, les SDF sont de plus en plus nombreux dans les rues des villes européennes. « Maigre, bien entendu j’étais maigre. (…) Mes joues étaient comme deux écuelles, le fond à l’intérieur… Je devais être d’une maigreur tout à fait inconcevable. Et mes yeux étaient en train de rentrer dans ma tête. Au secours, quel visage, hein ? »
Sur les sentiers où l’herbe repousse
Sur les sentiers où l’herbe repousse est le dernier ouvrage écrit par Knut Hamsun, en 1945. Le Prix Nobel de littérature norvégien est à présent âgé, il est surtout accusé par la justice de son pays de faits de collaboration avec l’ennemi, l’Allemagne nazie. Hamsun ne tente pas ici de se justifier, il raconte, comme à son habitude. Difficile de reprendre le caractère par trop élogieux de la quatrième de couverture, qui parle de « son chef d’œuvre », tant le volume est décousu. L’écrivain baguenaude au gré de ses souvenirs, conte une anecdote, reprend sur son procès à venir, se plaint de son assignation à résidence dans une maison de retraite... Ne dit que ce qu’il veut dire. « J’ai essayé de comprendre ce qu’était le National-Socialisme, j’ai essayé de m’y initier, mais cela n’a rien donné. » Qu’il ne soit pas un nazi violent, on le sait, aucune page de son œuvre n’exhorte à l’antisémitisme ni au racisme. Hamsun a vu en Hitler un exalté capable de sortir l’Europe du matérialisme, il l’a suivi, il l’a applaudi, il a pensé que la Norvège, « pays indépendant et phosphorescent », trouverait une place de choix dans la Grande Europe qui s’annonçait. Cela s’est arrêté là. Trop, bien sûr. Ce dernier livre de Hamsun est peut-être aussi le dernier à lire de lui.
* Knut Hamsun, Sur les sentiers où l’herbe repousse (Paa gjengodde stier), trad. Régis Boyer (suivi d’une étude de R. Boyer, Pour l’amour du Viking), préface Manès Sperber, Calmann Lévy, 1981
Octosong

Réalisateur artistique musical, Jim Gystad assiste, dans l’église de Kongsvinger, au baptême de son neveu tout en souffrant d’une terrible gueule de bois. Quand il entend chanter des octogénaires, un frère et deux sœurs, un « trio capable de ressusciter les morts » qui eut son heure de gloire dans les années 1960, il est ravi, lui qui évoque à tout-va les musiciens rock mythiques. Il aimerait leur proposer un enregistrement mais le trio rechigne. Pour parvenir à ses fins, il loue une maison dans le village et reprend son métier d’électricien, tout en saisissant la moindre occasion pour les relancer, l’un après l’autre. La production musicale est si médiocre ces dernières années que ce trio, il en est convaincu, fera un tabac. Mais le frère et ses sœurs ne sont pas des croyants comme les autres, s’ils citent le nom de Jésus à tout bout de champ, c’est pour ne retenir que certains aspects de sa personnalité : « être religieux juste ce qu’il faut, (…) on sait faire ». Beaucoup, dans leur communauté religieuse, leur reprochent de sentir le souffre. Jim Gystad s’accroche, entre dans leur vie et parvient à ses fins. Roman original, plein d’allant, que ce troisième titre de Levi Henriksen (né en 1964) publié en français (après Du sang sur la neige, un roman noir et pas un « thriller » comme l’annonçait l’éditeur, et Les Curieuses rencontres du facteur Skogli). Levi Henriksen surprend agréablement avec une vraie intrigue, de vrais personnages, complexes et tous assez attachants, et un sujet plutôt inattendu. « Rien n’est plus beau que ce qui fut »…
* Levi Henriksen, Octosong (Harpesang, 2014), trad. Loup-Maëlle Besançon, Presses de la Cité, 2016
Mère est-elle morte
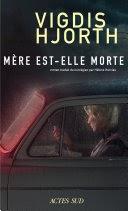
Roman déconcertant, Mère est-elle morte, comme tous ceux que publie la norvégienne Vigdis Hjorth. « Une mère ne peut jamais être une personne ordinaire pour ses enfants », observe Johanna, la narratrice, revenant en Norvège après plusieurs années aux États-Unis au grand dam de sa famille. Pourtant, « peut-être que mère, dès l’instant où je suis née, a eu le désir de ne pas être ma mère. Mais elle n’a pas pu se défiler, malgré tous ses efforts », songe « son enfant de bientôt soixante ans ». Artiste peintre à présent reconnue, exposant dans sa ville natale, Johanna Hauk craint de tomber sur sa mère ou sur sa sœur cadette, Ruth, qui lui est également hostile. La raison ? « Johanna était une juriste prometteuse mariée à un avocat de confiance (…), mais l’été 1990, elle a suivi un cours du soir de peinture à l’aquarelle, s’est amourachée de son professeur américain, Mark on-ne-sait-plus-quoi, et a disparu avec lui. » Scandale ! D’autant plus que Johanna a peint deux toiles, Enfant et mère 1 et 2, dans lesquelles sa mère a cru se reconnaître, et qu’elle n’est pas revenue pour l’enterrement de son père, qui était aussi avocat et, dans ce milieu, pas question de remettre sa carrière en cause pour une amourette. Mère est-elle morte est le quatrième ouvrage de Vigdis Hjorth traduit en français (après Une Maison en Norvège, Parle-moi, et Héritage et milieu). Une œuvre qui peut sembler intimiste et qui dépasse cependant largement ce cadre pour interroger l’époque, la nôtre, ancrée dans le passé ou partie en roue libre. Avouons que nous avons d’abord été moins séduit par ce dernier titre, agacé peut-être par le jeu trouble de Johanna, « petite fille spéciale » : je veux revoir ma mère, qui ne veut pas, et je ne sais pas si je veux vraiment... Jusqu’à épier sa mère et sa sœur afin de leur forcer la main ! « Je m’attendais à quoi ? » C’est un peu lassant, surtout que la « mère » en question, femme soumise autrefois avec son mari (« Elle a dû en défroisser du linge, pendant toutes ces années. ») et qui cultive à présent allègrement la rancune avec sa fille aînée, ne se distingue en rien de ses contemporains, sinon par son refus de regarder le monde autour d’elle. « J’ai du mal à croire que mère ne soit pas désespérée de ne pas avoir de contact avec moi... » insiste la narratrice. L’indéfectibilité des liens familiaux ? Rions. Mais quand l’intrigue s’inverse, le roman, bien logiquement, acquiert un tout autre sens et l’on comprend mieux pourquoi il a été sélectionné pour de grands prix littéraires. « Bientôt j’irai chez ma vraie mère, la forêt où j’ai fait mon nid. »
* Vigdis Hjorth, Mère est-elle morte (Er mor død, 2020), trad. du norvégien Hélène Hervieu, Actes sud, 2025
Héritage et milieu

« Je lavais le linge et la maison, avançais dans la rédaction de mon mémoire sur le théâtre contemporain allemand ainsi que de critiques théâtrales pour des journaux de moindre importance, continuais à travailler sur une pièce en un acte, tentais de mener une vie normale et de paraître normale, refoulant cette sensation vertigineuse de chute. » Quatre enfants : Åsa, Astrid, Bård et Bergljot, la narratrice. Qui reçoivent un héritage. Les deux cadets (Åsa et Astrid) sont avantagés par rapports aux deux autres, puisqu’ils bénéficient de deux chalets, en Norvège, alors que Bård et Bergljot touchent une somme d’argent qui ne correspond pas à leur prix. Les rapports entre eux se transforment. S’enveniment. L’histoire familiale remonte à la surface. Convient-il de mentir pour préserver la paix entre les membres d’une même famille ? Même quand une histoire d’inceste atteint l’honneur paternel ? Bergljot ne peut compter que sur son frère, Bård, et sur quelques amis, dont Klara. De Vigdis Hjorth, on connaissait déjà Parle-moi et Une Maison en Norvège, deux très bons romans ou récits avec des questions d’actualité en toile de fond. Nous n’affirmerons pas avoir été aussi emballé par celui-ci. La narratrice revient en long et en large sur le mauvais coup qu’elle estime fait à son encontre, cet héritage dont on la prive en partie alors qu’elle est en froid avec sa famille depuis vingt-trois ans, et évoque l’acte d’inceste de son père, sans révéler vraiment en quoi celui-ci a consisté. « J’étais devenue une guerrière. Ils allaient voir de quelle étoffe leur fille était faite, ils allaient avoir un avant-goût de ma puissance, je n’ai pas peur de toi, père, je n’ai pas peur de toi, mère, je suis prête au combat ! » Au fil des pages, le lecteur a envie de lui conseiller de laisser tomber. Si sa famille ne comprend pas ou refuse la réalité de l’agression paternelle, pourquoi ne pas rompre plutôt que de réclamer sa part d’héritage (la narratrice n’est pas dans le besoin) ? Au nom des enfants, comme toujours ? (pourquoi les bonnes et plus souvent les mauvaises décisions sont-elles toujours prises au nom des enfants ?) L’abolition de l’héritage (sauf pour les biens de la vie courante, jusqu’à la maison familiale) serait une première et belle mesure à instaurer, peut-on se dire, histoire entre autre de dénouer ces situations inextricables.
* Vigdis Hjorth, Héritage et milieu (Arv og miljø, 2016), trad. Hélène Hervieu, Actes sud (Lettres scandinaves), 2021
Une Maison en Norvège

Difficile de faire plus sobre, graphiquement parlant, que la couverture de ce roman, Une Maison en Norvège, de Vigdis Hjorth, que publient aujourd’hui en français les Belles lettres : le nom de l’auteure, le titre du roman et un mince trait noir (plus, il est vrai, un bandeau rouge avec une photographie de Vigdis Hjorth). En quatrième, une simple phrase : « Comment doivent être les relations entre les gens, quelles règles suivre ? » Un roman dense, avec une intrigue inattendue. On ne sait d’abord pas grand chose d’Alma, trente-deux ans, qui vient de divorcer et qui a la garde une semaine sur deux de ses enfants. Elle trouve à acheter une maison à peu de distance de celle de son ex-mari et loue une partie de celle-ci à diverses personnes peu fortunées. Elle n’est pas une propriétaire bien exigeante : que son loyer lui arrive à peu près tous les mois lui suffit, pas besoin d’un dépôt de garantie si le locataire n’en a pas les moyens. Autrefois, Alma se sentait très à gauche, question politique. À présent, elle s’interroge sur le sens que prend sa nouvelle vie. « Être un citoyen responsable revenait à payer ses impôts et respecter le Code de la route. Elle connaissait et voulait faire ce qui était bien, tant que cela ne lui coûtait pas trop d’effort, mais elle ne brûlait plus pour aucune cause. » Finalement, sa maison lui ressemble – ou elle ressemble à sa maison ; Alma s’identifie à cette maison toute simple, qu’elle abandonne certains jours à ses enfants, qui ont grandi, et petits-enfants, lesquels ne montrent aucune considération pour les lieux, lui laissant un ménage complet à faire après leurs visites. L’appartement qu’elle loue maintenant à une jeune femme, une Polonaise mère d’une petite fille et victime, semble-t-il, d’un compagnon violent, lui cause des soucis. La femme n’est pas une locataire exemplaire et profite d’Alma, qui du coup peine à exécuter les commandes de broderie qu’elle reçoit de diverses institutions. Car elle est une artiste. Une Maison en Norvège compte deux chapitres : le premier de deux cents pages et le second de trois. Alma relate en parallèle son enthousiasme pour les œuvres qu’elle créée et ses déboires avec sa locataire, qui minent son inspiration. Ses préoccupations, ses questionnements pourraient être ceux de ses lecteurs. La fin est presque un retournement et, tout en parlant de choses peut-être banales, Vigdis Hjorth (née en 1959, auteure d’une trentaine d’ouvrages souvent primés et traduits dans les Pays nordiques, en Russie et en Ukraine, mais seulement pour la première fois en France) parvient à surprendre. « La vie est décidément imprévisible et la plus grande des énigmes tout près de nous, juste de l’autre côté du mur. » Une Maison en Norvège est un roman infiniment plus intéressant que les écrits nombrilistes de (pour citer deux Norvégiens) Geir Gulliksen ou Karl Ove Knausgaard.
* Vigdis Hjorth, Une Maison en Norvège (Et norsk hus, 2014), trad. Hélène Hervieu, Les Belles lettres, 2018
Parle-moi

Vigdis Hjorth avait déjà publié Une Maison en Norvège chez le même éditeur (Les Belles lettres), grâce à la même traductrice (Hélène Hervieu). Un roman plutôt déstabilisant. Elle recommence avec Parle-moi. De nouveau, une femme est au centre de l’intrigue, apparemment fort simple : elle effectue un voyage à Cuba pour rompre avec la monotonie de sa vie quotidienne. « J’ai compris que je devais faire quelque chose. Mais quoi ? » Âgée d’une bonne quarantaine d’années, bibliothécaire dans une petite ville de Norvège, Ingeborg a le sentiment d’être passée à côté de beaucoup de choses (« Qu’avais-je fait de ma vie ? »). Elle n’est pas exempte de préjugés et ce voyage est pour elle moins reposant qu’elle ne l’avait espéré. Elle s’éprend d’un musicien, un peu plus jeune qu’elle, Enrique. Un Noir. Tout semble toujours aller de soi avec certains auteurs, même les rencontres les plus improbables. Ce n’est pas le cas dans Une Maison en Norvège ni dans Parle-moi. Nous pourrions dire que la narratrice est quelquefois loin d’être politiquement correcte, non parce qu’elle n’aime pas les Noirs, par exemple, dans Parle-moi, mais parce qu’elle n’a pas l’habitude de se confronter à des individus différents d’elle. C’est intéressant. Car son questionnement, ses hésitations, peuvent à certains moments être les nôtres – souhaiter partager, c’est aller vers les autres et donc passer par des doutes, des désirs, des craintes. Quand elle fait le bilan de sa vie, elle est à deux doigts de la dépression. Son fils à présent adulte est parti faire ses études à Stockholm et elle ne l’a pas vu depuis bientôt trois ans, elle ne comprend pas pourquoi, ne reçoit pas d’explication quad elle tente de l’interroger. Son père et sa père, tous deux morts à présent, se sont haïs leur vue durant, elle n’en a rien su jusqu’à découvrir fortuitement un journal intime. Elle n’a pas de véritable ami(e), plus de famille. Enrique pourrait être pour elle l’occasion d’un nouveau départ. Mais il est bien difficile pour un Cubain de quitter son pays, les frontières sont étanches, et non moins difficile d’être accueilli en Norvège. Et quand cela est enfin possible, les rôles se renversent : Enrique, l’homme viril à Cuba, perd de sa faconde sous le froid de la Norvège ; la timide Ingeborg prend le dessus. Il n’a pas d’argent, évidemment, elle paie tout, la relation dérape, elle lui parle, parle à son fils, un seul et même interlocuteur ? Mille questions se posent à elle, la narratrice ; à lui, à eux aussi peut-être. Au lecteur. Ingeborg, son fils et Enrique : les trois personnages se répondent sans se parler. « Comment c’était pour toi ? J’aimerais tant l’entendre de ta bouche, je supporterai tout, s’il te plaît, parle-moi ! » Un roman fin et intelligent, qui offre de nouvelles approches des thématiques habituelles de la fiction, qui en propose même d’inédites.
* Vigdis Hjorth, Parle-moi (Snakk til meg, 2010), trad. Hélène Hervieu, Les Belles lettres, 2020
La Honte

Quand honte et culpabilité se renvoient la balle... ! Les luthériens n’excellent-ils pas dans ce domaine ? Bergljot Hobæk Haff (née en 1925) a signé plusieurs gros romans, qui tous s’ancrent dans des périodes douloureuses de l’Histoire et mettent en scène des personnages d’exclus, autrement dit « les maudits et les égarés » (La Honte). Dans ce roman, La Honte, elle donne la parole à une femme, Idun Hov, écrivaine méconnue et internée dans un hôpital psychiatrique depuis des années. Elle ne sortira plus jamais, disent les médecins, qui lui accordent une ramette de papier – puisqu’elle souhaite écrire. Et Idun Hov de raconter l’histoire de sa famille et, au-delà, un siècle, le XXe, en Norvège. Siècle fécond et dramatique, qui voit la Norvège prendre son indépendance (1905) et être envahie par les troupes nazies (1940-1945) et passer du rang de pays rural et plutôt pauvre à celui de puissance pétrolière urbaine et riche. Au travers de multiples personnages, La Honte retrace certains de ces événements. On suit bien sûr et avant tout la narratrice, sa folie, son internement : « Vous ne vous contentez pas (…) de transformer la vie en littérature. En fait, vous vous êtes engagée sur une voie beaucoup plus dangereuse puisqu’à présent vous transformez la littérature en vie », lui dit ainsi une infirmière. On suit aussi la branche paternelle de la narratrice, qui s’acoquine avec Vidkun Quisling – leader national-socialiste devenu aujourd’hui un nom commun, signifiant le traitre par excellence. Autodidacte, son père est en effet pris sous les auspices de la famille Quisling, laquelle, assez généreusement, lui permet de devenir pasteur avant, durant la Deuxième Guerre mondiale, d’exiger un engagement plus conséquent. Ce qu’accepte malgré lui le pasteur, toujours passif même lorsque les choses au fond de lui-même lui déplaisent. « Vous ne comprenez donc pas que, pour lui, c’est quasiment blanc bonnet et bonnet blanc ? Que là, dans le box des accusés, il y a un homme qui n’arrive pas à se décider. Un couillon super-intelligent qui voit toujours les choses des deux côtés. » Une narration qui se perd parfois, peut-être, dans des digressions sans trop d’intérêt (ces fugues à répétition, à l’étranger : bof !), mais un roman dense et passionnant, cependant, entre les années 1930-1940 et les années 1990, qui nous livre le portrait d’individus très différents les uns des autres – songeons, outre la narratrice, aux deux viles tantes marchandes de chapeaux, à ces sympathiques anarchistes constituant l’Association ouvrière ou à Aron, enfant juif rescapé qui deviendra médecin à Jérusalem et sauvera, finalement, la narratrice.
De Bergljot Hobæk Haff, on trouve en français quatre romans. La Honte, donc, plus L’Œil de la sorcière (1998), Le Prix de la pureté (2004) et La Juive d’Amsterdam (2005), tous chez Gaïa.
* Bergljot Hobæk Haff, La Honte, (Skammen, 1996), trad. Éric Eydoux, Gaïa, 2001
La Vie est un cirque

Ah, les joies de l’héritage !... À quand, donc, l’abolition de cette injustice profonde (sauf, entendu, pour les biens familiaux comme une maison ou un véhicule) ? Lise Gundersen travaille pour un fond d’investissement à Oslo. Elle annonce à des salariés qu’ils sont licenciés, afin que des actionnaires puissent continuer leurs profits, autrement dit elle passe son temps « à détruire la vie des gens », comme le résume sa demi-sœur Vanja. À la mort de son oncle Hilmar Gudersen, dit Hilmar Fandango, dont elle ne connaissait pas même l’existence, elle hérite du cirque dont il était le directeur. Elle pense d’abord le revendre, s’enrichir et devenir ainsi la numéro deux de sa société. Surnommé dans sa jeunesse « l’hirondelle norvégienne » pour ses exercices de voltige, Hilmar Fanrando a cependant assorti son testament de quelques conditions. Lise va les découvrir, à sa consternation : elle devra « enfiler un costume à paillettes » et assurer cinq représentations du cirque en tant que directrice. Mais, comme elle l’affirme, « ce n’est pas parce que je ne pleure pas devant des vidéos YouTube à l’eau de rose que je suis socialement attardée ». Un défi à relever ? Puisque « froide et déterminée », elle y va. N’a-t-elle pas l’habitude d’imposer sa volonté ? Dans d’autres contextes, certes, et les gens du cirque, comme elle s’en aperçoit vite, ont leur caractère. La Vie est un cirque est présenté en quatrième de couverture comme « un roman joyeux, tendre et attachant pour voir la vie en couleur ». Son auteur, Magne Hovden (né en 1974) vit à Kirkenes et a déjà publié un roman non traduit en français, Sami Land. La Vie est un cirque pose des questions au-delà de l’intrigue elle-même : au nom de quelle aberration législative une personne obtient-elle un droit de regard sur la vie de contemporains dont elle ignorait tout peu auparavant ? Un roman qui se termine bien, trop bien, mais... pourquoi pas ?
* Magne Hovden, La Vie est un cirque (Cirkus, 2019), trad. Marianne Ségol-Samoy, Seuil, 2021
Histoire de Frœude

À l’adresse improbable du 13, Forêt primaire, vivent Frœude, sa jeune sœur Eva qui prend tout au pied de la lettre et leur frère aîné Serge Œudippe. Leurs parents partis pour vaquer, disons, à leurs occupations, il leur faut subvenir à leurs besoins sous l’égide de l’aîné. Ce qui n’est pas pour les effrayer. « ...Serge Œudippe s’échinait à aider son frère et sa sœur du mieux qu’il pouvait afin qu’ils deviennent des êtres pensants » et pour cela il leur lit quantité de livres sur des sujets incroyablement variés. Les prénoms ne sont pas innocents, évidemment, et tous portent haut-la-main leur réputation. August Augustus Vulgaris, le père, est un « capitaine au long cours » flanqué de quelques acolytes à son image. « La théorie, et leur conviction selon laquelle les mômes se débrouillaient nettement mieux tout seuls, sans adultes à les enquiquiner avec leurs fais-pas-ci fais-pas-ça, s’harmonisait en outre à la perfection (…) à la liberté de pouvoir à n’importe quel moment aller et venir comme bon leur semblait. » Augustus rentre à la maison lorsqu’il tombe follement amoureux de Demona des Javus, « la femme-de-ma-vie-entière » censée ne pas avoir d’humour mais présentant pourtant bien des similitudes avec une certaine Fifi Brindacier. Voici, par exemple, les premières lignes de son journal intime de petite fille : « Bonjour, têtes de nœud et têtes de lard, sangsues et sans-le-sou, loups en peau de mouton et moutons de Panurge concons. Bonjour, ganaches et gougnafiers, pignoufs et paltoquets. » Et ainsi de suite ! Cette Histoire de Frœude, aussi loufoque que brillamment écrite, est une sorte de fable incitant à réfléchir sur les êtres déjantés que notre monde fabrique, sur leur façon de voir leurs contemporains. Par exemple. Car sans doute peut-on en faire différentes lectures. Avec de telles références, ce ne serait que logique, n’est-ce pas ?
* Mona Høvring, Histoire de Frœude (Soga om Fråid. Hans meiningar og livskjensle, som også inneheld somme salige stunder, 2021), trad. du néo-norvégien Jean-Baptiste Coursaud, Noir sur blanc (Notabilia), 2021
Nous sommes restées à fixer l’horizon

Nous sommes restées à fixer l’horizon est un roman. Un assez court roman. Un assez long poème, pourrait-on dire aussi. Un beau texte. L’histoire d’une jeune femme, Olivia, ouvrière dans une fonderie quelque part en Norvège, qui hérite sans s’y attendre d’une maison, en Islande. Qui est toujours à la limite de la dispute avec sa mère, excentrique. Qui se sépare de son compagnon. Qui fait la connaissance de Bé, dont elle tombe amoureuse. Elle découvre ses sentiments pour cette femme. Le récit montre : surprise, abandon, espoir, colère… Le récit suggère, surtout. « J’ai entendu Bé appeler mon prénom. Elle semblait si insouciante sur le trottoir. Malgré la lumière forte, sa peau avait une carnation chaude. Elle avait l’air de mâcher quelque chose, quelque chose dont elle savourait le goût. J’ai soudain été démangée par l’envie de me battre avec elle. » Deuxième roman de Mona Høvring (née en 1962), premier traduit en français, Nous sommes restées à fixer l’horizon a la force d’un souvenir d’été, d’un souvenir de jeunesse, comme un point sur l’horizon, une silhouette qui vous salue à jamais.
* Mona Høvring, Nous sommes restées à fixer l’horizon (Venterommet i Atlanteren, 2012), Jean-Baptiste Coursaud, Noir sur blanc (Notabilia), 2016
Parce que Vénus a frôlé un cyclamen le jour de ma naissance

Ella et Martha sont nées le même jour, le 8 octobre, mais à une année d’intervalle. Martha, l’aînée, que l’on dit douée, tyrannise doucement sa sœur. Laquelle grommelle mais se prête au jeu. « Je m’appelle Ella et j’ai les yeux quasi verts. Je note dans un agenda tout ce qui d’après moi va se produire et, le dernier jour de l’année, je note ce qui s’est effectivement produit. » Quand toutes deux partent séjourner à l’hôtel dans un « village alpin », des incidents modifient la perspective. La relation se renverse, la dépendance d’une sœur envers l’autre ne va tout à coup plus aller de soi. « Enfant, j’appartenais à Martha et à maman et à papa. Dans cet ordre. » Parce que Vénus a frôlé un cyclamen le jour de ma naissance est une tranche de vie, un passage obligé pour les deux sœurs, vers une relation peut-être moins délétère.
* Mona Høvring, Parce que Vénus a frôlé un cyclamen le jour de ma naissance (Fordi Venus passerte en alpefiol den dagen jeg blei født, 2018), trad. Jean-Baptiste Coursaud, Noir sur blanc (Notabilia), 2021
