A-B
Quelques instants pour l’éternité
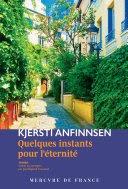
« Il m’arrive d’être extrêmement troublée. Sans pour autant que je sache si c’est l’époque ou si c’est l’âge. » Signé Kjersti Anfinnsen (née en 1975 à Oslo et exerçant par ailleurs la profession de dentiste), ce livre constitué de deux textes, Les Ultimes caresses et Quelques instants pour l’éternité, donne la parole à Birgitte Solheim, hier chirurgienne de renom qui vivait à Oslo et à New York et à présent cloîtrée dans son appartement de la rue des Termopyles dans le XIVe arrondissement de Paris. L’ex-Dr Solheim, célibataire sans enfant âgée de soixante-dix, quatre-vingts ans ou peut-être plus, tant les années à un moment ne se comptent plus, dévide le fil de sa vie sans beaucoup d’égards pour ceux qui y ont joué un rôle. C’est souvent méchant et non moins souvent drôle. Qui a déjà lu l’écrivain faux misanthrope Pierre Drachline trouvera ici des accents similaires. La petite vieille qu’est la narratrice ne trouve grâce qu’à quelques rares individus, dont sa sœur longtemps abhorrée Elisabeth, qui finit par mourir, et son coiffeur, Michel, véritable compagnon de folie douce. Ou à Javiér, l’homme qu’elle rencontre sur le tard, qui devient son compagnon, avant d’être emporté lui aussi par un cancer. « Il n’y a plus aucun souvenir heureux qui ne soit pas malmené par une expérience abominable que j’ai dû vivre. Il n’y a pas non plus d’instants accomplis qui ne soient immédiatement suivis par l’idée qu’ils vont disparaître. Comme le goût de la rhubarbe, l’été, les chansons dans la tête. C’est l’un des nombreux problèmes que l’on rencontre quand on est une vieillarde cacochyme. » Un livre surprenant, pas un roman, plutôt un récit, qui donne à voir la vieillesse dans sa misère, son impuissance et sa colère quotidienne. La narratrice n’est pas une gentille petite grand-mère mais elle parvient à faire preuve d’humour et c’est tant mieux. (Dommage que les indications des pages de « remerciements et citations » à la fin de l’ouvrage ne correspondent pas à la version française... !)
* Kjersti Anfinnsen, Quelques instants pour l’éternité (De siste kjærtegn, 2019 ; Øyeblikk for evigheten, 2021), trad. du norvégien Jean-Baptiste Coursaud, Mercure de France, 2024
L’Enfant

De Kjersti Annesdatter Skomsvold (née à Oslo en 1979), on trouvait La Vie au ralenti, roman publié en France en 2014. Dans L’Enfant, le lecteur suit les affres de la narratrice, déjà mère et épouse, par ailleurs écrivaine, au cours de sa maternité. « ...Quand on se réveille sans s’être endormi, même le chant des oiseaux n’est source d’aucune joie », relève-t-elle, souffrant d’insomnies chroniques. Sa vie est pénible, elle ne se résout pas à dormir durant la journée. Elle s’interroge sur sa relation avec Bo, l’homme de sa vie, le père de ses enfants. « ...Avec Bo, j’ai compris que je n’avais pas besoin de prétendre être plus que celle que je suis en réalité, avec lui comme dans l’écriture, je n’ai qu’à être celle que je suis. » Ce récit, L’Enfant, est en fait une longue lettre à sa fille sur ce qu’elle éprouve, ce désarroi au quotidien qui la mine. Entre retenue et épanchement. Un portrait dans le miroir, en quelque sorte.
* Kjersti Annesdatter Skomsvold, L’Enfant (Barnet, 2018), trad. Jean-Baptiste Coursaud, Cambourakis, 2021
Lame de feu, Chants de l’Arctique – 1

Dans ce premier volume d’une trilogie annoncée, Lame de feu, Chant de l’Arctique 1, Ingeborg Arvola (née en 1974) entend restituer, par la voix de la narratrice, Brita Caisa Seipajærvi, le parcours d’Eva Niva, une guérisseuse lapone – ou same – qui fut son arrière-arrière-grand-mère. La langue a été difficile à rendre, prévient dans sa préface la traductrice, Hélène Hervieu. Le lecteur ne s’en aperçoit pas forcément, emporté par le récit qui démarre en 1859 et se poursuit durant quelques années. « Nous sommes des Finlandais des forêts, robustes, prenant la vie comme elle vient », prévient d’emblée Brita : « …des Finlandais du Nord vêtus de peaux, nés du pain de l’écorce des arbres, des Kvènes, c’est le nom qu’on nous donne, un peuple qui a toujours vécu dans le Nord. » Brita, « une femme de mauvaise vie » selon le pasteur, doit partir avec ses deux jeunes fils de deux pères différents, Aleksis et Heikki, en direction du territoire des Sámi et de Vadsø, port de pêche dont les eaux, grâce au Gulf Stream, demeurent libres de glace pendant l’hiver. Le chemin est long mais l’entraide entre Sámi ne fait pas défaut. Ses dons de guérisseuse et ses talents d’accoucheuse sont appréciés (un peu plus tôt, n’aurait-elle pas été qualifiée de « sorcière » ?). Sur la presqu’île de Varanger, elle s’éprend d’un « bel homme », Mikko, qui est déjà marié. « Nous ne faisons qu’un, la terre et moi. Et le ciel. Et le fleuve. » Et cela, dans le respect du « petit peuple souterrain ». Que doit-elle faire ? Obéir à ses sentiments ? Même son aîné le lui reproche : « Qu’est-ce que je suis censé faire pendant que ma mère fait la putain sur le rivage ? » À son âge, avec deux enfants, Brita doit être mariée – ou bien se réfugier dans l’abstinence. Mais elle décide de vivre avec lui dans la région de Neiden, à peu de distance de la frontière russe. C’est un très beau portrait féminin que Ingeborg Arvola livre là. Celui d’une femme qui se veut libre, croyante comme tous ses contemporains et cependant remarquablement iconoclaste. Sa sensibilité accentue la majesté des lieux, la nature est magnifiée grâce à son regard. Lame de feu est un superbe roman prenant une région méconnue pour cadre, cette pointe nord du continent européen, là où Norvège et Russie ont toujours eu des comptes à régler. Ce premier tome des Chants de l’Arctique donne forcément envie de connaître la suite.
* Ingeborg Arvola, Lame de feu, Chants de l’Arctique – 1 (Kniven i ilden, 2022), trad. du norvégien Hélène Hervieu (préface Hélène Hervieu), Paulsen (La grande ourse), 2023
Contes de Norvège
Les Contes de Norvège de Peter Christen Asbjørnsen et de Jorgen Moe figurent parmi les classiques. Traduits par Vincent Dulac, ils sont aujourd’hui réédités dans une version simple, de poche, sans illustrations, si ce n’est la couverture (un troll à trois têtes, un chevalier et une princesse), signée du traducteur, Comme beaucoup d’autres contes, ceux-ci s’adressent autant à des adultes qu’à des enfants, car ils ne ménagent pas les sensibilités. Trolls et « trollesses » y règnent en maîtres et en maîtresses et rois et princesses n’ont souvent pas d’autre choix que de se soumettre à leur volonté. Mais le consentement ne se fait qu’au prix de maints rebondissements. « ...À peine revenus à la vie, ils se jetèrent sur le monstre et le tuèrent. Après quoi, ils prirent la fiole, répandirent son contenu sur toutes les pierres qu’ils purent trouver tout autour d’eux et chacune redevint un homme, une femme ou un animal. » On apprend ici comment se marier et ne mourir que... quatre cents ans plus tard. Question chamailleries et turpitudes, les hommes et les femmes, ces contes nous en convainquent, valent bien les trolls ! S’il y a ici une morale à retenir, c’est celle-ci.
* Asbjørnsen Peter Christen & Moe Jorgen, Contes de Norvège (trad. Vincent Dulac), Cupidus Legendi, 2020
Cairns
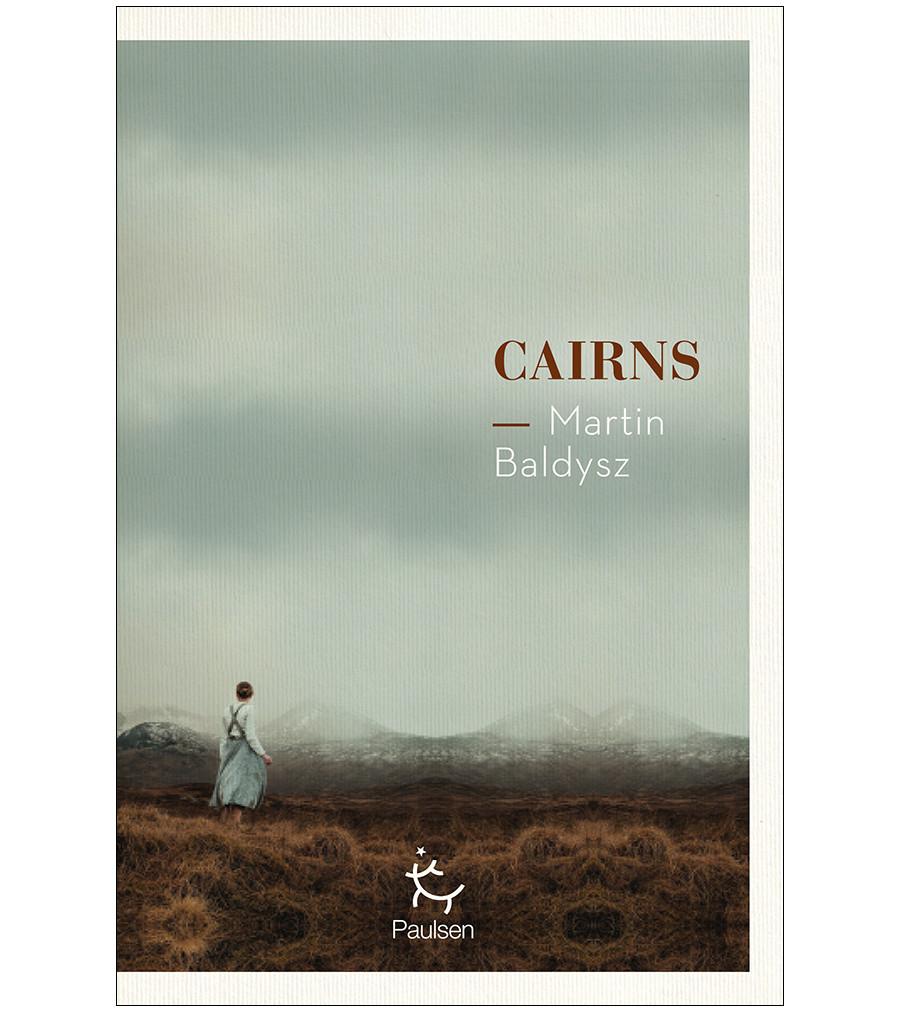
Martin Baldyst est né en 1977 dans le district de Sunnmøre, les Alpes scandinaves, dans le sud de la Norvège, où se déroule vraisemblablement son court récit. Un chasseur est assassiné dans son chalet d’alpage, « trente coups de couteau dans le dos, ce n’était pas rien ». Kirsten Nesse, jeune bergère apparemment coupable du crime, a disparu. Un an plus tard, nouveau venu dans la région, le pasteur Sebastian Ribe demande humblement l’aide de Reidar Skåren, dit le Marginal, ou encore le Montagnard, un homme alcoolique, pour partir à sa recherche. Ce dernier accepte. Conçu un peu comme un roman policier, avec une traque, Cairns transporte le lecteur dans une zone où la nature exerce encore sa loi. Les amas de pierres sont nombreux et rythment le paysage, permettant aux protagonistes de ne pas s’égarer. « Des gens étaient passés par ici et avaient cherché des pierres à empiler pour en faire un cairn. Un cairn qui procurerait un sentiment de sécurité à ceux qui s’aventureraient dans ces confins. » Mais les cairns, disposés de façon très aléatoire, jusque dans le lit des rivières, ne seraient-ils pas des êtres vivants ? La narration est empreinte de poésie. Kirsten Nesse est censée devoir répondre de son acte, mais pas une fois on en apprend la raison. Qu’est-ce qui fait qu’une femme larde ainsi un homme de coups de couteaux ? Au lecteur d’imaginer. Quand elle apparaît enfin, ses deux poursuivants ne renoncent pas à leur but, la rattraper : « Toi, tu peux me suivre au village pour répondre de tes actes ». Tant pis pour eux.
* Martin Baldysz, Cairns (Vardane, 2022), trad. du norvégien Marina Heide, Paulsen (La Grande ourse), 2025
Que va-t-on faire de Knut Hamsun ?

Nils, jeune homme peut-être simple d’esprit résidant dans le même hôpital psychiatrique que Knut Hamsun (1859-1952), au lendemain de la Libération, qualifie celui-ci de « traître à sa nation ». L’idiot contre le maître ? Dans l’attente de son procès, l’écrivain revoit sa vie. « Devenir vieux, c’est avoir le temps de comprendre combien on se trompe, combien aussi on a parfois raison. » Signé Christine Barthe (Française, née en 1964, psychothérapeute), ce roman, Que va-t-on faire de Knut Hamsun ?, relate une période cruciale de la vie du Prix Nobel de littérature 1920. Coupable d’intelligence avec l’ennemi, laudateur jusqu’au dernier jour de Hitler et du nazisme, quelle est la responsabilité réelle de l’auteur de Faim, de Pan, de Victoria ? Le vieillard qui va être jugé mériterait-il plus d’indulgence ? Son Prix Nobel l’exempterait-il de toute responsabilité ? Son âge ? Bien mené, ce roman donne à voir un Hamsun pitoyable, en butte aux autorités d’après-guerre, qui ne regrette rien de son soutien répété à Quisling et à ses sbires car sa seule faute, argue-t-il, est de s’être exprimé publiquement. Un intellectuel face à la lourdeur d’une administration judiciaire bornée et incapable de comprendre le noble écrivain. L’image est bien caricaturale et dédouane Hamsun de toute responsabilité. Le fait qu’un écrivain de la trempe de ce Prix Nobel ait plus de responsabilité qu’un simple citoyen ne semble pas troubler Christine Barthe. Que va-t-on faire de Knut Hamsun ? interroge-t-elle, à l’instar des autorités norvégiennes. Le cas est embarrassant, évidemment, Hamsun n’a pas de sang sur les mains, pas directement, mais la terrible répression qui a d’abord frappé l’Allemagne avant de s’étendre aux pays conquis, dont la Norvège qui a payé un très lourd tribut, pouvait-il ne pas la percevoir ? Observons qu’à la même époque, Edvard Munch, autre sommité artistique s’il en était, refusera tout compromis avec les occupants, exposant à Oslo et à... New York. Hamsun pouvait-il, jusqu’au bout, adresser au sinistre dictateur ses compliments, sans qu’un jour on lui demande des comptes ? Les honneurs, d’accord, mais pas les gros yeux ? « Hamsun aimait les changements d’humeur de sa Norvège », consigne l’auteure, à propos du climat – puisqu’il en allait tout autrement de la politique. Énonçant quelques banalités, la dernière partie du livre, assez abracadabrante (une ancienne de ses maîtresses, juive et mère de deux enfants dont il est le père, dont le Nils du début, est aujourd’hui infirmière à Grimstad, il ne l’a pas reconnue...), nuance son obstination : « Toi, tu as du talent. Tu as écrit merveilleusement, tu as écrit beaucoup. Pas Hitler. Hitler n’avait pas de talent. Sinon il n’aurait pas eu besoin de tuer la moitié de l’humanité pour survivre. » On se demande aujourd’hui, en France, s’il convient de rééditer les pamphlets de Céline. Un intellectuel a-t-il le droit de soutenir les bourreaux, de se pavaner en leur compagnie et de réclamer la clémence, voire l’impunité, lorsque le vent tourne ? Le beurre et l’argent du beurre, résume une expression parfaitement adéquate. Un peu facile, pour qui se pose en « conscience » – pas en victime ! En « surhomme », mais surtout pas en « sous-homme ».
* Christine Barthe, Que va-t-on faire de Knut Hamsun ?, Robert Laffont (Rentrée littéraire), 2018
La Nébuleuse de la Tête de Cheval

Roman initiatique que celui-ci, La Nébuleuse de la Tête de Cheval, du Norvégien Ola Bauer ? Assurément, car on voit dans ce livre le jeune Tom, dix ou onze ans, prendre place dans la vie auprès de Lister, sa mère, artiste peintre à Oslo, et de ses compagnons de fortune, Robert-Bobbie, célèbre pour avoir, sous l’occupation allemande, abattu six avions nazis, ou Le Moine, sorte d’ours humain donné pour écrivain : « Il avait passé sa vie à être en route, vêtu pour la pluie et le soleil, la guerre et la paix, le chagrin et la joie, quoi qu’il advienne. » Tom grandit auprès d’eux sans que le lecteur sache grand chose des camarades de son âge, qu’il doit trouver bien puérils. Un jour apparaît Helga, venue de sa lointaine Islande pour accomplir les tâches ménagères, Helga dont tous les hommes de la maison vont s’éprendre. Et Tom, héros, en fait, d’une tétralogie de Bauer, futur homme, n’est pas le dernier à succomber aux charmes de cette femme qui est avant tout un corps, un corps immense pour lui. Des continents de plaisirs et de déceptions s’annoncent, devine-t-il. « Il scruta en biais son fin profil, mais évita de regarder l’inoffensive prune pas mûre entre ses jambes, qui cependant grandit dans le miroir quand il pensa à Helga, se dressa pour devenir un crayon de charpentier le long de son ventre, ne s’épaissit pas, mais s’allongea en s’affinant, et il tira dessus, tira tant qu’il pouvait pour devenir adulte en vitesse, tira jusqu’à en gémir de douleur… » Roman initiatique, donc, prenant pour cadre le début des années 1950, roman rempli d’humour et d’une écriture riche, qui décline la nostalgie des premiers émois amoureux. Par ailleurs voyageur (l’Afrique, l’Irlande du Nord, Paris) et dramaturge, Ola Bauer (1943-1999) reçut plusieurs prix littéraires. Pour amateurs de belle littérature dans la lignée, par exemple, de Axel Sandemose, auquel il avait été comparé.
* Ola Bauer, La Nébuleuse de la Tête de Cheval (Hestehodetåken, 1992), trad. Céline Romand-Monnier, Gaïa, 2015
La Brasse indienne

Outre l’intérêt de leur catalogue, l’une des principales qualités des éditions Gaïa est de ne pas proposer systématiquement aux lecteurs des romans qui viennent de paraître (on se souviendra par exemple, parmi beaucoup d’autres titres, de La Saga des émigrants de Vilhelm Moberg ou de Pelle le conquérant de Martin Andersen Nexø). Nombre de romans sont passés inaperçus lors de leur parution et les traduire quelques années plus tard peut être opportun. Il y avait eu ainsi La Nébuleuse de la Tête de cheval de Ola Bauer, une belle découverte pour les lecteurs, ici. Voici la suite de ce roman initiatique, La Brasse indienne. Nous sommes en 1957 et Tommy est de retour chez sa mère, à Oslo. L’artiste peintre n’est plus aussi fantasque que naguère, elle ne parle plus que rarement. Robert le rouge, lui, qui partage la maison avec elle, monte et démonte sa moto, enthousiasmant les gamins du quartier. Ola Bauer est toujours aussi prolixe, son style est dense et jamais à cours d’images. Ses phrases peuvent faire dix-huit ou vingt-deux lignes, les idées partir dans diverses directions, il ne s’essouffle pas. Ses personnages relèvent de la vie quotidienne (camarades de classe, professeurs, commerçants) pour la plupart et pourtant, il nous les décrit comme s’ils étaient, tous, exceptionnels, comme s’ils n’avaient pas d’équivalents. Avec une réelle poésie, Ola Bauer relate également comment Tommy, son alter ego, se confronte à l’amour. « Tommy, qui était-ce donc ? Une engeance de délateur, un fils de coureuse des foutus beaux quartiers. » Oui, de fait, mais aussi un écrivain en herbe, qui trompe son professeur de norvégien en lui refilant des devoirs largement inspirés de nouvelles d’Hemingway, qui triche mais… Il y a triche et triche et Tommy ne se contente pas de recopier, il transforme, il adapte, il réécrit carrément le texte et entre ainsi, comme à son corps défendant, dans la carrière… d’écrivain. La Brasse indienne constitue une belle suite à La Nébuleuse de la Tête de cheval et nous ne pouvons qu’espérer maintenant, dans un autre volume, voir Tommy s’affirmer en tant qu’adulte.
* Ola Bauer, La Brasse indienne (Svartefot, 1995), trad. Céline Romand-Monnier, Gaïa, 2016
Loki 1942

Le roman de Pierre Benghozi, Loki 1942, commence fort, avec cette institutrice dont un œil est crevé par des soldats allemands, en pleine salle de classe, devant ses élèves ; puis, avec certains de ces mêmes élèves, qui, alors qu’elle git par terre, inconsciente, lui crachent dessus et commencent à la violer… ! Musicien et chanteur, scénariste pour le cinéma, Pierre Benghozi (né en 1961, à Perpignan) situe l’action de ce roman en Norvège, dans la ville de Stavanger, au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Ida Grieg, la maîtresse, est une résistante. C’est par le biais d’un poème mettant en scène Loki, dieu de la dispute, qu’elle va « déclencher, dès réception par la Résistance, l’attaque d’un important convoi d’armes et de munitions ». Mais les Allemands sont au courant du projet et menacent de tuer Ida Grieg et cinq de ses élèves. Le thème de ce livre est intéressant, forcément, mais il est traité d’une manière qui laisse coi. Les élèves ne sont pas simplement des « cancres », comme cela est écrit en quatrième de couverture, leur conduite est ignoble. Pour de jeunes adolescents (avec une « institutrice » ?), elle est peu crédible (tout comme leur vocabulaire, qui correspond plus à celui de vieux bonhommes). Loki 1942 semble relever du « livre d’horreur », comme il y a des films d’horreur, sans le talent d’un Claude Seignolle (cf. Les Loups verts), par exemple, ou d’un George A. Romero (La Nuit des morts vivants). Nous ne voyons pas l’intérêt d’un tel livre.
* Pierre Benghozi, Loki 1942, Serge Safran, 2017
Trois chemins vers la mer

Trois chemins vers la mer, de Brit Bildøen (née en 1962, auteure de huit romans, celui-ci est le premier traduit en français, traductrice) – trois chemins de femme. Une même femme, en fait, à trois moments différents, qui se rejoignent : l’ornithologue suspecte une liaison entre Eivind et Emma, deux autres amoureux des oiseaux ; la vengeresse dépose le cadavre d’un chat sur un paillasson à l’entrée de la maison de l’homme qu’elle surnomme « l’État » ; la déboussolée, détruite par le refus des Services à l’enfance de lui permettre d’adopter – elle et son mari sont trop vieux. Cette femme tente l’impossible, reprendre en main sa vie. « La lumière d’avril baisse à travers la vitre et je ne ressens que de l’inquiétude. Où est la joie ? Tout est ici, maintenant, tout ce que j’aime. La lumière, le printemps, le chant des oiseaux. » La lettre des Services à l’enfance (ou plus exactement, puisque l’administration aime faire simple, la « Direction des services à l’Enfance, à la Jeunesse et à la Famille, sous l’égide du ministère des Solidarités et de la Santé ») la jette dans un gouffre. Elle essaie de se reprendre, fait des promenades avec Isa, sa chienne, contacte la presse, un avocat. « « À chaque argument on leur opposait deux contre-arguments. Chaque critique du raisonnement bureaucrate conduisait à de nouvelles humiliations, la négation de leur droit d’être un parent, un être humain. » L’administration décide, l’administration est anonyme, les chances des recours sont dérisoires. L’inhumanité ne souffre pas la contestation. Insister, c’est passer pour importun, c’est s’attirer les foudres d’autres administrations – policières, judiciaires, c’est se mettre à dos jusqu’à sa propre famille... D’ailleurs, cette femme se persuade vite qu’elle est folle et sans doute l’est-elle et même plus que cela puisque la police lui rend visite. Se venger contre l’homme qu’elle nomme « l’État » ? Quelle abjection ! Ce genre de personnage agit pour le mieux, avec l’objectivité que lui donne son statut. Un beau récit, une révolte froide, sobre et sensible. Soulignons, ce qui ne gâche rien, la belle maquette de ce livre publié chez Delcourt, éditeur uniquement de bandes dessinées jusqu’à il y a peu.
* Brit Bildøen, Trois chemins vers la mer (Tre vegar til havet, 2018), trad. Hélène Hervieu, Delcourt, 2020
Sa Majesté Maman

On connaissait la Trilogie des Neshov de Anne Birkefeldt Ragde (La Terre des mensonges, La Ferme des Neshov, L’Héritage impossible), romans pas inintéressants mais pourtant, selon nous, pas tout à fait convaincants. Dans Sa Majesté Maman, Anne Birkefeldt Ragde (née en 1957; notons que son nom est Birkefeldt et non Ragde où on la trouve souvent classée) retrace les derniers moments de l’existence de cette femme, Birte, qui, certes lui a donné la vie, mais lui a aussi fourni le goût de la lecture et de l’écriture. Un récit écrit simplement, au plus près des réalités quotidiennes, et de ce fait plutôt émouvant. Mère « un peu fêlée », « pas vraiment (…) comme les autres », Birte est à présent âgée de quatre-vingt deux ans. Atteinte d’un cancer, elle passe d’un hôpital à un autre. D’abord déboussolée, sa fille décide d’écrire à son sujet. « Depuis presque trois mois, je vivais dans un état d’urgence sans jamais m’être vue une seule fois en tant qu’écrivain ; je n’avais été que la fille d’une mère, une fille totalement submergée, vacillante et désespérée. » Célibataire et mère de deux filles, longtemps employée dans une usine de fabrication de sacs plastique, toujours en manque d’argent, espérant chaque semaine gagner au Loto, Birte était capable de soulever des montagnes – pour preuve, le premier mariage de sa fille Anne, organisé par elle presque de A à Z. Athée, femme émancipée, elle choquait ses collègues « communistes » car elle votait à droite. Anne B. Ragde trace d’elle un portrait vivant (après La Tour d’arsenic, où le portrait était surtout celui de sa grand-mère), enlevé pourrait-on dire, et parvient à susciter l’enthousiasme du lecteur pour cette femme à la fois banale et pourtant exceptionnelle.
* Anne Birkefeldt Ragde, Sa Majesté Maman (Jeg har et teppe i tusen farger, 2014), trad. Hélène Hervieu, Fleuve, 2016
Oslo, de mémoire

Un beau jour, le narrateur de ce roman, Oslo, de mémoire, romancier et spécialiste du cinéma de la Belle Époque, chargé notamment de la restauration des films muets, est contacté par une certaine Liv Fure, cinéaste norvégienne qui lui demande de l’aide pour un reportage sur Cora Sandel. Le nom de cette dernière ne lui dit rien. Se renseignant, il découvre que cette écrivaine (Sara Fabricius, dite Cora Sandel, 1880-1974) est encore célèbre en Norvège ; un seul titre d’elle, au début des années 2010, avait été traduit en français : Alberte et Jacob (éd. des Femmes, 1991). Une fausse autobiographie en trois volumes (le troisième toujours inédit en français d’une même femme : Sara Fabricius/Cora Sandel/Alberte Selmer. Oslo, de mémoire est l’occasion de déambuler dans la capitale norvégienne, mais aussi dans les lieux parisiens, hôtels, restaurants ou encore école de dessin, où l’écrivaine, déçue par la mentalité selon elle étriquée de ses compatriotes d’alors, a passé une partie de sa vie. À son image se superpose d’abord celle de Inga, ancienne petite amie du narrateur, lorsque celui-ci était allé jusqu’au Cap Nord en 2CV avec un camarade, avant de s’arrêter à Oslo et de vivre une expérience amoureuse. Qui ne survivra pas à son retour en France : « J’avais préféré me refermer sur son fantôme. Faire d’Inga une étoile filante. Aimer une absente. » Puis celle de cette énigmatique Liv Fure, dont il finit par s’éprendre : « Une femme de trente, trente-cinq ans, brune, tout en noir, un grand sac en bandoulière, des lunettes rouges – une étrangère, du Nord, avec un accent, léger... » Enfin, viennent là-dessus les terribles attentats de juillet 2011 à Oslo et Utøya. Ce court roman est plutôt agréable à lire, mais on peut se demander quel est son intérêt. Enfin, dans la mesure où il convient d’en trouver un, ce qui n’est pas une obligation. Peut-être celui de susciter une nostalgie que les années ne sauraient affecter. L’éclosion de souvenirs heureux... « Je me sentais très vieux. Dehors, la pluie tombait plus fort. Il faisait nuit. Je n’avais pas le courage de me lever. »
* Didier Blonde, Oslo, de mémoire, Gallimard, 2024
Court Serpent

Quelle écriture ! Car, à la lecture de ce premier roman de Bernard du Boucheron (né en 1928), c’est le qualificatif qui vient d’abord à l’esprit. Court Serpent est un roman à l’écriture riche, foisonnante, surprenante. Outre le thème, non moins déroutant. Un premier roman publié par un énarque à l’âge de... soixante-seize ans. À la fin du XIVe siècle, l’abbé Montanus est chargé de conduire une expédition pour retrouver une communauté d’hommes perdue quelque part « au Nord du monde », au « Nord absolu » (la « Nouvelle Thulé », autrement dit le Groenland) et échappant aux règles de la chrétienté. Une cathédrale et des églises ont été bâties là où une communauté chrétienne s’est installée, mais qui n’a plus donné de nouvelles depuis longtemps, au moins « trois générations », de mémoire d’homme. « Dans les temps anciens, il n’existait pour les peuples de Nouvelle Thulé d’autres autorités que celles de l’Église et du Roi. Le long abandon où les ont laissés l’une et l’autre a fait que chaque fjord s’est donné un chef, et que souvent cette fonction, d’abord d’élection, s’est transmise de père en fils. » Quand l’abbé Montanus retrouve les traces de la communauté, il constate avec effroi que la mort règne. Le froid, la faim, les maladies ont eu raison des colons. Les événements qui ont précédé leur mort montrent que la barbarie est le revers de toute civilisation : bestialité, inceste, anthropophagie, violences extrêmes... L’animalité, dans ce que le terme a de plus péjoratif, a remplacé l’humanité. La religion comme remède ? Les méthodes de l’abbé Montanus prouveraient, si besoin était, que le mieux est l’ennemi du bien.Court Serpent est un roman qui ne tait rien des violences que l’être humain peut infliger à ceux de son espèce.
* Bernard du Boucheron, Court Serpent, Gallimard, 2004
Les Filles d’Égalie

« Les hommes étaient-ils plus stupides et irresponsables que les femmes ? » Ce roman, Les Filles d’Égalie, est sorti une première fois en Norvège en 1977. Publié avec succès dans divers pays ensuite, il ne voit le jour en France qu’aujourd’hui. Force est de reconnaître son étonnante actualité : dans la société d’Égalie, les femmes sont au pouvoir depuis plusieurs siècles. Gerd Brantenberg (née en 1941) s’est amusée avec la grammaire et le vocabulaire, féminisant tout ce qu’elle pouvait, prouesse dont le traducteur (Jean-Baptiste Coursaud) est venu à bout très honnêtement. Dans ce monde, les hommes ont les seconds rôles ; affublés de « parties honteuses », ils sont considérés comme des potiches – à peu près comme nombre d’entre eux considèrent les femmes aujourd’hui. « Pour peu que cette dignité fumaine se rende maîtresse des sens de ses sujettes, et pour peu également qu’elle intègre en son sein la moindre petite âme sur cette Terre, alors, Égalie – notre glorieuse matrie – conserverait à jamais sa grandeur. » Si l’ensemble de la population approuve la répartition des tâches, certaines et certains s’interrogent sur la lutte des classes toujours présente et qui ne disparaîtra pas tant que le pouvoir sera considéré comme résultant exclusivement du conflit hommes-femmes. « Ce sont les femmes qui décident de ce qui doit être publié. Ce sont les femmes qui décident de ce qui est essentiel et de ce qui est accessoire. Ce sont les femmes qui écrivent l’Histoire. » Les questionnements ici présents ou sous-jacents ne semblent pas dater d’il y a bientôt cinquante ans. La rhétorique contemporaine importée des États-Unis sur les places et rôles sexuels apparaissent. Les Filles d’Égalie est le roman féministe de la SF et son adaptation au cinéma est facile à imaginer. Un classique, de fait.
* Gerd Brantenberg, Les Filles d’Égalie (Egalias døtre, 1977), trad. Jean-Baptiste Coursaud, Zulma, 2021
