R-S-T
Regarde
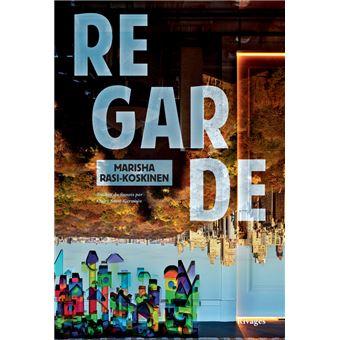
« Les histoires des autres n’ont de sens pour nous que dans la mesure où elles nous aident à élaborer la nôtre », affirme, par la voix de l’un de ses personnages, Marisha Rasi-Koskinen (née en 1975 à Juväskylä) dans ce foisonnant roman, Regarde. Deux presque frères en sont au centre : Cole, l’aîné de quelques mois, et Lucas. Quand ils font connaissance, ils ont treize ans. Lucas est timide, il pense être banal, transparent. Cole, au contraire, est entreprenant et révèle qu’il a un frère jumeau, Nik, hospitalisé pour maladie mentale ou, lorsque celui-ci séjourne à la maison, interdit de sortir de sa chambre, sous la surveillance d’une mère acariâtre. « Nik à qui personne ne pouvait poser de limites. » Mais ce jumeau existe-t-il vraiment ? Lucas ne sait guère à quoi s’en tenir. « Le plus effrayant était que Cole soit fou. » Lucas découvre que son ami proche souffre de schizophrénie, il s’éloigne de lui, assume de mieux en mieux sa bisexualité et entame une liaison avec Isak. Laquelle dure ce qu’elle dure. Titulaire d’une maîtrise en psychologie, l’auteure sait donner vie à ses personnages, leur dédiant son roman (« aux personnes fictives ») et fouillant dans leur psychologie constituée en partie de traumatismes et de non-dits. « S’il y avait des images, la première comporterait une montagne », écrit-elle, axant ses descriptions sur le regard porté autour de soi et, une fois bien avancée dans le récit, de replacer ses deux figures principales à l’âge de trente-trois ans. Lucas et Cole se retrouvent. La passion demeure. La photographie les unit toujours, elle donne un sens à leur vie. Après la rencontre de Lucas avec une jeune femme prénommée Eve, ils décident de consacrer à celle-ci une vidéo. « Aux petites heures de la nuit, ils proclamèrent d’une seule voix qu’un fantasme réalisé était un cauchemar, et dans le même temps, décidèrent qu’ils en feraient un documentaire. » Le récit avance, fourmillant de détails, de pensées. C’est beaucoup. Sept cent quarante pages. Une grosse première partie autour, d’abord et essentiellement, de deux personnages au charisme limité, c’est trop. Puis l’auteure opte pour d’autres personnages, avertissant le lecteur, semblant l’associer à ses choix, observant ses protagonistes comme autant d’acteurs accomplissant une performance : « Moi aussi je suis deux ». L’embouteillage provoqué par le véhicule et la caravane de Johan, Katherine et leur fils, coincés au centre d’une petite bourgade d’Europe centrale, prête à sourire, avant de se muer en tragi-comédie. Un emballement de faits à la Kafka, logique et folie douce avancent de concert. Tout comme les péripéties de deux auto-stoppeurs... Jusqu’à ce que Nik ressurgisse, bouclant la narration. « Je m’appelle Nik. Sur la dernière image, je souris. » Un vrai roman, avec une progression de l’intrigue, un roman dense. Mais qui ne nous emballe que modérément, tant il nous semble d’un déploiement excessif, jetant sur la scène des personnages, pour peu qu’on les regarde avec quelque recul, sans grande consistance. Un remarquable exercice de style.
* Marisha Rasi-Koskinen, Regarde (Rec, 2020), trad. du finnois Claire Saint-Germain, Rivages, 2023
La Mémoires des mers

« J’ai toujours du mal à imaginer le Nord sans la guerre. Sans ses ruines et ferrailles militaires, ses vieux pêcheurs soûls parlant des terres brûlées en Pays same, des églises et des barques incendiées. Des prisonniers squelettiques. » Mais voilà qu’en 1980 Aapa Virtanen revient dans cette Laponie norvégienne où elle est née, où l’on parle kvène, un dialecte d’origine finnoise, afin de réaliser un documentaire pour le compte d’une compagnie pétrolière. « Les pétroliers ne sont que des voyous. Vous détruisez tout ce que nous avons », lui lance Henrik, une vieille connaissance. Elle est aujourd’hui installée en Floride et se nomme Auruura. Le retour dans son « misérable bled » la met mal à l’aise. Sa grand-mère est hospitalisée et, avant de mourir, lui évoque quelques pages troubles du passé. Elle est déboussolée et apprend des choses auxquelles elle ne s’attendait pas. Mais le travail presse. « Grosso modo, il s’agit de montrer comment le pétrole développe les sociétés et augmente le bien-être, à l’échelle mondiale, depuis plusieurs décennies. » Ce à quoi Henrik répond (en 1980, rappelons-le) que l’exploitation pétrolière a conduit au réchauffement climatique, catastrophe d’envergure en cours et encore plus à venir. Après Un Pays de neige et de cendre, Pera Rautiainen (née en 1988) offre un nouveau roman enthousiasmant, jouant sur l’ambiguïté des personnages – peut-être sa marque de fabrique. Entrecoupé d’un « Journal de voyage » sans dates, le récit montre la réalité de la modification du climat, directement perceptible dans les zones arctiques et ce, bien avant les rapports extrêmement alarmants du GIEC et d’autres organismes scientifiques. Qui le veut voit, peut-on dire. Mais l’héroïne, elle, s’y refuse d’abord. « La ligne officielle, c’est que nous nions le changement climatique et passons à l’action vis-à-vis de tous ceux qui nous contredisent. » La théorie du complot est ensuite mentionnée, pour discréditer ceux qui parlent de changement climatique – ce qui nous semble un anachronisme car en 1980, si l’on parlait couramment de rumeurs ou de falsification de l’histoire, l’expression « théorie du complot », certes existante, était encore très peu usitée : elle ne s’est réellement développée qu’après le 11 septembre 2001 et les attentats de New York. Mais qu’à cela ne tienne, Aapa réalise peu à peu que l’accident entre le bateau dans lequel sa mère avait pris place et une baleine s’explique, notamment, par les itinéraires des convois pétroliers, qui perturbent les cétacés et les rendent fous. Le monde économique ne saurait avouer une telle vérité ! « Les pétroliers se sont infiltrés de tous côtés. Ils se sont fait des amis dans tous les journaux majeurs, et ils dictent à la presse ce qu’il faut dire ou non sur la production d’hydrocarbures. Ils achètent le silence de leurs opposants, financent des manuels scolaires favorables à l’industrie pétrolière. Ils mentent. » Un roman très intéressant. « Personne n’entend les pleurs des baleines. » Hélas !
* Petra Rautiainen, La Mémoire des mers (Meren muisti, 2022), trad. du finnois Sébastien Cagnoli, Seuil, 2024
Un Pays de neige et de cendres

1947. La journaliste et photographe de presse Inkeri Lindqvist surgit à Enontekiö, une petite ville du nord ouest de la Finlande, pour suivre les travaux de reconstruction. La région a, en effet, été totalement détruite lors du départ des troupes nazies. Mais comme beaucoup vont s’en apercevoir, une autre raison explique sa venue : elle est à la recherche de son mari, Kaarlo Lindqvist. Avec Un Pays de neige et de cendres, Petra Rautiainen (née en 1988 et spécialiste de la représentation du peuple same dans les médias finlandais) livre un roman historique (situé essentiellement entre 1944 et 1950) empreint de cette poésie propre aux contrées lapones – même dévastées par la guerre. « En supposant que quelque chose avait pu pousser autrefois dans ce pays de bouleaux nains, il n’en restait aucune trace. La terre avait été excavée, détruite et incendiée. Les rares arbres non abattus pendant la guerre avaient brûlé après. » La quête de l’homme aimé se double ici d’une quête mémorielle. Qui était-il ? Comment a-t-il traversé l’épreuve de la guerre ? Autrement dit, en Finlande, les deux guerres contre l’URSS, le ralliement à l’Allemagne nazie (qui considère les Lapons comme une « anomalie pathologique résultant de facteurs environnementaux »), et la dévastation de la Laponie par les nazis lors de leur fuite à la fin du conflit. Était-il du bon côté ? Un roman qui livre ses réponses lorsque le lecteur ne les attend plus. Portrait par défaut d’un individu que ses pérégrinations sur la planète conduisent dans un camp de prisonniers où des recherches sur la « race » sont menées... Portrait non moins flou de son épouse, à la poursuite d’un homme qu’elle ne reconnaîtrait peut-être pas. Troublant roman.
* Petra Rautiainen, Un Pays de neige et de cendres (Tuhkaan piirretty maa, 2020), trad. Sébastien Cagnoli, Seuil, 2022
Sans toucher terre

Aaro vient de s’inscrire à la fac, à Jyväskylä, deuxième plus grande ville universitaire de Finlande (140 000 habitants). Mâle peu dominant, ses camarades le harcelaient au collège, il espère que sa vie sera maintenant plus paisible. Mais il a la constante impression que tout le monde le regarde, il se sent différent des autres. Peut-être ne l’est-il pas, lui qui ne peut prononcer dix mots sans citer le nom d’une marque, un parfum ou un vêtement ou même un savon, et dont les goûts sont à peu près à l’unisson de ceux de sa génération. Aaro a des problèmes d’érection, il n’a pas l’impression d’être un vrai garçon, pas non plus une fille. Il cogite sur sa coiffure, son teint, son allure vestimentaire. « Les gens me regardent. Je n’arrête pas de me passer la main dans les cheveux. » Il est le centre du monde. En bref, il se cherche, chose assez fréquente à son âge. Une phrase de Karl Ove Knausgaard est en exergue de ce récit, Sans toucher terre. C’est effectivement du même niveau, nombriliste au possible, une littérature pour ados dans une collection pour adultes. (Comment dire du mal d’un livre qui traite du harcèlement sans passer pour un sans-cœur ?) Assez intéressante pour que Antti Rönkä (né en 1996) y consacre deux cents trente pages ? Pas évident.
* Antti Rönkä, Sans toucher terre (Jalat ilmassa, 2019), trad. Sébastien Cagnoli, Rivages, 2021
Le Plus petit dénominateur commun

La romancière, scénariste, comédienne (parmi nombre d’autres casquettes) Pirkko Saisio (née en 1949 à Helsinki) trace sa biographie et celle de sa lignée dans ce premier volume, Le Plus petit dénominateur commun, de sa Trilogie de Helsinki. Sa narration est linéaire mais le nombre de personnages, cousins, cousines, tantes et oncles, grands-parents et autres voisins et voisines, oblige le lecteur à maintenir son attention. Ce qui n’est pas difficile. Les situations sont décrites avec verve, l’auteure n’est pas dramaturge pour rien, elle s’empare des traits de caractère de l’un et d’une anecdote vécue par un autre pour, ficelant le tout, raconter une bribe d’histoire. « Je suis un garçon, grand, en troisième année d’école primaire, et mes mains sont couvertes de cicatrices de soudage », s’imagine-t-elle. « ...Elle est en colère contre sa mère qui l’empêche d’être forte, insouciante, indifférente et garçon ». Fille ou garçon, pourquoi impérativement choisir ? « Elle s’est divisée déjà plusieurs fois : invisible et présente ; consolatrice et consolée ; fille et garçon ; obéissante et rebelle. » Après tout, elle n’est pas la première ni la seule à faire montre d’irrésolution. « Jésus a une barbe comme les hommes, mais une jupe et des cheveux longs comme les femmes. Jésus n’est ni un homme, ni une femme. Jésus est intéressant. » Le Plus petit dénominateur commun avance ainsi, de façon un peu décousu mais ce n’est pas gênant, au contraire, il tire sa force d’une interpellation constante des personnages – et par là-même du lecteur. S’il n’est pas écrit directement pour la scène, on l’imagine très bien adapté au théâtre. La population d’Helsinki, celle de l’après-Seconde Guerre mondiale, est conviée au rendez-vous. Nous ne savons pas si ce livre mérite réellement les différents prix qu’il semble avoir reçus, mais il s’agit-là d’un texte fort sympathique. (Les deux autres volumes de la trilogie, À contre-jour et Le Livre rouge des ruptures, sont d’ores et déjà annoncés.)
* Pirkko Saisio, Le Plus petit dénominateur commun (Trilogie de Helsinki, 1) (Pienin yhteinen jaettava, 1998), trad. du finnois Sébastien Cagnoli, Robert Laffont (Pavillons), 2024
À contre-jour
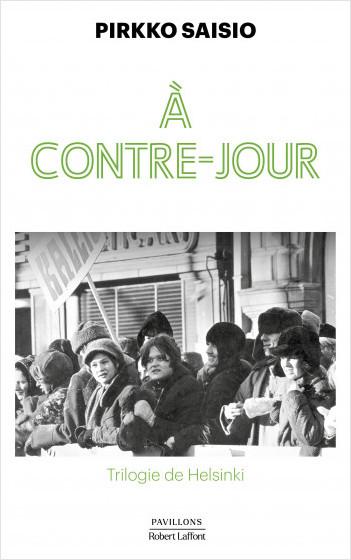
Deuxième volume de la Trilogie de Helsinki, À contre-jour prend les années 1968 pour cadre, quand « le monde se délite comme un ballon gonflé à l’hélium... » Âgée de dix-neuf ans et poussée par ses parents qui estiment qu’elle doit maintenant gagner sa vie, la narratrice de cette autobiographie quitte la Finlande pour un emploi dans un orphelinat en Suisse. « Je viens d’un pays qui peut fort bien paraître primitif, voire bizarre, à ceux qui ont vécu au cœur de l’Europe (…). Dans ces pays, par exemple en Suisse, on n’a pas connu la guerre, les pénuries, le gel ou l’évacuation en Suède. » Peu à l’aise avec les normes sociales, tant celles de son pays natal que celles de celui d’accueil, elle multiplie les bourdes. Deux récits s’entrecroisent, en Finlande et en Suisse, avant et après son départ. Pirkko ne se prend pas au sérieux, si ce n’est qu’elle n’en démord pas : elle sera écrivaine. Ou, à la rigueur, exercera une profession artistique, comédienne par exemple. Pour le moment, elle se cherche. Les femmes ne la laissent pas insensibles mais les relations entre elles la gênent. Le rythme ne ralentit pas, c’est plutôt drôle, quelquefois pourtant un petit peu décevant. Trop introspectif peut-être, beaucoup de moi je, moi je, assez loin de la dimension atteinte par l’autobiographie de la Danoise Tove Ditlevsen (La Trilogie de Copenhague, publiée dans le même temps), modèle du genre. « Moi aussi je suis devenue une autre. Je viens de vivre la première métaphore de ma vie », dit Pirkko. Attendons la suite, récompensée par le prix Finlandia, ce qui n’est pas rien.
* Pirkko Saisio, À contre-jour (Trilogie de Helsinki, 2) (Vastavalo, 2000), trad. du finnois Sébastien Cagnoli, Robert Laffont (Pavillons), 2024
Le Livre rouge des ruptures
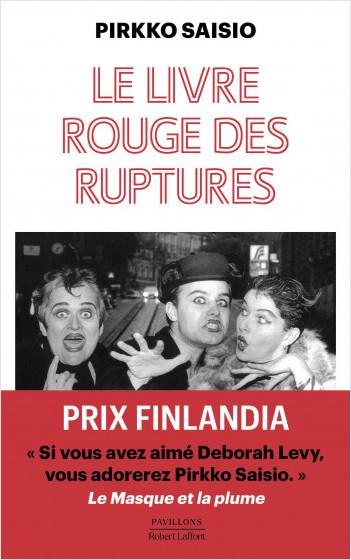
Troisième volume de la Trilogie de Helsinki, Le Livre rouge des ruptures s’inscrit dans les années 1970. Malgré des critiques dithyrambiques (« l’existence de Pirkko Saisio est indissociable de la littérature » : Le Nouvel obs, cité sur la jaquette du livre... !) les deux premiers volumes nous avaient laissé dubitatif, le procédé consistant à mêler souvenirs personnels et événements sociétaux ou historiques ne fonctionnant pas systématiquement, contrairement à ce que semble penser l’auteure. À commencer par cette page en guise de préambule : « Il faut ouvrir des portes ; il faut en fermer. Penser à refermer les portes ouvertes. Penser à respirer. » Ou, plus loin : « On s’habitue à tout, mais pas à aimer ». Le genre de phrases qui foisonnent dans les ouvrages dits de développement personnel et qui donnent à penser qu’il y a là... matière à penser ! Surtout, l’envie de sauter des paragraphes, des pages, pour éviter cette redondance lassante, ces poncifs d’adolescent (née en 1949, l’auteure sort de cet âge qui peut être ingrat, on le voit). Pirkko Saisio poursuit sur sa lancée des deux volumes précédents : le premier, ok, on découvre ; le deuxième, bof ; le troisième, aïe ! Avec toujours ces paragraphes qui se terminent par « Et » pour embrayer sur le paragraphe suivant... Pourquoi pas, mais abus de bien nuit, n’est-ce pas ? La voici jeune femme à présent, toujours en pleine quête de sa personnalité au travers de sa sexualité. « Elle veut être une criminelle. Autrement, elle n’est rien. » Le lecteur accompagne Pirkko à la plage (« Sternes, mouettes et goélands poussent des cris dans le bleu pâli par le soleil »...), Pirkko à l’enterrement de sa mère (« Ça n’arrive pas, une chose pareille, ça ne doit pas arriver. Comment peut-on être sans mère ? »), Pirkko sur scène, etc. Puis (le récit avance en zigzag, avec de fréquents retours en arrière) Pirkko « avec une fille », ce qui choque sa mère... Pirkko, dont le père « sur invitation du Parti Communiste de l’Union Soviétique », passe ses vacances à Ialta... Puis Pirkko s’enthousiasme pour la révolution, en même temps qu’elle commence le théâtre. Rien que de très banal, en somme, pour une jeune femme ou un jeune homme de ces années-là, qui tente de donner un sens à sa vie. Le récit s’amorce lentement et, faisant fi des énumérations et des répétitions qui... se répètent (« Elle met l’Enfant-Miracle dans les bras de Havva. L’Enfant-Miracle ouvre les yeux. Havva regarde l’Enfant-Miracle. L’Enfant-Miracle sourit à Havva... » Et ainsi de suite. Comme pour tout procédé stylistique, trop c’est trop !). Ensuite, donc, le lecteur observe de plus ou moins bonne grâce les événements de la vie nombriliste de l’auteure. Heureusement qu’elle se targue d’un conseil de Bertold Brecht en personne, qui « la met en garde contre la paresse et l’apitoiement sur soi » ! On peut se dire que Pirkko Saisio est passée à côté d’une grande œuvre autobiographique ; dommage, car certains passages sur le théâtre ou l’homosexualité sauvent le reste. « Je voulais être emportée dans l’orage rougeâtre et débordant. »
* Pirkko Saisio, Le Livre rouge des ruptures (Trilogie de Helsinki, 3) (Punainen erokirja, 2003), trad. du finnois Sébastien Cagnoli, Robert Laffont (Pavillons), 2025
Tout commence par la baleine

C’est un beau et riche roman que signe Cristina Sandu avec Tout commence par la baleine. La narratrice est une femme prénommée Alba. Mihai, son père, est né en Roumanie. Enseignant et philosophe, il a épousé Eeva, une Finlandaise qui travaille dans un musée. La famille s’est installée à Helsinki. Quand meurt le grand-père paternel, surnommé Le Loup sans que personne ne sache plus pourquoi, Alba se remémore ses étés passés, à partir des années 1950, dans un petit village roumain près de la frontière serbe. « À l’arrivée de la Dacia tant attendue, les voisins étaient au spectacle. L’un agitait la main, l’autre s’exclamait après les toussotements du moteur. La nuit tombait en un instant, pareille à une cape magique. Nous étions arrivés. » Et là, se révèle un autre monde, où règne un communisme autoritaire abject – au nom de principes de générosité, d’égalité. Loup, qui a construit de ses mains et en une nuit, selon la légende familiale, la maison dans laquelle Flavia, les enfants et lui vivront, est milicien. « Pendant les élections, on enjoint au camarade Loup de se cacher dans un grenier dont le plancher disjoint donne vue sur l’isoloir. Ceux qui ont mal voté sont emprisonnés peu après. » L’un de ses voisins, dont il donne l’adresse aux forces de la Securitate, est arrêté pour homosexualité. En 1989, la chute du dictateur Ceau?escu transforme les structures économiques mais n’améliore guère la vie quotidienne des habitants, grugés par des politiciens pour certains déjà en place avant la pseudo-révolution. Le frère de Mihai gagne au Loto et s’installe avec sa femme aux États-Unis. Si tous deux apprécient le luxe et le clinquant, ils sont pourtant nostalgiques de leur Roumanie natale : « ...Le village se modernise, ses habitants n’apprennent rien. Ils se gâtent les dents au Pepsi, le foie à la bière et les poumons au tabac, leurs sourires sont édentés, leur peau, sans protection contre les rayons du soleil, est ridée, ils insultent et médisent, et le seul qu’ils croient est le curé qui leur vole le peu d’argent qu’ils ont, mais leur promet le ciel. » Alba, elle, s’éprend d’Albert, un Roumain qui préférera rester au pays plutôt que d’émigrer en Finlande. Un beau roman, sans conteste, avec des personnages bien différents les uns des autres, une page d’histoire récente dans un pays ancré dans ses traditions, une réflexion sur l’attachement au sol natal, sur l’émigration...
* Cristina Sandu, Tout commence par la baleine (Valas nimeltä goliat, 2017), trad. Claire Saint-Germain, Robert Laffont, 2020
Comment naît l’amour

Il existait, en traduction française, deux livres de Raija Siekkinen (1953-2004) : L’Été dernier (L’Esprit ouvert, 1997) et Une Fissure dans le paysage (L’Esprit ouvert, 1998). Ce recueil de nouvelles publié aujourd’hui par Le Castor astral permettra de redécouvrir l’œuvre d’une auteure singulière des lettres finlandaises. Les dix nouvelles qui composent Comment naît l’amour partent toutes d’une anecdote de la vie quotidienne située sur un marché, dans la rue, dans un aéroport, sur une plage... Des nouvelles écrites par une femme, qui plus est finlandaise, qui mettent en scène des femmes au travers de leur vie de tous les jours... : difficile de ne pas évoquer Tove Jansson. Mais, d’une part, Raja Siekkinen écrit en finnois et non en suédois, et, d’autre part, elle tient son originalité dans le fait que ses nouvelles à elle sont peut-être plus ancrées dans le concret d’individus banals : « Je croyais au temps. Je pensais qu’il me menait dans une spirale continue, toujours plus loin de l’endroit dont je voulais m’éloigner, s’approchant parfois, s’éloignant sans cesse. Et puis une fleur fanée ou une mouche de l’année précédente trouvée en faisant le ménage me ramenaient brusquement en arrière, l’espace d’un instant, à travers tout ce long voyage. » Remarquons que la nouvelle qui donne son titre au recueil, Comment naît l’amour ( : « c’est un mystère ») est étrangement dépourvue de point d’interrogation. Un petit ouvrage à siroter, histoire d’un moment mettre ses pas dans ceux des personnages.
* Raija Siekkinen, Comment naît l’amour (Kuinka rakkaus syntyy, 1991), trad. Pierre-Alain Gendre, Le Castor astral (Galaxie), 2021
Avec joie & docilité
Après Jamais avant le coucher du soleil ou Le Sang des fleurs, c’est une nouvelle fois un roman que l’on peut qualifier d’anticipation que nous propose Johanna Sinisalo (née en 1958) avec Joie & docilité. « Vanna, je vais te demander quelque chose. Je ne veux pas que tu dises aux messieurs que tu sais lire et compter. Quand ils seront là, je veux que tu joues sagement à la ménagère avec Manna, que tu souris et que tu sois très gentille et aimable. Imite ta sœur en tout. » Pourquoi ces recommandations d’une grand-mère à l’une de ses petites-filles ? Parce que dans la République eusistocratique (« État providence, état de bien-être ») de Finlande de 2013 (nous sommes ici dans le domaine de l’uchronie, l’action de ce roman, qui bifurque d’avec la réalité, démarre en fait avant la Deuxième Guerre mondiale), la plupart des femmes appartiennent à l’espèce des éloïs. Les récalcitrantes, appelées morlocks, qui se veulent les égales des hommes, les « virilos », sont peu nombreuses. Mais il s’en trouve encore au moins une, Vanna/Vera, la narratrice de ce roman. Et Vanna/Vera est mal à l’aise face à ce gouvernement qui entend veiller au bien-être de chacun en attribuant des rôles, et notamment ceux relevant du genre, très précisément définis. « Dans ce carnaval de paons et de poupées, dans ce musée des horreurs, il s’est produit exactement ce qui n’aurait pas dû. Je me suis détachée du lot. » Toutes les sensations quelque peu fortes sont proscrites, aussi ne trouve-t-on plus de tabac, d’alcool ni de drogues. Sauf le vénérable piment, que l’État peine encore à repérer, qui est à présent vendu sous le manteau, sous forme de paillettes, nouvelle substance hallucinogène dont Vanna est dépendante. Il y a plusieurs possibilités de lire ce roman, Avec joie & docilité. La question du « dressage » des « fémines » – ou des femmes – voulue par un État eugéniste pratiquant une dictature sans violence ostensible appelle à réfléchir sur la place des uns et des autres (et pas seulement des femmes) dans un monde déshumanisé pour des raisons a priori recevables. Un monde qui ressemble par ailleurs beaucoup au nôtre (la conduite des « élois » et des « virilos », avec la femme-princesse et l’homme-coq, n’est même pas une caricature de ce que l’on peut observer tous les jours autour de nous). « …Une vie heureuse et équilibrée exige par nature différentes sources de bien-être (…) : l’exercice physique, une activité sexuelle régulière et satisfaisante, un rôle de chef de famille gratifiant et – pour le sexe faible – les joies de la maternité. » Un roman à lire avant ou après Le Syndrome du bien-être de Carl Cederström et André Spicer, car prolongeant la réflexion, sous forme de fiction, sur le même sujet : qu’est-ce que le bonheur et, en l’occurrence, à l’échelle d’un État ou d’une société ? À quel prix se paie-t-il ? À quel moment peut-il y avoir tromperie sur le mot ?
* Johanna Sinisalo, Avec joie & docilité (Auringon ydin, 2013), trad. Anne Colin du Terrail, Actes sud, 2016
Le Reich de la Lune
« Pour ceux qui ont vu le jour sur la Lune après la guerre, l’ancienne Terre est un conte de fées. » Avec Le Reich de la Lune, Johanna Sinisalo reste dans la veine qui la caractérise, celle de l’anticipation et de l’uchronie, mâtinée de questions sociales et d’actualité. Rebondissant sur l’idée centrale du film Iron sky (film de Timo Vuorensola, 2012, dont Johanna Sinisalo a écrit le scénario : les nazis se sont réfugiés sur la Lune après la Deuxième Guerre mondiale), l’écrivaine envisage leur retour sur Terre. Mais au fil des années bien des choses ont changé et aujourd’hui, la révolution numérique donne au monde un visage qu’ils ne pouvaient pas imaginer. Quand Renate Richter suit son mari, le SS Klaus Adler, lors de son voyage à destination de la Terre, avec James Washington, noir « aryanisé » pour les guider et arrivé sur la Lune suite à une expédition qui a mal tourné, la surprise est totale. Tout intrigue cette jeune femme, inspirée par l’idéologie nazie toujours prônée dans l’immense bunker sur la Lune. « ...Nous avions une mission à accomplir sur la Terre. Nous voulions balayer de notre chemin les forces malfaisantes qui s’opposaient à nous, détruire toute pensée fausse et nous battre pour les seuls vrais idéaux, les nôtres. » Ceux du national-socialisme. Autrement dit, « ramener la Terre entière à une vision de la société simple, claire, juste et digne, garante de richesse et de bonheur »... ! Parce que l’idéal nazi est « le plus juste, le plus pur, le plus sage, le plus harmonieux et le plus pacifique du monde » et que personne de censé ne saurait y résister ! Mais l’une après l’autre les illusions de Renate sombrent et elle s’aperçoit qu’elle a été leurrée depuis sa naissance. Elle comprend que la guerre que les habitants de la Lune et ceux de la Terre s’apprêtent à mener va encore frapper des individus qui pourraient vivre en harmonie. « L’histoire peut se répéter, car elle n’a jamais été écrite avec la raison, mais avec les sentiments. Mais il ne peut quand même pas être dit que chaque génération doit avoir son Hitler ? » Espérons que non. Comme dans ses précédents ouvrages, avec Le Reich de la Lune Johanna Sinisalo nous semble partir d’une idée intéressante, sans parvenir à nous convaincre totalement. Peut-être parce que les nazis sont ici plus ridicules que méchants...
* Johanna Sinisalo, Le Reich de la Lune (Iron sky – Renaten tarina, 2018), trad. Anne Colin du Terrail, Actes sud, 2018
Bolla

Années 1990, région de Pristina. La guerre du Kosovo éclate. Arsim est Albanais. Miloš est Serbe. Le premier est marié et sa femme va bientôt lui donner un enfant. « Je vais devenir écrivain (…) et ça ne me paraît plus du tout une bizarrerie, ni une illusion, mais l’avenir. » Tout n’est pourtant pas si simple car ce n’est pas de son épouse dont il se sent amoureux : « C’est le début d’avril et je désire un autre homme avec si peu d’équivoque, avec tant de clarté que, tout le reste de l’après-midi, il est dans les prières par lesquelles sans vergogne je demande à Dieu qu’il soit mien. » Miloš, lui, fait le service dans des restaurants pour payer ses études de médecine. Les deux hommes vivent une belle aventure, jusqu’à ce que Arsim et les siens émigrent dans un pays nordique pour échapper à la guerre et trouver du travail. « Notre vie aurait dû s’achever le jour où nous nous sommes vus pour la dernière fois, ç’aurait été vraiment bien mieux pour nous de ne pas nous réveiller le matin suivant », songe-t-il bien plus tard. L’exil n’est pas facile, Arsim se montre vite violent avec Ajshe, sa femme, et ses enfants. Un jour, il est accusé d’avoir eu une relation sexuelle avec un mineur, un jeune garçon de quatorze ans qui s’était présenté à lui en s’en donnant dix-sept. Il est arrêté, condamné à une peine de prison, puis expulsé. Né en 1990 au Kosovo, Pajtim Statovci a déjà publié deux romans traduits en français (Mon chat Yugoslavia, 2016, et La Traversée, 2021). Bolla est un roman plus intéressant que ce que la quatrième de couverture laisse penser ; il ne s’agit pas que d’une histoire d’amour, aussi difficile à vivre soit-elle, mais plutôt d’un roman sur la féroce adversité du quotidien. Les personnages principaux sont tous assez piteux, Arsim parce qu’il frappe sa femme et ses enfants et n’assure guère son homosexualité, ce qui n’est évidemment pas des plus faciles à faire pour lui, Miloš parce que sa conduite, le lecteur le découvre, peut être abjecte, et Ajshe pour accepter ses conditions de vie – mais, d’une part, comment pourrait-elle faire autrement, et, d’autre part, c’est elle qui sauve les autres de par sa droiture et sa générosité. Un beau roman, au final, avec des personnages complexes, aussi piètres que bien étrangement attachants, tous emportés pour le meilleur et surtout le pire par les aléas de la vie.
* Pajtim Statovci, Bolla (Bolla, 2019), trad. du finnois Claire Saint-Germain, Les Argonautes, 2023
Mon chat Yugoslavia
Deux récits alternent dans Mon chat Yugoslavia de Pajtim Statovci (né en 1990) : celui de Eminè, jeune fille albanaise dans la Yougoslavie des années 1980 (dans cette campagne qui deviendra le Kosovar), qui se retrouve mariée à un garçon qu’elle ne connaît quasiment pas, et celui de son fils, Bekim, étudiant à Helsinki, aujourd’hui. Eminè est d’abord terrifiée. « …Je compris que j’allais passer toute ma vie avec lui, et l’idée me défonça les côtes comme un engin de démolition la façade d’un bâtiment. » Mais en dépit des coups qu’elle reçoit dans l’automobile, en route pour les noces, elle épouse ce sale type, Bajram, qui lui fait cinq enfants et, quand la situation politique dégénère, elle le suit jusqu’en Finlande. Le cadet, Bekim, grandit à Helsinki. Force lui est de couper les ponts, d’une certaine manière, avec son père : « J’appris à parler et à lire dans une langue qu’il ne comprenait pas. Au milieu de gens dont il haïssait la culture. À raisonner à propos de choses dont il n’avait pas la moindre idée. À l’exclure, lui et tout ce qui se rapportait à lui et à sa vie… » Et Bekim d’essayer d’affirmer son homosexualité et de nous conter ici sa liaison avec « le chat », un individu égocentrique et désagréable. D’autres chats jouent par ailleurs leur rôle, celui que voit sa mère avant son mariage, comme s’il la prévenait des malheurs à venir, et celui que Bekim recueille, quand il retourne à Pristina. (Notons tout de même que la façon dont il s’en occupe, en le lavant à l’eau, dans une baignoire, est difficile à croire : tentez donc d’asperger d’eau un chat, vous verrez ! Mais il est vrai que les chats, ici, tout comme les serpents, sont très humanisés…) Pajtim Statovci aurait peut-être été plus inspiré d’écrire deux romans, nous semble-t-il, tant les deux vies, celle de Eminè et celle de Bekim, diffèrent, bien que la mère et le fils soient capables d’accepter l’inacceptable (un mari violent et un amant mesquin) et tant, surtout, les narrations (l’une réaliste, et l’autre, presque fantastique) s’opposent. Avant, dans le troisième tiers de l’ouvrage, de se rejoindre, sans, pourtant, vraiment convaincre le lecteur.
* Pajtim Statovci, Mon chat Yugoslavia (Kissani Jugoslavia, 2014), trad. Claire Saint-Germain, Denoël (& d’ailleurs), 2016
La Traversée

De Pajtim Statovci (né en 1990 au Kosovo et aujourd’hui professeur de littérature comparée à l’université de Helsinki), les lecteurs se souviennent peut-être de Mon chat Yugoslavia, un roman qui relatait l’installation en Finlande d’une jeune femme originaire du Kosovo, puis le parcours de son fils, homosexuel. Dans La Traversée, les thèmes ne sont pas singulièrement différents, mais traités autrement. L’identité, notamment sexuelle mais pas seulement (mieux vaut-il se dire Albanais, Italien ou Turc ?), est la question récurrente. « Je suis un homme qui ne peut être une femme mais qui, s’il le désire, peut avoir l’air d’une femme ; c’est ce que j’ai de meilleur, un jeu de masques que je peux initier et stopper à ma guise. » Alors que l’Albanie connaît des soubresauts après la mort de son dictateur Enver Hoxha (en 1985) et que la vie devient impossible, Bujar et Agim, deux adolescents, décident d’émigrer. « ...J’avais l’impression que plus personne ne voulait se trouver en Albanie. » La misère sévit, les mentalités sont d’un autre âge, vols, méfiance, tromperies font partie du quotidien de tout un chacun. Ils quittent leur domicile de Tirana, vivent des mois dans la rue, de petit boulot en petit boulot, avant de pouvoir acheter un canot et d’envisager de traverser l’Adriatique en direction de l’Italie. Le titre de ce livre évoque ce voyage. Il évoque aussi l’incertitude sexuelle des deux garçons : préfèrent-ils les hommes ? les femmes ? sont-ils « pédés » ? Et le narrateur, qui est-il vraiment ? Parvenu en Italie, puis en Allemagne, aux États-Unis et finalement en Finlande, Bujar est d’abord déconcerté par ce pays, avant de « comprendre quelque chose d’essentiel (…) : les gens ne sont pas malpolis, ils sont solitaires, ils aiment pouvoir rester tranquilles dans leur coin et n’ont pas besoin de s’entourer de superflu, du luxe des gratte-ciel ou du lustre de sculptures ornementales ». Là, à la limite de la transsexualité, il peut espérer vivre à sa guise. Un bon livre, troublant, à l’intrigue savamment menée.
* Pajtim Statovci, La Traversée (Tiranan sydän, 2016), trad. Claire Saint-Germain, Buchet-Chastel, 2021
La Guerre d’hiver
Peut-être faudrait-il que ses personnages soient moins pitoyables, pour que le roman de Philip Teir, La Guerre d’hiver, soit un livre attachant. Car si l’on peut se laisser prendre par l’intrigue (un sociologue connu est interviewé par l’une de ses anciennes étudiantes, ce qui va bouleverser sa vie), si l’on peut suivre sans rechigner tel ou tel personnage dans les méandres de sa vie quotidienne, on ne voit guère où l’auteur veut en venir. Il y a pourtant de l’humour (ah, ce coït interrompu par un hamster ! ah, ces hommes tous plus lamentables les uns que les autres !), mais ce roman manque de piquant et sa lecture n’est pas loin de lasser. « Quelles conséquences ? Où cela le mènerait-il ? Il essayait d’empêcher ses pensées de divaguer trop loin, ça ramollissait son cerveau (…) : il finit par effacer toute autre pensée, à l’exception de son image, son apparence, sa silhouette devant lui, ses seins, ses fesses, ses merveilleuses fesses, et c’est avec cette image en tête – ses fesses à présents nues – qu’il chemina à travers la nuit d’Helsinki… »
* Philip Teir, La Guerre d’hiver (Vinterkriget, 2013), trad. du suédois Rémi Cassaigne, Albin Michel, 2015
Le Héros oublié
Les admirateurs, à notre image, de la Grande muette, ceux qui lui souhaitent de se taire enfin et pour toujours, liront, à ses dépens, Le Héros oublié du Finlandais d’expression suédoise Henrik Tikkanen (1924-1984). Un court roman qui relate la guerre d’un pauvre soldat finlandais contre l’Union soviétique. Sa guerre, plutôt, car celle-ci a pris fin une trentaine d’années plus tôt mais il l’ignore, perdu qu’il est, depuis, dans les forêts de la Carélie du Nord. « Le militarisme est l’art de faire régner la discipline. Sans discipline, il n’est pas possible de faire la guerre. La base de la guerre, ce sont les ordres. Les ordres sont faits pour être obéis et ne peuvent être discutés. » Et si notre vertueux soldat ne reçoit pas d’ordre lui signifiant que la guerre est terminée, c’est qu’elle continue. On ne saurait pas l’accuser de désertion de poste !
Dans la même veine mais en dehors de la littérature nordique, mentionnons Le Brave soldat Chvéïk du Tchèque Jaroslav Hašek ou Les Aventures singulières du soldat Ivan Tchonkine du Russe Vladimir Voïnovitch.
* Henrik Tikkanen, Le Héros oublié (30 åriga kriget, 1977), trad. du suédois Philippe Bouquet, Gaïa, 2002
Un Crocodile s’en allait à la guerre
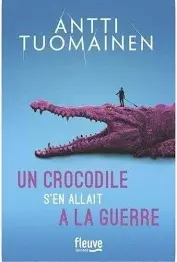
Un Crocodile s’en allait à la guerre est un roman bien plus intéressant que ce que le titre et la quatrième de couverture laissent présager. L’intrigue est pourtant sans guère d’intérêt. Près de Helsinki, l’ancien comptable Henri Koskinen tente de conserver MonTonSonFun, « le meilleur parc d’aventure du monde. Avec une ambiance de ouf » qu’il a fini par récupérer (cf. le volume précédent, Ce matin, un lapin...) après la mort de son frère Juhani. Sauf qu’aujourd’hui le dit frère revient (il s’était réfugié dans une caravane, dans un camping, pour échapper aux gangsters qui lui réclamaient de l’argent) et revendique sa part et même un peu plus : la direction de l’entreprise. Et sauf, surtout, qu’il est complètent incompétent pour cela. Henri, lui, est comptable. Il adore les mathématiques, elles « m’ont sauvé la vie, au sens propre. (…) Elles sont source d’équilibre, de clarté et de paix, aident à prendre conscience de la réalité, indiquent la voie à suivre pour atteindre l’objectif voulu. » Sa vision froide des événements qui ne cessent de se produire autour de lui (combien de malfrats soudainement sonnés et retrouvés morts !) est en totale disharmonie avec la joyeuse pagaille qui règne au parc. Même le policier qui tente d’enquêter sur d’éventuels trafics se laisse emberlificoter. Ce roman, Un Crocodile s’en allait à la guerre, déborde d’un humour serein, qui redouble à chaque page. Un humour redoutable !
* Antti Tuomainen, Un Crocodile s’en allait à la guerre (Hirvikaava, 2021), trad. du finnois Anne Colin du Terrail, Fleuve, 2024
Au fin fond de la petite Sibérie

Une météorite tombe sur le véhicule du pilote de rallye automobile Tarvainen. Elle est aussitôt placée au musée de la ville de Hurmevaara, dans le nord-est de la Finlande, sous la surveillance du pasteur Joel, ancien aumônier militaire, en attente d’être récupérée par des scientifiques. Sa valeur est élevée. Serait-ce pourquoi des cambrioleurs tentent de s’en emparer ? Joel redouble de vigilance ; d’autant plus que Krista, sa femme, lui annonce être enceinte, forcément de lui, alors qu’il pense ne pas pouvoir avoir d’enfant. « ...La grosse-surprise de Krista et la tentative de vol de la météorite sont liées. Ma femme est mêlée à cet embrouillamini. » Antti Tuomainen livre, avec Au fin fond de la petite Sibérie, un roman sans grand contenu mais cependant drôle, quelque peu dans la lignée des farces de feu son compatriote Arto Paasilinna. « On sent presque déjà dans l’air les prémices de la tempête qui s’annonce, de l’immobilité qui précède le déferlement d’une gigantesque vague. Il n’y a encore rien à craindre, mais au-dessus de vous s’arque un anéantissement crêté d’écume. »
* Antti Tuomainen, Au fin fond de la petite Sibérie (Pikku Siperia, 2018), trad. Anne Colin du Terrail, Fleuve, 2021
À la recherche du vivant

Quel livre ! Le titre peut paraître grandiloquent, À la recherche du vivant, et pourtant Iida Turpeinen (née en 1987, universitaire) ne leurre pas ses lecteurs. Son roman, puisqu’il s’agit d’un véritable roman pourvu d’une belle intrigue et riche de digressions naturalistes, donne à voir toute la chaîne du vivant et notamment ce qui corrompt celle-ci, ce qui la voue à la disparition. 1741 : composée de deux imposants navires, la mission d’exploration et de recherche que conduit le capitaine Vitus Bering à travers l’océan Arctique a pour ambition de tracer une nouvelle voie maritime entre l’Asie et l’Amérique (cf. également le roman d’Olivier Remaud, Errances, Paulsen, 2019). À son bord, le naturaliste Georg Wilhelm Steller (1709-1746), décidé à se faire un nom dans le monde scientifique. L’observation de l’animal qui sera nommé la « rhytine de Steller », un sirénien – ou un lamantin – autrement dit une vache de mer, le comble de joie. « Si l’on se représentait les siréniens comme des humains, ils ressembleraient plutôt à un monsieur grassouillet au crâne dégarni ; pourtant, c’est à des femmes qu’ils sont associés dans les contes. » Les deux navires se séparent, celui sur lequel Steller a pris place échoue sur les côtes d’une île déserte. Son caractère individualiste le met à l’écart des marins. Quand l’équipage parvient à repartir vers la civilisation, la Sibérie, des responsabilités sont attribuées à Steller. Mais son humanisme lui vaut des ennemis. Malade, il décède bientôt. La deuxième partie de l’ouvrage s’attache à Johan Hampus Furuhjelm et à son épouse, Anna. Les voici installés à Novo-Arkhangelsk. Puis, partie suivante, sous l’égide du professeur von Nordmann, Hilda Olson se fait une place comme dessinatrice animalière dans un monde scientifique très masculin, au sein d’un jardin soigneusement entretenu : « Ce doit être comme ça au paradis, cinq cents arbres fruitiers, des vignobles à perte de vue, des milliers et des milliers de fleurs. Le jardin de von Steven est le plus beau qu’elle ait jamais vu. » Même dans une région rude et souvent désolée, la nature peut se déployer. Observons dans ce beau roman très didactique la façon dont les animaux sont mentionnés. Beaucoup d’entre eux sont victimes de la bêtise humaine, à l’instar des paisibles vaches de mer, dévorées par des marins affamés, certes, mais auparavant tuées en quantité avec sauvagerie et laissées à pourrir dans l’océan. Ces zones paisibles, dans lesquelles l’être humain n’avait jamais sévi, deviennent en quelques années de vastes cimetières. Parmi d’autres animaux alors nombreux, les loutres sont exterminées. « Certains hommes apprécient le goût des petits, et Steller observe le comportement des femelles qui ont perdu leur portée. Elles pleurent comme des gamine, le chagrin les assèche tellement qu’en dix jours leur peau perd son éclat, et elles ne sont plus bonnes à chasser. » Quand les pêcheurs et les chasseurs ne sévissent pas, ce sont de prétendus ornithologues, collectionneurs d’œufs, tous plus jolis les uns que les autres, qui nuisent à la reproduction des oiseaux – au nom de la science. « En 1844, un groupe de pêcheurs rencontre un couple de pingouins sur une petite île islandaise. Ils tordent le cou à ces délicieux oiseaux, et c’est la fin des pingouins, tellement inattendue qu’aucun naturaliste n’aura écrit d’observations exhaustives sur l’espèce... » Les disparitions s’enchaînent, et continuent de nos jours, plus que jamais. « Le dernier pigeon migrateur est abattu en Illinois un jour pluvieux de 1901, et soudain le ciel est vide. (…). Si cet oiseau a pu disparaître, est-il une seule espèce qui soit en sécurité ? » Le livre de Iida Turpeinen pose les questions. Questions incontournables. L’homme représente le premier danger pour la faune et la flore. Ce livre est un succès, traduit en de nombreuses langues. Tant mieux. Mentionnons juste encore ses « remerciements » qui n’ont rien à voir avec les listes habituelles de parents, amis et professionnels divers aujourd’hui systématiques : « Je tiens à remercier les espèces considérées comme éteintes au cours de la rédaction de cet ouvrage... » Argh !
* Iida Turpeinen, À la recherche du vivant (Elolliset, 2023), trad. du finnois Sébastien Cagnoli, Autrement (Littératures), 2024
Nevabacka, terre des promesses

Livre fleuve, livre monde, que ce « roman choral », Nevabacka, terre des promesses. Livre majestueux. Matts « n’était pas fait pour tuer et piller ; il était né pour tenir une bêche, une hache et une charrue. » Un jour, au XVIIe siècle, après avoir guerroyé en Europe, il obtient de la couronne finlandaise un lopin de terre quelque part en Ostrobotnie. Il construit sa cabane, cultive les champs alentours. Un fils naît, que Matts perd car il désobéit à une créature de la forêt ; il sombre dans l’alcool et meurt. Mais la ferme doit survivre, ses descendants proches et lointains prennent donc le relais. Les superstitions sont fortes, dans ce bout du monde soumis à des températures rigoureuses, et expliquent bien des choses peu compréhensibles ; la « Tourbière Enchantée » est un lieu où l’être humain est à peine admis : « on l’appelle ainsi parce qu’il y a longtemps, on pensait qu’elle était peuplée de trolls et de nymphes. » Ainsi se déploie ce très beau roman de l’écrivaine Maria Turtschaninoff (née en 1977 à Helsinki, d’expression suédoise, un temps journaliste, auteure de livres de fantasy pour les jeunes lecteurs). Dans une campagne où vivent des humains « à moitié sauvages », le surnaturel affleure sans cesse – tout au moins les habitants en sont-ils persuadés ; diverses croyances vont de soi, et ce, jusqu’à aujourd’hui ou pratiquement. Ce roman peut évoquer par certains côtés, et notamment par ces avancées dans le temps centrées sur un lieu, la ferme de Nevabacka (« Neva signifie ‘marais’ en finnois et backa ‘colline’ en suédois ») et la tourbière à proximité, et une lignée de personnages, le roman du suédois Vilhelm Moberg, Les Fiancés de la Saint-Jean. Même déplacement dans la temporalité-l’intemporalité, même hymne à la nature qui transcende l’être humain pour peu qu’il le veuille, même poésie prégnante. « Elle conduisit Kristiina de plus en plus loin dans la forêt pour lui montrer les myrtilliers, les airelles, les framboisiers, les pissenlits, les millefeuilles et l’osier fleuri, ne tarissant pas d’éloges sur ces plantes : non seulement elles étaient jolies, mais il y en avait à foison, et elles permettaient de se nourrir sans efforts. » Les descriptions d’une nature généreuse et indispensable abondent, elles ravissent littéralement le lecteur. « On pouvait faire de la farine d’écorce, dit-elle en caressant un pin. Au bord d’un petit étang, elle expliqua que son père se servait des callas des marais et des nénuphars comme du seigle et des navets. Elle attira l’attention de Kristiina sur le merisier, le sorbier, la camarine noire et le genévrier. » L’odeur des fleurs émane quasiment de chaque page. La flore boréale est d’une grande variété, à condition de savoir l’observer. Les personnages sont remplacés les uns après les autres au fil du temps ; de génération en génération la façon de voir le monde évolue alors que les grandes peurs (celles des autres, celle du lendemain, celles de la mort), demeurent, immuables. La guerre n’est pas évoquée directement, mais elle est toujours sous-jacente. Les Russes surgissent à intervalles réguliers pour détruire, piller, violer, plus féroces que les loups qui finissent par presque disparaître ; les Russes, ennemis plus redoutés que les ours et les gloutons qui se montrent parfois dans la forêt pour qui sait faire preuve de silence. La vie des hommes est rythmée par un travail éreintant. Entre tâches domestiques, maternité et travail aux champs, celle des femmes est laborieuse et des questions sur leurs conditions finissent par être posées au XIXe siècle, ce qui aurait été impossible auparavant. Ce roman aux personnages tous remarquablement décrits et attachants est une somme d’informations sur un pays, la Finlande, presque retiré du monde de par sa position géographique et, cependant, objet de convoitises de ses puissants voisins (Suède et Russie, puis Allemagne, puis de nouveau Russie). On peut quasiment le lire comme un ouvrage d’anthropologie (il y a fort à parier que Jean Malaurie, récemment décédé, aurait été ravi de sa lecture), consacré au peuple finnois, tout au moins celui de cette région de l’ouest du pays, l’Ostrobotnie, suédophone, sur une longue période. Quatre siècles qui voient une civilisation encore très primitive se diriger lentement dans l’ère du nucléaire et de l’informatique. Ne manque, peut-être, qu’un arbre généalogique. Un roman magnifiquement mené, une grande œuvre.
* Maria Turtschaninoff, Nevabacka, terre des promesses (Arvejord, 2022), trad du suédois Johanna Kuningas et Marina Heide, Paulsen (La grande ourse), 2024




